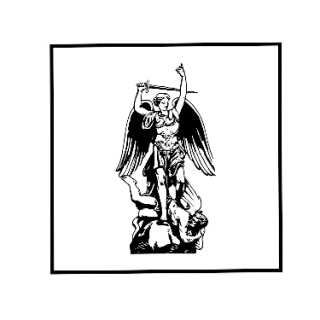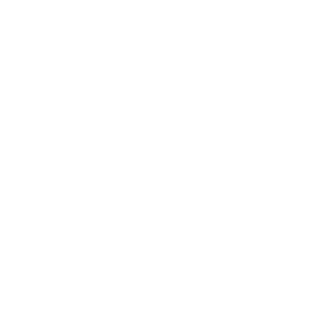ET LA VIE VA … est une quête qui arpente plusieurs champs de combat : le sort des exilés, le dérèglement climatique, des guerres et des violences. Partout où des forces d’amour et de vie affrontent des forces de mort et de destruction. Chemin faisant, des liens se révèlent et se précisent entre migrations, catastrophes naturelles, répressions meurtrières. Face aux dangers qui nous menacent on rencontre des jeunes – et de moins jeunes – qui luttent, créent et s’engagent pour sauver ce qui peut l’être. Pour que la vie continue.
ET LA VIE VA ...
Documentaire / France
12h35
Séance spéciale à 20h30 suivie d’une rencontre avec Alexandra Schwartzbrod et d’Abraham Ségal, réalisateur du film.
LE CHEMINEMENT DE ET LA VIE VA… NOTE D’INTENTION
Pour baliser le chemin qui mène à ce film, je rappelle brièvement quelques jalons de mon parcours : après avoir réalisé B.A-BA dans la foulée de Mai 68, je co-réalise entre 1975 et 1978 La vie, t’en as qu’une. Ce film anarcho-expérimental est l’expression d’un combat contre le travail aliénant et les pièges que la publicité tend à nos désirs. Le triptyque Hors les murs (1984) montre la vitalité de pratiques psychiatriques alternatives qui permettent aux personnes en souffrance de vivre et s’exprimer hors les murs de l’hôpital. Dans Enquête sur Abraham (1994 -1996) et La parole ou la mort (2005 – 2009) le combat contre les forces de mort va de pair avec celui mené contre les dérives fondamentalistes et intégristes. Le dispositif d’enquête déployé dans ces deux films constitue dans ma démarche une forme privilégiée de récit documentaire. Cette figure narrative s’est incarnée dans plusieurs autres films que j’ai réalisés pour le cinéma ou la télévision, tels Le Mystère Paul (1998 – 2000), Enquête sur Paul de Tarse (1999), Quand Sisyphe se révolte (2013) et Camus, de l’absurde à la révolte (2014). Dans les films autour de Camus l’enquête met l’accent sur la lutte pour les vivants et contre la peine de mort et les injustices, motifs qui sont au cœur de sa vie et de son œuvre.
Et la vie va… est un film polyphonique, une tentative de rendre compte de notre vécu à travers un ensemble de scènes tournées sur le vif, d’images et sons d’archives et d’apports artistiques et littéraires. Mon pari est d’explorer des faits marquants vécus et observés ici et maintenant, mais qui résonnent depuis très longtemps dans la conscience et la vie des humains, comme l’accueil des étrangers ou la violence meurtrière. Le propre de cette approche est de montrer de manière directe et simple des sujets complexes comme les soins apportés aux stress post-traumatiques et les expressions artistiques du combat contre la mort. Le cheminement du film devrait permettre à chacun et à chacune de voyager d’un lieu à l’autre à la rencontre des « acteurs » et des « témoins » qui animent Et la vie va… Ce sont en effet des acteurs, c’est-à-dire des femmes et des hommes qui agissent, créent et apportent des preuves et des témoignages au cours de l’enquête. Celle-ci est incarnée par une jeune femme pleinement concernée par les questions vitales qui font l’enjeu du film. Il s’agit de Pauline Roth qui collabore avec moi depuis plusieurs années.
La fonction de l’enquêtrice est plurielle : elle permet au spectateur de passer d’un interlocuteur à l’autre et facilite les liens entre les différents thèmes qu’aborde Et la vie va… Chemin faisant nous découvrons avec elle des réponses aux interrogations de ce film.
Notre travail en commun est d’autant plus fructueux qu’elle a fait des études en « Images et société » et qu’elle vient de tourner son premier film documentaire.
Un autre élément qui intervient dans la structure du film est la musique. C’est un facteur sensoriel et rythmique de premier plan dans le montage du film. Cette musique est composée par Jacques Rémus qui a merveilleusement collaboré à plusieurs de mes films.
Mon désir à faire ce film en dépit des difficultés financières de production tient à l’importance vitale du sujet aussi bien qu’à mon parcours de cinéaste. En effet, cette thématique-là – le combat en faveur de la vie et de l’amour, contre les forces de mort et d’aliénation – me motive profondément et depuis longtemps. Et la vie va… constitue une étape importante dans ce cheminement.
ENTRETIEN ENTRE ABRAHAM SÉGAL ET CÉLINE LOISEAU, COPRODUCTRICE DU FILM
Céline : Comment a débuté l’aventure de ce qu’est devenu aujourd’hui ce film documentaire Et la vie va… ?
Abraham : J’ai commencé à réfléchir en 2018 à un film-enquête à propos de l’affrontement entre Éros et Thanatos, c’est-à-dire entre forces de vie et forces de mort. Au départ, la mythologie grecque et l’Histoire étaient dans le champ de mes recherches aux côtés de combats actuels et des questions qui nous touchent de près. Mais assez rapidement j’ai laissé de côté les aspects historiques et mythologiques pour me concentrer sur le présent.
Céline : Ce film a été tourné sur une longue période, plusieurs années…
Abraham : Oui, on a tourné par petits bouts… le premier tournage a eu lieu en février 2019 à Naples, où l’artiste Ernest Pignon-Ernest réalisait une œuvre exceptionnelle : l’installation Extases où les corps à moitié dévêtus de sept femmes mystiques en extase habitent l’espace d’une crypte qui jouxte une nécropole visitée par de nombreux napolitains. Cette œuvre, déployée dans l’espace de la crypte, réunit des motifs érotiques, spirituels et mortifères.
À Naples nous suivons Ernest, qui à plusieurs reprises y avait fait des collages sur des figures des femmes et sur la présence de la mort. La figure de Pulcinella est très présente dans le travail d’Ernest. Or, le masque de ce personnage populaire de la Commedia dell’Arte – qui combat la Mort à Naples – est inspiré de celui que portaient les médecins du temps de la peste.
Pendant la même année 2019 nous avons filmé la grande manif pour le climat et contre la pollution, dite « La Marche du siècle » puis un spectacle des « Artistes en exil », où des immigrés, des demandeurs d’asile, représentent sur scène leur parcours, les épreuves qu’ils ont traversées.
En 2020, avec la pandémie de Covid, Thanatos a frappé durement et partout ! Nous avons peu tourné cette année-là mais comme les traces du Covid étaient encore présentes bien après la pandémie, nous avons filmé, quelques années plus tard, des témoignages de soignants dans un hôpital parisien.
Céline : Quel est le travail que tu fais en amont, les recherches et rencontres qui ont précédé le tournage de ce film ?
Abraham : J’aime chercher et questionner pour pouvoir mieux imaginer la matière du film à venir. Suite à des lectures et des rencontres j’envisage une structure, le cheminement des personnages ou principaux témoins… quitte à changer, à modifier en cours de route. Ainsi, j’ai pensé à Jean-Claude Carrière, à Edgar Morin, à l’anthropologue Michel Agier, à la psychanalyste Laurence Kahn et aucun d’eux ne figure dans le film, soit parce qu’ils ne sont plus là, soit que le dialogue avec eux n’a pas pu se concrétiser… Mais d’autres témoignages s’imposent au fur et à mesure, comme ceux de la psychanalyste Hélène L’Heuillet et du géo-politologue François Gemenne qui intervient au sujet des liens entre climat, politique et migrations.
La question des liens entre plusieurs « champs de combat » actuels est centrale dans Et la vie va… Et quand on arrive à mettre cela au premier plan, la pensée du film gagne en clarté !
Céline : Dans ce film comme dans plusieurs autres que tu as faits auparavant, il y a une enquêtrice ou un enquêteur, qui fait lien entre plusieurs témoins et entre des situations diverses. Comment avez-vous travaillé ensemble avec Pauline qui mène ici l’enquête ? Quelles indications tu lui donnes ? Je sais qu’elle avait déjà une connaissance de la matière, des thèmes que tu abordes, puisqu’elle t’a assisté dans tes recherches. Mais comment ça se passe une fois sur le tournage ?
Abraham : En fait ce n’est pas une enquête, mais plutôt une quête. Une enquête suppose qu’on cherche – et on découvre parfois – des choses cachées, un secret. Or là les éléments sont souvent « sur la table », mais parfois mal exposés, pas assez éclairés ou pas clairement exprimés. Donc, le rôle de Pauline Roth, de celle qu’on appelle « l’enquêtrice », était de faire surgir une parole et d’essayer de voir quel est le lien entre cette parole et celle de quelqu’un d’autre, associer ce qui se passe ici à ce qui se vit ailleurs. Sa quête débute à Calais en raison de la situation particulière de cette côte dans les tentatives de traversées des exilés de France vers la Grande-Bretagne. Cela commence donc quelques mois après la mort, en novembre 2021, de 27 migrants dans la Manche. Dès la première séquence il est question de mort, de sacrifice mais également de l’action des bénévoles pour aider des personnes exilées à vivre ou du moins à survivre, en dépit de leurs problèmes matériels, juridiques et psychiques.
Et justement, en poursuivant sa quête Pauline va s’entretenir dans la région parisienne avec la psychologue Marie-Caroline Saglio qui pratique la thérapie auprès d’exilés souffrant de lourds traumatismes, à cause de ce qu’ils ont vécu dans leur pays d’origine, de ce qu’ils ont subi ensuite sur les routes de l’exil et en France même.
La situation des migrants, des exilés, de leur accueil ou leur rejet, est un motif important qui revient à plusieurs reprises dans le film et sur différents modes. Ainsi ces « Artistes en exil » qui ont subi auparavant des multiples épreuves : camps d’internement, tortures, viols… et qui expriment leur humiliation et leurs souffrances par le jeu sur scène.
Mon pari était que la présence de Pauline, ses questions et son regard, puissent nous aider à suivre le cheminement de cette quête.
Céline : Comment tu as choisi Pauline pour incarner l’enquêtrice ?
Abraham : Face à des phénomènes très durs comme l’exil, la mort, la violence, la maladie… je voulais que la personne en quête soit plutôt une femme jeune qui parle avec douceur, quelqu’un qui n’est pas un dur comme peut l’être un détective, ni quelqu’un d’expérimenté comme un journaliste d’investigation, mais une personne qui se sent concernée, qui veut vraiment comprendre ce qui se passe. Je pense que cela peut faciliter le suivi du spectateur, lui permettre une écoute attentive le long du film.
Céline : Chemin faisant on rencontre des personnes engagées auprès des migrants ou qui luttent contre la pollution marine et pour la défense du climat. D’autres consacrent leur temps et leurs efforts à soigner, en faisant face à la maladie, à la mort. Mais dans le film l’art et la littérature font partie, selon moi, de ces instruments de lutte. Il y a Ernest Pignon-Ernest, que tu as filmé à Naples ainsi que dans son atelier en région parisienne. Et il y a Camus et son roman La Peste…
Abraham : La place d’Ernest est importante pour moi, car il n’est pas seulement un artiste majeur, mais en même temps un être profondément engagé, humainement et politiquement.
Et une partie de son travail, dont le film donne un aperçu, porte sur des figures de poètes engagés et révoltés. Pasolini, par exemple, Rimbaud, Pablo Neruda, Mahmoud Darwich…mais aussi Desnos.
Ce qui m’a donc intéressé c’est l’art et l’engagement. Ainsi Albert Camus, dont on évoque La Peste dans le contexte du Covid, Camus dont on connait les combats, son engagement dans la vie comme dans l’œuvre. Je pense aussi aux premières paroles qui résonnent dans le film – par la voix de Florence Delay – ces mots du poème Home de Warsan Shire, une poétesse d’origine somalienne, poème où il est question d’exilés contraints de fuir en abandonnant leur maison, de traverser la mer en prenant le risque d’y mourir, qui doivent être prêts à tout abandonner, pour survivre. Car ce qui compte par-dessus tout, c’est de rester en vie.
J’ai tenté de saisir le geste et la parole des artistes comme ceux des personnes engagées auprès des exilés ou pour la défense de la planète.
Céline : Il y a aussi des séquences autour du Bataclan avec le témoignage de Gaëtan Honoré, l’un des survivants de cet attentat djihadiste.
Abraham : Deux entretiens complémentaires abordent ces attentats, l’un à propos des djihadistes qui donnent la mort en se tuant et l’autre avec un homme qui a survécu au meurtre. Gaëtan raconte sa propre expérience au Bataclan et son désir de renouer avec la vie. La psychanalyste et philosophe Hélène L’Heuillet, auteure de Tu haïras ton prochain comme toi-même, livre sur les racines du djihadisme, évoque le conflit et le lien entre la pulsion de mort et la pulsion de vie et d’amour, Éros. J’ai déjà abordé la question du sacrifice dans mon film Enquête sur Abraham, qui date de 1996, en montrant qu’il y a une relation antique entre la figure du sacrifié, du martyr et la figure de l’élu : celui qui se sacrifie ou qui est sacrifié est celui qui est élu, qui est préféré par la divinité. À notre époque, des djihadistes se réclament de ce principe sacrificiel et l’on célèbre dans certains pays la figure du martyr, celui qui tue en se sacrifiant.
Céline : Mais tu montres notamment celles et ceux qui s’engagent pour la défense du vivant.
Abraham : Oui, à la fin de son entretien Hélène L’Heuillet fait le lien entre la pulsion de vie et l’action des jeunes qui contestent l’attitude de leurs ainés et agissent pour sauvegarder le climat et la diversité des espèces. Ensuite, nous rencontrons Greta, membre des « Jeunes pour le climat » puis ses amis de Montpellier. Dans le même état d’esprit, les plongeurs de l’association « Mer veille » sauvent la vie de la faune et la flore marines en se livrant au nettoyage du littoral gravement pollué à Marseille et dans les Calanques.
Céline : Pour revenir à la jeune Greta, on sent dans ses propos que son engagement collectif est vital et qu’il touche aussi à sa vie privée.
Abraham : Absolument, on ne peut pas dissocier chez elle et ses amis le combat collectif de ce qu’on appelle « vie privée » ! Cela va ensemble… et pour Greta le souci pour la nature, pour le vivant, a à voir avec l’amour de l’autre, des autres…
Céline : Et d’ailleurs la fin du film rappelle cet amour de la nature et des autres.
Abraham : Dans les derniers moments du film se combinent le feuillage des arbres, la rivière, les reflets sur l’eau, Pauline qui marche, qui réfléchit et qui écoute, avec en off la voix de Florence Delay disant les mots de Freud en conclusion de Malaise dans la civilisation. Ce passage de Freud m’avait guidé dès le début de ce projet, intitulé alors « Entre Éros et Thanatos – champs de combat » … Dans cette conclusion de 1930 Freud évoque justement le combat décisif entre les forces de mort – dont l’armement à l’aide duquel les hommes peuvent s’entretuer jusqu’au dernier – et les forces de vie, défendues par la puissance d’Éros. Mais l’issue de ce combat reste incertaine. Et la menace que Freud a souligné en 1930 est devenue imminente aujourd’hui car avec l’armement nucléaire d’une part, le réchauffement climatique, la pollution et la disparition des espèces d’autre part, la vie sur terre est en grave danger. Et donc la lutte des jeunes – et des moins jeunes – pour la défense du climat et du vivant est aussi un combat contre les forces de mort et de destruction.
Céline : Et ceci fait le lien entre tous ces champs de combat que tu as filmés. C’est vraiment ce combat entre forces de vie et forces de mort qui établit un pont entre tous les thèmes que tu abordes et qui constituent aujourd’hui de grands enjeux pour nos sociétés. D’ailleurs dans l’ensemble de tes films tu fais preuve d’engagement, que cela soit pour une éducation différente, comme dans ton premier film B.A. BA ou dans le récent Enseignez à vivre ! avec la participation d’Edgar Morin, ou contre le fondamentalisme avec La parole ou la mort et La politique et Dieu.
Abraham : L’engagement est essentiel selon moi quand on fait des films documentaires sur des sujets de société, de politique, d’éducation et même d’art et de littérature. On travaille avec des faits, des gestes et des pensées qui vous concernent de près, qui vous touchent profondément. Et la vie va…, dans la production duquel tu t’es engagée, en est un exemple. Je remarque d’ailleurs que dans la plupart des films que tu as produits l’engagement est présent.
Ainsi dans Sur l’Adamant et les autres films de Nicolas Philibert et dans le récent Château rouge sur un collège dans le quartier de la Goutte d’Or. Et pour quelles raisons tu as décidé en 2023 de co-produire mon film qui était, à ce moment-là, bien avancé ?
Céline : Ce qui m’a motivée je pense, c’est l’engagement, justement. Celui du film et le tien.
Je commence à pouvoir formuler mon propre engagement au vu des films que j’ai produits. Il y a l’aspect politique, car dans les films produits et co-produits par moi on assiste à des combats, des vies de combats, pour que les choses évoluent dans la société, dans le monde.
Afin que nos vies soient meilleures. Je n’ai pas l’illusion que des films puissent changer le monde, mais je crois qu’ils peuvent y contribuer un tout petit peu. Alors je m’engage dans des films dont je pense qu’ils peuvent faire bouger quelques personnes, montrer qu’il ne faut pas se résigner. Ce sont ces raisons qui m’ont amenée à m’engager dans ton film.
CE QU'EN DIT LA PRESSE
Les Fiches du Cinéma
Abraham Segal trousse une dialectique de l’entraide édifiante, bienfaisante, tonifiante.
Libération
Un film tragiquement d’actualité qui, malgré tout, préfère miser sur les forces de vie que s’incliner devant celles de la mort.
Télérama
Un documentaire un peu fourre-tout mais souvent poignant.