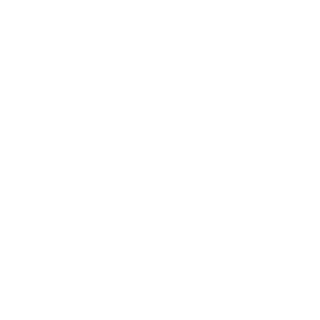Dans une villa de verre au luxe froid et aseptisé, une famille slovène aisée maintient l’illusion d’une vie parfaite. Mais leur équilibre artificiel vacille dangereusement quand un jeune français mystérieux, aux liens secrets avec le père, fait irruption dans leur quotidien.
FAMILY THERAPY
Fiction / Slovénie, Italie, Croatie, Norvège, Serbie
HORAIRES DU 10 AU 16 SEPTEMBRE 2025
JEU 11 • LUN 15 : 13h15
HORAIRES DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2025
à venir
ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE
FAMILY THERAPY est inspiré d’un souvenir d’enfance impliquant une voiture en feu. Pourriez-vous détailler comment cet incident a influencé la narration et les thèmes du film ?
Mon souvenir d’enfance d’une voiture en feu ressemblait à une petite apocalypse intime. Pendant des années, je me suis demandé qui étaient ces personnes dans la voiture qui nous ont vu devant notre voiture en flammes mais sont passés sans s’arrêter pour aider notre famille en détresse ? Cette question m’a conduit à explorer les divisions sociales qui affectent de plus en plus notre société en développant FAMILY THERAPY. Le film utilise cette image – une voiture en feu, une famille bloquée, et une autre famille passant à côté – comme métaphore visuelle du clivage social, du manque d’empathie et de l’isolement.
Aliocha Schneider interprète Julien, une figure énigmatique et perturbatrice. Comment ce personnage a-t-il été écrit et pourquoi l’avoir choisi pour ce rôle, et comment sa présence a-t-elle façonné le personnage du « fils illégitime », pris entre éloignement et douce provocation ?
Julien a été écrit comme quelqu’un venant d’un autre milieu culturel, afin d’accentuer la barrière invisible entre la famille et ce qui l’entoure, y compris par la barrière linguistique. J’ai rencontré Aliocha lors d’une résidence cinématographique à Paris. J’ai apprécié son travail, et il s’est immédiatement senti en phase avec le scénario. Collaborer avec lui était naturel. Comme si nos visions artistiques se répondaient parfaitement. Il était crucial que Julien ne paraisse pas moralisateur, ne juge pas les autres personnages et Aliocha a apporté cette complexité, doux mais provocateur, rendant ainsi les réactions de la famille encore plus révélatrices.
Le film explore les thèmes des outsiders sociaux et familiaux. Comment avez-vous représenté l’altérité à travers les personnages de Julien et de la famille migrante ?
Julien et la famille migrante incarnent tous deux l’altérité, mais différemment. Julien est l’outsider interne de la famille, un rappel de leurs contradictions cachées. La famille migrante représente l’autre externe, ceux qu’on choisit souvent d’ignorer. En les plaçant côte à côte, je voulais montrer comment la société crée ces divisions. Julien introduit aussi l’empathie dans le foyer des Kralj, particulièrement dans son interaction nocturne avec la famille migrante. Ces deux formes d’altérité révèlent les failles sous-jacentes et remettent en question l’image que la famille a d’elle-même.
Compte tenu des thèmes du film et de la présence de l’acteur français Aliocha Schneider, comment pensez-vous que FAMILY THERAPY trouvera un écho auprès du public français ?
Je pense que le public français trouvera dans FAMILY THERAPY de nombreux points d’accroche. L’exploration des privilèges et de la dynamique familiale est universelle, mais la présence d’Aliocha Schneider créer un pont à la fois culturel et émotionnel. Son personnage incarne à la fois un étranger et un miroir, quelqu’un qui reflète les illusions et les fissures de la famille. Il faut espérer que cette dynamique s’applique également au contexte français, d’autant plus que le film pose des questions sur l’empathie, la responsabilité et les frontières fragiles que nous construisons pour tenir le monde à distance.
Des critiques ont relevé des parallèles entre FAMILY THERAPY et Théorème de Pasolini. Ce film a-t-il influencé votre approche narrative ?
Théorème est une référence culturelle très forte, et des parallèles étaient presque inévitables compte tenu du cadre narratif – un étranger perturbe une famille bourgeoise. Je pense que les similarités résident davantage dans les thèmes sous-jacents que dans le ton ou le style. FAMILY THERAPY partage cette idée d’un étranger révélant les failles cachées, mais le film suit ensuite sa propre voie. Il se transforme graduellement d’une critique sociale vers une exploration intime de l’empathie. Ce changement m’a semblé essentiel : s’éloigner de la satire pure ou du film « eat the rich » pour rechercher ce qui reste de l’humanité lorsque les murs s’écroulent.
La musique du film inclut des adaptations de King Arthur d’Henry Purcell qui vous a valu une sélection au festival Music&Cinéma à Marseille. Quel était le raisonnement derrière ce choix musical, et comment cela renforce-t-il l’atmosphère du film ?
La musique est basée sur la partition du King Arthur d’Henry Purcell. Nous voulions une pièce classique imposante, pour souligner la grandeur que la famille essaie de se créer dans le terrarium de verre qu’elle habite. La musique dialogue avec les images, évitant tout sentimentalisme, proposant au contraire un commentaire sur chaque chapitre observé. Elle apporte également une note d’humour, brisant la gravité pour mieux révéler l’absurdité du monde des personnages. Ce mélange de grandeur et d’ironie correspondait bien à l’atmosphère du film, et c’est un plaisir de voir ce travail reconnu à Music&Cinéma à Marseille. La maison familiale en verre symbolise à la fois transparence et isolement.
Que représente ce décor dans la dynamique familiale et la critique sociétale?
La maison en verre est une promesse autant qu’un piège. Elle suggère une ouverture et une connexion avec la nature, mais c’est en réalité un vivarium, un environnement contrôlé où rien ne peut entrer ni sortir. La famille vit dans l’illusion d’être en harmonie avec la nature environnante, mais elle s’est construit une forteresse de verre qui l’isole du réel. Ces murs sont intenables ; le manque de lien réel et, par conséquent, d’empathie détruit progressivement la société.
Olivia subit une transformation majeure tout au long du film. Comment avez-vous abordé avec l’actrice Katarina Stegnar l’évolution de son personnage ?
Nous souhaitions que la transformation d’Olivia soit viscérale. Elle commence en étant remplie d’inhibitions, maintenant coûte que coûte l’ordre fragile de la famille. À mesure que les fissures apparaissent, elle lâche prise peu à peu. Nous avons travaillé minutieusement sur la voix, la posture, les petits gestes, pour montrer comment le contrôle se transforme en vulnérabilité. À la fin, Olivia est dépouillée de ses illusions mais devient plus humaine. La performance de Katarina exprime parfaitement cette évolution : elle est à la fois fragile et subtilement puissante dans sa découverte personnelle.
La photographie et les décors sont saisissants. Comment avez-vous collaboré Comment avez-vous collaboré avec votre équipe pour représenter visuellement les conflits internes et externes de la famille ?
Nous voulions que les visuels reflètent le parcours des personnages. La maison de verre commence presque comme une galerie, impeccable, mais froide et isolante. Au fur et à mesure que la famille s’effiloche, la maison elle- même commence à s’effondrer, reflétant les fissures de leur façade et de leurs relations. En même temps, elle passe d’une vitrine stérile à quelque chose de plus habité, un espace qui ressemble à une vraie maison. Cette transformation était importante : à mesure que les personnages deviennent plus vulnérables et plus humains, les frontières entre le monde intérieur et le monde extérieur commencent également à s’estomper. Chaque détail, lumière, couleur, texture, a été choisi pour soutenir ce changement, créant un dialogue visuel entre les mondes intérieur et extérieur de la famille. Cela se reflète également dans la conception des costumes et le maquillage, qui évoluent en même temps que le parcours des personnages.
Le film critique le détachement des riches vis-à-vis des problèmes de société. Quel message espérez-vous que les spectateurs retirent de ce film en ce qui concerne la responsabilité sociale et l’empathie ?
J’espère que les spectateurs quitteront le film en réfléchissant à la facilité avec laquelle nous restons détachés lorsque nous sommes à l’aise, et au danger que ce détachement peut représenter. L’empathie est ce qui nous permet de voir les autres comme des êtres humains, et pas seulement comme des problèmesà résoudre ou à ignorer. Le film nous invite à nous interroger sur les murs que nous construisons autour de nous et à nous demander si ces murs nous protègent réellement ou s’ils ne font que nous isoler.
Le titre provisoire était Redemption for Beginners (La rédemption pour les nuls). Comment le récit final aborde-t-il la rédemption pour chaque personnage ?
L’idée de rédemption reste centrale, elle constitue encore le titre original slovène d’ailleurs : Odrešitev za začetnike. Chaque personnage doit la trouver pour lui-même, au-delà des illusions mais aussi au-delà de ses peurs : peur de la perte, de la douleur, des parents qui perdent le contrôle sur la maladie d’un enfant. Ce n’est pas un grand moment unique et grandiose qu’ils partagent collectivement, mais un réglement de compte intime, une prise de conscience personnelle qui leur permet de devenir une famille, de se connecter enfin les uns aux autres de manière honnête.
Équilibrer l’humour noir et la critique sociale peut être complexe. Comment avez-vous maintenu cet équilibre pour préserver le ton et le message du film?
L’humour a cette capacité à nous désarmer et facilite la confrontation avec des vérités inconfortables. À mesure que le film avance, il passe graduellement d’une satire sociale à un drame intime plus sombre. Ce changement reflète le passage d’une critique sociétale plus large à une attention plus profonde à la condition humaine. Les personnages, qui semblent d’abord être des caricatures de privilèges, révèlent leurs vulnérabilités, leurs contradictions et leurs peurs. Ce mélange de tons met en évidence la complexité de la vie moderne – la dissonance entre nos valeurs et nos actions – et crée un espace de réflexion non seulement sur la société, mais aussi sur nous-mêmes.
Après Family Therapy, quels sont les thèmes ou les histoires que vous souhaitez explorer dans votre travail futur ?
Je suis fascinée par les moments d’éveil, ces changements silencieux et puissants qui peuvent modifier toute la perspective d’une personne. Je souhaite continuer à explorer la manière dont nous passons du sentiment d’être piégé à celui de liberté, comment nous pouvons nous libérer de l’emprise de l’autre.
BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE
SONJA PROSENC est une scénariste et réalisatrice primée internationalement (TorinoFilmLab, Berlinale et Sarajevo Talents) et saluée par la critique. Son premier long-métrage, L’Arbre (2014), a remporté trois Vesnas et le prix de l’Association des critiques de films à Portorož, participant ensuite à plus de cinquante festivals internationaux. En 2016, Cineuropa l’a incluse parmi les huit réalisatrices européennes prometteuses. Son deuxième long-métrage, Histoire d’amour (2018), récompensé dès sa phase de développement, a été présenté en première mondiale à Karlovy Vary, où il a reçu une mention spéciale du jury, faisant d’elle la première réalisatrice slovène récompensée en compétition principale d’un festival de catégorie A. Les deux films ont également représenté la Slovénie pour les Oscars. Elle navigue avec succès entre le drame, la comédie (Paradise, court-métrage primé en 2019) et les séries télévisées à suspense (comme Trigrad, première présentée au Series Mania en France, et nominée pour le Heart of Sarajevo dans sept des huit catégories au Festival du film de Sarajevo 2023). Family Therapy est son troisième long-métrage.
CE QU'EN DIT LA PRESSE
L’HUMANITÉ
Avec beaucoup d’humour, cette famille atypique livre son lot de névroses et de non-dits. Le tout porté par une indéniable sensibilité.
ROLLING STONE
Si Family Therapy parvient à maintenir une sorte de mystère à travers son esthétique léchée, toujours impeccablement cadrée, on perce avec un certain plaisir la surface lisse de cette famille bien trop propre sur elle.
aVoir-aLire.com
Humour noir et décalé préside aux étranges aventures d’une famille dysfonctionnelle. Un film venu de Slovénie aussi exigeant que réjouissant.