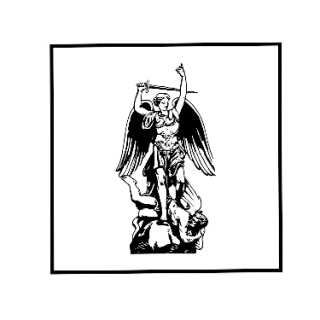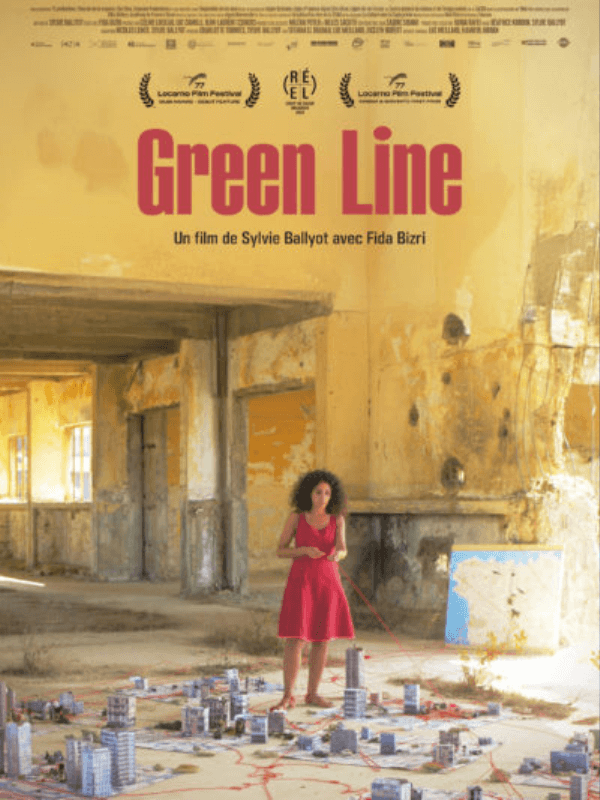En animation et archives, retour sur la guerre civile du Liban, à hauteur d’enfant, sur les traces de Fida, née en 1975 à Beyrouth, qui déploie les plis de sa mémoire en interrogeant d’anciens protagonistes du conflit. Entre fureur passée et poésie de la mise en scène, un poignant récit cathartique.
GREEN LINE
Documentaire / France
ENTRETIEN AVEC SYLVIE BALLYOT ET FIDA BIZRI
Pourquoi la guerre libanaise ?
Sylvie Ballyot : En tant que cinéaste française qui n’a pas connu de guerre, ce qui m’interpelle dans le Liban et son état de guerre quasi permanent va au-delà du Liban. J’ai regardé cette guerre comme s’il s’agissait d’un concentré du monde en miniature. Peut-être est-ce dû à sa situation géopolitique au centre des tensions mondiales ; à son côté ‘trait d’union’ entre Orient et Occident, entre monde arabe et monde occidental, qu’il affiche si fièrement; ou à cause de sa si petite taille où l’on trouve néanmoins des ‘succursales’ de toutes les grandes idéologies du monde ; ou encore parce que toute chose s’y passe de manière exacerbée, crue, et accrue, comme poussée à son paroxysme : la guerre, la violence, l’effondrement, la destruction, le traumatisme. Le Liban est à mes yeux comme un thermomètre du monde. L’observer, que ce soit dans ses guerres d’hier ou d’aujourd’hui, me donne des indications sur l’hier et le demain ailleurs dans le monde.
Comment est née l’idée de ce film ?
Sylvie Ballyot : L’idée de ce film est née il y a 20 ans quand j’ai rencontré Fida pour la première fois en 2006, au moment d’encore une autre guerre au Liban. A cette époque, je ne savais pas comment regarder les guerres des autres, ni que ces guerres me regardaient et n’étaient pas juste celles des autres. Mais ça me travaillait. Fida est, malgré elle, devenue mon interprète : elle m’a initiée à la compréhension de la grammaire de la guerre loin des sentiers battus. Dans la vie hors caméra, Fida est linguiste. En linguistique, pour décrire une langue on choisit des passeurs qu’on appelle « des informants »: ce sont des natifs de cette langue qui nous l’enseignent. Dans la langue de la guerre, Fida a été ma traductrice, m’expliquant les lieux de souffrance. Et elle l’a fait sans pathétisme ni esprit revanchard. En tentant d’apporter de la lumière là où il n’y en avait pas. Je me suis dit ‘c’est elle qui sera mon fil rouge’; je la trouvais plus belle à filmer que la guerre et son tas de morts et de destructions. Mais très vite, j’ai compris que je ne pourrais pas me soustraire à cette violence, qu’il fallait que moi aussi j’y plonge à travers les images d’archives et que j’en témoigne. Le film a mis plusieurs années à se fabriquer. Le temps a été un véritable allié, il m’a permis de mieux connaître Fida, que notre lien prenne de la profondeur, et qu’elle accepte l’idée d’un film.
Pour vous Fida, comment avez-vous décidé de participer à ce film ?
Fida Bizri : Ne venant pas du monde du cinéma, au début je ne comprenais pas ce qu’un film impliquerait comme plongée en soi. Je pensais que je le faisais par sympathie pour Sylvie, pour elle. J’étais réticente à répondre à ses questions. Un peu par peur d’elle, un peu pour la protéger : pourquoi veut-elle savoir des choses que j’ai tout fait pour oublier ? Sera-t-elle capable de tout entendre ? J’avais déjà rencontré des Français qui pleuraient à ma place en m’écoutant, et je trouvais cela révoltant, comme s’ils me prenaient mes larmes. Et puis, qui suis-je pour parler de la guerre, moi qui au final ne suis même pas morte ? Mais il y a eu une bascule le jour où Sylvie m’a montré une reconstitution miniature d’un terrible évènement auquel j’avais assisté à 21 ans (et qui n’est pas dans le montage final de Green Line). Je lui avais confié mon souvenir, ma confiance en elle grandissant à mesure que je la voyais prendre note sans pathos, me pousser à m’intéresser aux détails sensoriels, à gagner en précision. Dans sa reconstitution, elle avait rempli les vides de ma mémoire par son imaginaire. Le résultat était une grande sensation de liberté et la conviction que le passé n’est pas figé, on peut y revenir à tout moment pour le travailler et en guérir. Le processus de cinéma qu’elle me proposait a eu raison de mes résistances, et c’est là que j’ai décidé de collaborer plus activement avec Sylvie sur ce film.
Qu’est-ce que ça vous fait que votre histoire soit filmée par quelqu’un d’autre ?
Fida Bizri : Très tôt dans le processus du travail, j’ai compris que ça m’intéressait de continuer à regarder le passé, et que le fait que Sylvie soit extérieure au Liban et à la guerre tout en connaissant le Moyen-Orient, me garantissait que c’était la bonne personne avec qui vivre cette aventure. Car d’une part Sylvie ne projetait rien sur moi, d’autre part elle cherchait réellement à voir ce que je voyais dans mon enfance, et elle posait beaucoup de questions auxquelles je n’avais souvent pas de réponse, ce qui m’obligeait à sortir de mon récit rôdé sur moi-même. Mon récit l’intéressait moins que mon ressenti.
Comment vous est venue l’idée des figurines, de l’animation ?
Sylvie Ballyot : Au départ, j’avais imaginé un récit de fiction pour lequel je n’ai pas trouvé d’argent. Alors qu’en parallèle, se profilait avec Fida un processus délicat de remémoration. Il y avait un sentiment d’urgence à honorer la confiance que Fida m’accordait et à l’accompagner dans ce retour vers le passé. J’ai alors décidé de faire autrement, d’imaginer et de fabriquer d’autres outils de cinéma. J’ai pris ce que j’avais sous la main : des jouets miniatures, des matériaux recyclés pour fabriquer les décors, pour remettre en scène les souvenirs morcelés que Fida m’avait racontés par bribes, ce dont elle se rappelait. Parfois j’ai moi-même imaginé les parties manquantes de ses souvenirs. Mes animations étaient très simplifiées et stylisées au début. Ces premières maquettes m’ont permis de rencontrer mes futurs collaborateurs et collaboratrices, de leur donner envie de participer à l’aventure. D’abord Béatrice Kordon la chef opératrice qui a été la première à me rejoindre, puis Nicolas Lemée spécialisé en animation en volume et photos découpées. Puis Charlotte Tourrès, la monteuse, avec qui j’avais déjà travaillé sur mes précédents films, et Céline Loiseau la productrice. Sans ces collaborations, ce film n’aurait pas pu se fabriquer.
Et justement, quel a été le processus de fabrication du film ?
Sylvie Ballyot : Ce film a été un long processus, avec beaucoup de strates de travail, et plusieurs propositions formelles qui devaient s’emboîter. Dans mon travail, la question du temps est reliée à la notion d’espace. À chaque film, je cherche un espace spécifique pour le fabriquer, aussi bien intérieur qu’extérieur, qui me permette de mener mon geste jusqu’au bout, sans injonction extérieure autre que la nécessité de dire quelque chose qui tiendrait tête à la pensée commune, et permettrait de renouveler le langage, notamment autour de tout ce qui a été dit sur la guerre – pas que la guerre au Liban. Green Line n’est pas un film que j’aurais pu préméditer dans mon esprit tel qu’il est aujourd’hui avant de le réaliser. C’est un film qui s’est construit et imposé à moi par couches. D’abord, la plongée dans les souvenirs d’enfant de Fida que j’ai reproduits avec des figurines et des décors en miniature ponctués par sa parole à la fois enfantine et poétique en voix off. Ensuite, j’ai ressenti le besoin de prendre de la distance par rapport aux souvenirs personnels de Fida, et de les confronter à des acteurs extérieurs de la même époque. J’ai proposé à Fida de basculer dans une forme plus documentaire où elle rencontrerait des adultes civils qui ont vécu la guerre et des milicien.ne.s. On en a rencontré beaucoup. Très vite, je me suis rendu compte qu’il manquait un centre de gravité à toutes ces rencontres, quelque chose qui donnerait du corps, de la réalité à ces paroles et à ce passé douloureux. Et c’est venu à la fois avec le choix de décliner les maquettes et figurines des souvenirs d’enfance en un ‘théâtre de parole cathartique’, et avec le choix du lieu de tournage, un bâtiment détruit symbolique de la guerre qui, pour moi, était un personnage à part entière. Enfin, au moment du montage, j’ai eu besoin d’inviter des images d’archives, qui pour certaines sont violentes, pour donner encore plus de réalité.
Comment se sont passées ces rencontres avec les miliciens ?
Sylvie Ballyot : Au début, on ne pensait pas que tous ces ex-milicien·nes accepteraient de parler. Mais à la fois les maquettes, qui proposaient un ancrage enfantin au premier abord, et la posture de Fida qui cherchait une vraie rencontre avec chaque personne plutôt que des interviews, ont rendu cela possible. On a commencé par filmer des combattants de Beyrouth Ouest, issus du quartier de Fida ou alentour. Et très vite on s’est dit qu’il fallait franchir la ‘green line’ et aller filmer de l’autre côté. Le monde de l’enfance de Fida s’est soudain élargi. D’une rencontre à l’autre, moi je poussais Fida non seulement à les comprendre, mais aussi à les confronter, dans le but à la fois de continuer à les comprendre mais aussi de se faire entendre par eux. Et j’ai su que le tournage avec ces miliciens était fini quand on a rencontré le dernier personnage qui est la combattante chrétienne, car avec elle Fida allait plus loin dans sa propre réflexion sur la guerre et sur la violence.
Fida Bizri : Au départ, je ne souhaitais pas faire craquer la couche de béton tranquille sous laquelle j’avais enfoui le passé. Mais vite, j’ai vu à quel point ces rencontres étaient essentielles pour moi. C’était l’occasion pour moi de découvrir que ma plus grande blessure, enfant, n’était pas tant de subir des bombes à la chaîne que de ne pas comprendre pourquoi nous vivions cette absurdité de guerre. C’est ce dont je souffrais le plus, car il y avait beaucoup de choses qui m’échappaient. Personne ne me disait ce qu’il fallait penser parce que personne ne savait, ni mes parents, ni les profs à l’école, personne ne comprenait rien. Et là, face aux milicien.ne.s, j’avais à la fois l’occasion de (peutêtre) comprendre, et de leur faire comprendre ce que je ressentais quand j’étais enfant, époque où j’avais beaucoup plus le temps de méditer le monde qu’eux (c’était à peu près ma seule activité). Les maquettes et les figurines garantissaient qu’on n’allait pas remonter trop en hauteur pour faire des jeux de rhétorique, ou ne parler que de politique mais qu’on allait rester ancrés dans la scène dont on parlait, pour voir ce qu’on n’avait, respectivement, pas pu voir à l’époque.
Essayer de les comprendre et surtout donner à les comprendre, ne revient-il pas à leur donner la parole et à faire valoir la parole, de personnes qui ont les mains couvertes de sang ?
Sylvie Ballyot : Si on se place dans l’absolu, je suis d’accord avec ce que vous dites. Le problème pour moi est que j’ai beau chercher à filmer l’absolu, je ne l’ai pas trouvé. Je n’ai trouvé dans la vraie vie que du relatif, du subjectif, mon regard, votre ressenti, et je dois faire avec ! Nous vivons dans un monde de plus en plus polarisé où il y a les méchants et les victimes, et c’est peut-être rassurant pour certains. Mais moi je ne suis rassurée que par ce que je vois et j’expérimente. Si j’invite quelqu’un à le filmer, je lui dois de respecter sa vision du monde. Sauf que, dans Green Line, je filmais à la fois Fida et les milicien.ne.s, et j’étais tout le temps dans cette polarité de respecter autant leur vision que celle de Fida (que j’étais parfois plus attentive à respecter qu’elle-même). Plongée dans leur écoute, Fida oubliait parfois de leur faire entendre son vécu (car il faut savoir que Fida est hyper polyglotte et son sport favori est d’écouter l’autre jusqu’à décoder la grammaire de ses émotions et perceptions). Au final, certes on leur a donné la parole et on se devait de la respecter, mais ce n’est pas sur un terrain neutre qu’on les a invité.e.s, c’est sur le terrain de Fida avec ses outils (maquettes et figurines), et dans un lieu dédié (ce grand bâtiment détruit pendant la guerre).
C’était important que ces rencontres n’aient pas lieu sur leur terrain, mais dans un lieu choisi par nous, pour que cette parole advienne. Et puis il y avait une question qui me semblait essentielle et qui était au centre de ces rencontres : d’une seconde à l’autre pourrait-on tous basculer et un jour ‘tuer’ ? Ou n’est-ce le cas que de certaines personnes qu’on appelle alors ‘tueurs’ ? Y a-t-il une ligne infranchissable entre les deux ? Serait-ce possible un jour de cesser l’effroyable cycle de vengeance qui est le terreau des guerres : « je te tue car tu as tué mon enfant, ma mère. Et tu me tues car j’ai tué ton enfant, ta mère…etc… » ? Peut-être que si l’on décortiquait les conditions de vie et d’apparition de l’injustice et du sentiment de vengeance chez tous ces ‘tueurs’, pourrait-on mieux les comprendre ? Mais suffit-il de les comprendre pour leur pardonner ? Utiliser le terme ‘tueur’ correspond à une vision essentialiste de ces combattants qui empêche de les voir en entier. En les réduisant à ce terme, on ne voit plus leurs aspérités.
Fida Bizri : Pour ma part, je ne les rencontrais pas en me disant je vais rencontrer ‘un tueur’. De même, qu’ils ne me rencontraient pas en se disant je vais rencontrer ‘une victime’ ou pire ‘une personne qui se prend pour une victime’. Je voulais qu’ils me voient pour ce que je suis, une personne qui cherche à comprendre, et je les ai approchés avec zéro projection. Et je pense que cette posture m’a permis de dire beaucoup de choses qu’en temps normal ils n’auraient pas accepté. Plus on donne à l’autre le droit d’être écouté, plus on se donne le droit de s’exprimer. Une fois le film fini et montré, j’ai eu des retours comme quoi en m’écoutant parler avec les milicien.ne.s certains spectateurs étaient révoltés de comprendre leur point de vue, et parfois d’adhérer plus au leur qu’au mien. Preuve, selon eux, qu’on n’aurait pas dû leur donner ainsi la parole. Alors que pour moi c’est plutôt la preuve de quelque chose de plus complexe : pour tuer on n’a besoin ni d’être intrinsèquement mauvais ni d’avoir tort politiquement. Et de comprendre ça peut être révoltant je l’avoue, mais c’est aussi très inspirant car ne pas tuer pourrait aussi être une décision. Même quand on est en train de lutter légitimement pour sa survie.
Est-ce que ce film sur la guerre se veut apolitique ?
Sylvie Ballyot : Dans Green Line, il y a la posture de Fida personnage principal du film, et il y a la posture du film lui-même. Et elles sont différentes. Plus qu’apolitique à proprement dire, Fida est quelqu’un qui est très attirée par la racine des maux humains. Pour elle, la politique n’est qu’une branche de l’arbre, elle ne cherche pas à comprendre ce qui s’y passe, d’autres pourraient le faire mieux qu’elle, semble-t-elle penser. Elle va plutôt fouiller dans les racines, voir ce qui s’y passe avant d’en arriver à la politique. J’ai choisi Fida comme personnage principal justement parce que j’avais besoin d’une ‘linguiste de la souffrance et de l’impuissance’, son esprit va directement et spontanément à l’endroit de la souffrance parce que la souffrance c’est souvent du muet, du non-dit. Et c’est par le langage qu’on peut faire advenir la lumière. C’est par la parole qu’on crée un lien à l’autre, un lien de vraie réciprocité, qui peut nous sortir des ténèbres, et de l’enfer qu’est une guerre. En la filmant j’ai voulu dessiner le contour de ce personnage-là qui m’intriguait, car sa façon de penser est loin de la mienne, aussi loin que celle des milicien.ne.s avec qui je n’étais souvent pas d’accord. La posture du film lui-même par contre est la mienne : Moi je suis quelqu’un de révolté par ce que je perçois comme de l’injustice. Le cinéma m’a sauvée à l’époque où, encore jeune, je ne savais pas parler.
Je pense qu’il peut en sauver d’autres que moi. Green Line est donc clairement positionné du côté des peuples massacrés, des morts de la guerre, des opprimés. Il y a donc cette polarité dans le film entre, d’une part, Fida personnage principal qui dit que la seule solution serait de sortir du binarisme méchants-victimes, de la justification de la souffrance et de la guerre au nom de la légitimité, afin de voir que la vengeance appelle la vengeance, le sang appelle le sang. D’autre part, moi avec ces images d’archives et le montage dans son ensemble qui dit qu’il ne faut pas oublier toutes les victimes. Je n’ai pas d’autre nom pour les désigner. Et c’est ce mélange entre ces deux points de vue qui fait le trajet de réparation proposé dans ce film. Je transforme Fida tout en restant au plus près de ce qu’elle est dans cette scène symbolique d’animation où elle porte les morts d’un bord à l’autre de la rive, pour leur redonner un peu d’existence, et les déposer sous nos yeux.
Fida, comment votre positionnement ‘apolitique’ est-il tenable aujourd’hui au regard de ce qui se passe au Moyen Orient ?
Fida Bizri : Ce qui se passe aujourd’hui au Moyen Orient et ailleurs dans le monde est une horreur. Or, quand on est plongé dans l’horreur, c’est déjà trop tard pour parler de moralité. C’est déjà trop tard pour parler tout court. La seule solution que je vois, c’est de réfléchir en dehors de l’horreur. Quel est le problème en dehors de l’horreur et des bains de sang et des bouts de chair déchiquetés ici et là ? C’est ça la question. Et quand on y pense, le problème c’est toujours la non-reconnaissance des droits fondamentaux humains, comme manger, avoir un toit, se sentir digne, pouvoir vivre en liberté sur un bout de terre où les générations d’avant avaient planté des arbres, ne pas être menacé continuellement. Tous ces droits, je ne les ai pas toujours eus dans ma vie, et je sais à quel point on est différent et diminué quand ça manque. Dans le film je ne dis pas que je suis contre quoi que ce soit. Je parle de moi-même, je me regarde et j’essaie de me comprendre. En me sondant, je découvre que je préfère mourir plutôt que de tuer. Et là, je cherche dans mon enfance : qu’est-ce qui m’a menée à penser cela. Je ne dis pas que c’est bien ou mal de tuer, je dis que pour moi toutes les vies sont des vies. C’est une croyance que j’ai, je n’y peux rien. Dans mes échanges avec les miliciens, je ne voulais pas les condamner mais je voulais les inviter à voir qu’ils ont tué des vies. Il me semblait important de ne pas perdre le réel de vue, je ne m’occupais pas trop de morale. Il y a un proverbe qui dit : ce n’est pas avec le feu qu’on éteint le feu. Dire que je cherche une autre façon pour éteindre le feu ne signifie pas que je ne vois pas le feu.
Dans le film, la secouriste de la Croix Rouge fait référence aux procès qui ont eu lieu à Sarajevo. On pense aussi aux commissions de réconciliation au Rwanda et en Afrique du Sud. Qu’en est-il pour le Liban ?
Sylvie Ballyot : En effet, c’est très spécifique à la guerre libanaise. L’amnistie annoncée à la sortie de la guerre a non seulement obligé à tourner la page sans aucun jugement mais elle a, en plus, placé les chefs des milices à la tête du gouvernement naissant. D’où ce mélange à la fois de colère et d’abattement chez les Libanais quand ils sont invités à parler de guerre. D’où également cette méfiance à l’égard des mots : à quoi ça sert de faire craquer la couche de béton qui scelle les tristes souvenirs pour en parler ? Puisque parler implique d’utiliser des mots, les mêmes mots qu’utilisent nos anciens bourreaux d’hier pour nous parler du vivre ensemble aujourd’hui ? Au Liban, oublier sans oublier est un art de vivre. Les gens nous ont souvent dit : « Pourquoi encore parler de la guerre ? Il faut oublier ». Un personnage dans le film cite un proverbe local pour se donner du courage : «L’humain s’appelle oubli». Je ne leur jette pas la pierre, mais je pense que c’est un grand sujet. L’oubli plonge le passé dans les ténèbres. Avec Fida, nous avions à cœur de traverser ces ténèbres. Habituellement, les ténèbres sont recouvertes soit d’oubli, soit d’une parole banale, de bavardage, car on ne sait pas en parler. Dans ce film, on a tenté ‘d’écluser’ le bavardage pour aller vers une parole plus dense, révélatrice. Le dispositif de filmage a été pensé pour que cette parole-là advienne. Sans faire de miracle qui les dissiperait, nous avons voulu repousser les ténèbres, ne serait-ce que d’un millimètre.
Il y a cette énigme dans le film où à la fois on est face à des images d’archives atroces pour ne pas oublier, et face à Fida qui brûle les images des massacres à la fin pour oublier. Qu’en est-il ?
Sylvie Ballyot : J’ai choisi les archives avec grande attention. Pour moi, elles ne devaient pas avoir seulement un rôle historique, de reconstitution, mais aussi d’évocation, de retour sur des sensations du passé de Fida. Certaines mettent en scène des micro événements de la guerre : passer un check point, se crier des insultes à travers la ligne de démarcation, courir dans Beyrouth détruit. Elles sont aussi des témoignages que tout cela a bien au lieu, comme par exemple les corps morts du massacre de Sabra et Chatila.
Fida Bizri : Dans le geste de brûler les images vers la fin du film, je ne cherchais pas à les effacer mais plutôt et surtout à les transformer. Si les images d’archives que parsèment le film disent que cette horreur a bien eu lieu, mon propos était que cette horreur qui a bien eu lieu, eh ben nous l’avons transformée ensemble moi et les milicien.ne.s en la nommant, en la travaillant, en la représentant dans des maquettes et des figurines dont la fabrication est si longue et méticuleuse. J’ai vécu le processus de Green Line, non pas comme s’il s’agissait d’un film, ni d’une histoire à raconter, mais comme une expérience corporelle. Par sa durée, le film est aussi une vraie expérience corporelle.
Est-ce que vous avez cherché une forme de réconciliation dans ce film ?
Fida Bizri : Si, quand vous étiez enfant, vous avez perdu les jambes, un film ne va pas vous les faire repousser. Mas il peut vous permettre de comprendre ce que vous avez développé comme alternative aux jambes pour grandir, jusqu’à pouvoir aujourd’hui avancer, et même courir. Dans mon cas, j’ai développé l’habitude et la curiosité d’aller à la racine des choses, d’y regarder pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnent vraiment, et non pas comment moi j’aimerais qu’elles fonctionnent. Ce film m’a également appris beaucoup de choses. Sur le fonctionnement par exemple du trauma qui opère par images fixes, figées comme une photo. Jusque là j’étais prisonnière de ces images statiques qui paralysaient ma mémoire. Le film, par opposition à la photographie, en me proposant des séquences d’images dynamiques a créé du mouvement dans ma mémoire, m’a dé-figée. J’avais par exemple l’image de moi debout, puis une autre image de moi allongée par terre, et quand je me racontais mon souvenir à moi-même, je ne voyais pas de lien entre ces deux images. Sylvie en ajoutant à ce souvenir l’image dynamique de moi en train de tomber a obligé mon souvenir à retrouver du mouvement. Et l’effet de ce passage du statique au dynamique a été très libérateur pour moi. Aujourd’hui, riche de cette expérience, je propose cette réparation à d’autres qui me confient leurs traumatismes, je les invite à jouer avec leur mémoire pour la défiger, pour s’ébrouer comme un chien qui veut se débarrasser de l’eau qui le leste. Plus le temps passe, plus je réalise la force de reconstitution en miniature que Green Line m’a proposée. Car désormais, quand je repense à mes souvenirs traumatiques, je pense plus aux figurines, aux décors miniatures du film, aux erreurs de reconstitution ou d’échelle qui me font sourire, qu’au souvenir lui-même. Un jour je me suis dit : «Est-ce possible ? Je suis en train de penser à ce massacre qui m’a traumatisée et je souris ?». J’ai réalisé que cette reconstitution s’interposait désormais comme un filtre entre moi et le trauma qui n’avait plus de prise sur moi. Je trouvais cela magique, et la magie tenait autant à la précision documentaire qu’à la fiction des scènes par rapport à mon souvenir. Cette part de fiction elle-même, née du regard de Sylvie, a eu aussi son rôle dans le processus de réconciliation.
BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE
Sylvie Ballyot est née deux fois, la deuxième avec la découverte du cinéma et de son langage formel qui rend de la vie une image plus vraie que la réalité. Cinéaste, elle s’attelle à déshabiller les sentiments les plus enfouis, plantant sa caméra au plus près de son corps, de ses amours, de sa famille et de sa résistance à la normativité (Alice, Tu crois qu’on peut parler d’autre chose que d’amour ?, Tel père telle fille, Juliette). C’est la période intime, après laquelle elle opère une bascule vers l’extérieur et creuse, toujours avec la même attention portée à l’intime, des thématiques d’altérité (Love and Words tourné au Yemen, Moi tout seul dont le personnage principal est handicapé, Green Line sur la guerre libanaise). Pour faire apparaître ses personnages, elle puise dans les formes les plus hybrides, mélangeant fiction, documentaire, journal filmé, performances, et reconstitutions miniatures.