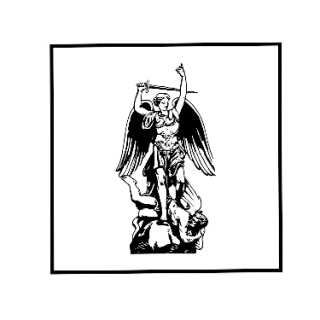En 2017, une région du Portugal est ravagée par de gigantesques incendies qui emportent des forêts entières… et des vies. Quelques mois plus tard, un groupe de survivants — Justa, une fillette, son père gravement brûlé, une femme âgée devenue aveugle, un adolescent — tente tant bien que mal de se reconstruire. Chacun affronte ses traumatismes, ses silences, ses fantômes. Mais certaines expériences demeurent impossibles à partager pour ceux qui ne les ont pas traversées.
JUSTA
Fiction / Portugal, France
BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE
Née à Lisbonne en 1966, Teresa Villaverde est une réalisatrice, scénariste et actrice portugaise, figure majeure du cinéma d’auteur européen. Ancienne actrice chez João César Monteiro, elle passe rapidement à la réalisation avec un regard social très fort. Son premier film, Idade Maior, est présenté en première mondiale au Festival de Berlin en 1989 et reçoit de nombreuses récompenses dans des festivals internationaux. Trois ans plus tard, Maria de Medeiros obtient le Prix de la meilleure actrice au Festival de Venise pour son rôle dans Três Irmãos. La présentation de Os Mutantes au Festival de Cannes, dans la section Un Certain Regard, permet au travail de Teresa Villaverde d’acquérir une large reconnaissance internationale ; le film rencontre un immense succès critique et public au Portugal. En 2017, Colo, présenté à la Berlinale, impose définitivement son cinéma sombre, politique et profondément humain. Le Centre Pompidou lui a consacré une rétrospective en 2019.
ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE
Justa s’inspire des incendies meurtriers de 2017 au Portugal. Pouvez-vous nous raconter sa genèse ?
Nous connaissons des feux de forêt chaque année, souvent terribles mais jamais mortels. En 2017, ce fut différent : des personnes se sont retrouvées piégées sur une route, des maisons ont brûlé, et le pays entier a été sous le choc. Sur le moment, je n’ai évidemment pas pensé à en faire un film. Il n’y avait que de la sidération, pas du cinéma. Environ un an plus tard, j’ai traversé par hasard la zone ravagée par les flammes. Ce que j’y ai découvert dépassait tout ce que j’avais imaginé : des kilomètres et des kilomètres de paysages entièrement calcinés. On s’attend à voir un territoire mort et figé. Mais ce que j’ai ressenti était beaucoup plus complexe. Quelque chose de « mort mais vivant » à la fois, comme si la nature, brûlée mais présente, me regardait. J’étais seule en voiture, et cette vision m’a profondément marquée. J’ai emprunté la route où des gens avaient péri. Le silence qui y régnait était saisissant. Plus d’oiseaux, plus d’animaux, plus aucun bruit. Un silence tellement dense qu’il semblait devenir une présence. Puis, au cours du même trajet, j’ai aperçu une femme assise sur une chaise, seule, au bord d’une route, un peu à l’écart d’un village. Elle contemplait la vallée et la montagne en face d’elle, entièrement brûlées. Je me suis demandé ce qu’elle faisait là, pourquoi elle avait apporté une chaise, à quoi elle pensait, ce qu’elle regardait, si quelque chose de grave s’était produit à cet endroit, ou si elle avait simplement conscience qu’elle ne reverrait peut-être jamais ce paysage tel qu’il était avant l’incendie. J’ai longuement hésité à m’arrêter pour lui parler. Je ne l’ai finalement pas fait. Mais en rentrant à Lisbonne, cette femme et cette image ne m’ont plus quittée. C’est à partir de là que l’idée du film est née.
Pourquoi raconter l’après-tragédie plutôt que le moment même des incendies ? Qu’est-ce que ce « temps d’après » vous permet de montrer ?
J’ai choisi de situer le film après la catastrophe. Représenter le moment même où tout s’est produit, en cherchant à illustrer l’événement, ne m’aurait rien apporté. L’« après », en revanche, est ce qui demeure, ce qui persiste. Et puis, les personnes qui vivent une expérience pareille deviennent, d’une certaine manière, différentes de toutes les autres. Elles finissent souvent oubliées, parce qu’on ne sait plus très bien comment les regarder, et peut-être parce que leur présence dérange. Une chose m’a beaucoup frappée lorsque je suis allée sur place : chaque fois que je demandais aux habitants s’ils envisageaient de partir vivre ailleurs, tous me répondaient non. Pourtant, déjà avant les incendies, beaucoup songeaient à quitter la région. Je pense qu’au moment où je les ai rencontrés, ils étaient encore trop sidérés pour abandonner l’endroit où reposaient leurs morts. C’est cela qui m’a intéressée. C’est sur cette fidélité douloureuse aux lieux, ce lien invisible entre les vivants et leurs disparus que je voulais travailler. Peut-être, d’une certaine façon, mon film est-il un hommage non pas aux morts, mais à ceux qui restent.
Comment avez-vous écrit vos personnages de survivants qui reflètent une dimension universelle du deuil et de la reconstruction ?
J’ai commencé à rencontrer des survivants, en me rapprochant d’associations de victimes. Il y avait des personnes qui avaient perdu des proches, d’autres leurs maisons. Elles m’ont reçu chez elles. J’ai visité plusieurs familles, un an après les incendies en 2018, et beaucoup, surtout les plus jeunes, étaient encore en état de choc. Je me souviens de deux frères et sœurs. Après des heures de conversation, j’ai senti dans leur regard comme une attente impossible, presque l’idée que moi, venue d’ailleurs, j’allais leur dire qu’il ne s’agissait que d’un cauchemar, qu’ils pouvaient rouvrir la porte et retrouver leurs parents vivants. C’était extrêmement difficile à vivre. Je faisais toutes ces visites seule, sans équipe, sans caméra. Je voulais simplement écouter. Les morts étaient encore omniprésents dans leur vie. J’ai ressenti une présence extrêmement forte, comme si les disparus étaient toujours là. Et j’ai compris aussi que mourir dans un incendie n’a rien à voir avec mourir dans un accident. Le feu est une force de la nature, immense, ambivalente. Il détruit, mais il est aussi un élément de notre quotidien. Je pensais que ces gens seraient traumatisés à vie au contact du feu. Mais ce n’est pas si simple. Le feu est partout, il nous sert chaque jour. Cette contradiction crée une confusion très profonde pour ceux qui ont vécu une tragédie pareille.
Comment avez-vous abordé la narration et fondu ces témoignages dans la fiction ?
Lorsque j’ai commencé à écrire, j’ai rédigé plusieurs versions. Au début, j’étais encore trop attachée aux histoires vraies des personnes rencontrées. J’essayais de recomposer une réalité dont je ne connaissais que des fragments. Cela créait beaucoup d’hésitations chez moi. Qu’avais-je le droit de montrer ? Que pouvais-je dire ? J’ai fini par comprendre que ce n’était pas la bonne direction. Il me fallait du temps pour « oublier sans oublier ». Oublier les détails, mais pas la sensation, ni les émotions qu’ils m’avaient transmises. Il subsiste toutefois dans le film quelques petites touches issues de mes rencontres, une phrase entendue ici ou là, que j’ai glissée dans la bouche d’un personnage, mais rien de plus. Après les incendies, le gouvernement portugais a mandaté une université pour réaliser une étude. Elle était publique, sauf un chapitre, inaccessible au grand public et auquel j’ai eu accès. C’était terrifiant, il décrivait des détails concrets, insoutenables. Par exemple, à la fin du film, lorsque le personnage de la veuve raconte comment son mari est mort sur la route, je n’ai rien inventé. Tout venait de ce rapport. En revanche, j’ai décidé de dépouiller le scénario de tout ce qui était accessoire, de retirer le quotidien, de ne garder que l’essentiel. Dans le film, il n’y a pas de voisins, pas de café, presque aucune activité ordinaire. Les personnages sont isolés du monde. Je tenais à cela parce que les personnes qui ont vécu de telles tragédies – incendies, guerres, catastrophes -, ne redeviennent jamais tout à fait comme les autres. Elles portent en elles quelque chose d’irréversible. Le cinéma n’est pas la littérature. À l’écran, tout devient concret. J’ai donc cherché une forme qui permette au spectateur non pas d’observer les personnages comme à travers une fenêtre, mais de partager avec eux une expérience sensible, presque physique. Le montage a été très éprouvant. J’ai recommencé à maintes reprises avant de trouver l’équilibre que je cherchais. Aujourd’hui, j’ai le sentiment – peut-être est-ce une illusion ?-, d’avoir pour la première fois maîtrisé tout ce qui devait l’être, d’être parvenue à une forme de justesse.
Comment avez-vous choisi les acteurs qui incarnent ces êtres traumatisés ?
Les personnes que j’ai rencontrées ne sont ni impliquées directement dans le film, ni représentées à l’écran. Il y a toutefois un acteur non-professionnel, Ricardo Vidal qui incarne le père de Justa, dont le corps porte de très lourdes brûlures. Mais celles-ci proviennent d’un accident survenu de nombreuses années auparavant, sans aucun lien avec les incendies. Ce n’est donc pas un survivant de la tragédie. Je l’ai découvert grâce au livre qu’il avait écrit sur sa reconstruction, physique et psychologique. Je l’avais aussi vu dans une émission de télévision où il apparaissait aux côtés de son père malade. Il avait un regard d’une intensité rare, le regard de quelqu’un de très jeune mais qui avait déjà traversé beaucoup. Il portait en lui une forme de douleur muette qui m’a bouleversée. Lorsque je travaille avec des non-professionnels, c’est toujours la personne que je cherche. Le regard qu’elle me donne, la présence qu’elle dégage et que je peux retrouver ensuite sur le tournage. Pour le casting de Justa, j’ai délibérément cherché de jeunes interprètes vivant plutôt à l’intérieur du pays, en dehors de Lisbonne et de Porto. J’avais l’intuition que j’y trouverais des enfants différents, moins formatés, et je suis très heureuse de cette décision. Madalena Cunha est magnifique. Ce n’est pas non plus une actrice professionnelle. Le seul rôle tenu par une actrice professionnelle est celui de Betty Faria, une immense comédienne brésilienne qui joue la femme aveugle. Au début, j’ai hésité. Son origine brésilienne me semblait peut-être un obstacle. Puis j’ai compris que ce qu’elle représentait était universel. Ce dont j’avais besoin, c’était d’une grande actrice comme elle. Et à 84 ans, sa force, sa présence sont exceptionnelles. Travailler avec elle fut magnifique. L’entente entre Betty, cette légende du cinéma, et les autres interprètes non-professionnels s’est faite naturellement, dans une simplicité totale. Tous, acteurs comme techniciens, savaient que nous touchions à quelque chose d’essentiel. Une solidarité immense régnait sur le plateau. Et bien qu’il s’agisse du sujet le plus difficile sur lequel j’ai travaillé, paradoxalement, le tournage fut l’un des plus simples.
Le personnage de la psychologue montre l’impossibilité de saisir un traumatisme quand on n’y a pas été directement exposé, mais aussi la difficulté de réparer. S’agit-il de votre alter ego dans l’histoire ?
Si je veux être totalement honnête, je pense qu’une part de moi se trouve dans ce personnage. Mais, comme toujours, je ne m’en suis rendue compte qu’après coup et même très récemment en réalité. Comme ce personnage, quelque chose m’a attirée vers cet endroit, et puis je suis restée, sans vraiment pouvoir agir, sans pouvoir changer quoi que ce soit. Il y a donc forcément des choses de moi dans ce personnage. Peut-être même que le personnage de la psychologue porte, lui aussi, une part de moi, mais ce n’était pas intentionnel.
Le paysage ravagé joue un rôle central dans votre histoire. Comment avez-vous pensé cette nature, mais aussi le rapport entre environnement et responsabilité humaine ?
Dans le film, on voit en effet que Justa ressent profondément l’injustice. Elle dit que, malgré tout ce qui s’est passé, cela ne l’empêche pas de continuer à aimer la nature. Et cela est très important. Les survivants ne la blâment et ne lui font pas porter la culpabilité. La nature est là, immense, elle englobe tout. Pour les gens qui vivent dans ces lieux, avec une forêt juste à côté, la nature est tout. Chez Justa, sa présence est essentielle.
Vous représentez cette nature de manière très sensorielle…
Oui et je crois que cela passe par les images, bien sûr, mais aussi énormément par le son. Et pour le son, il faut vraiment voir le film en salle, sinon on ne perçoit pas toutes les nuances, tout le travail de composition sonore très approfondi, vibrant et beau. Les animaux sont revenus. On a capté beaucoup de traces, de signes de leur présence : des oiseaux, ceux qui peuplent la nuit, des loups… Toute cette vie revient.
Cette sensorialité culmine dans la séquence en point de vue subjectif où la femme aveugle évolue dans un décor dévasté. Comment avez-vous conçu cette séquence ?
Au début, c’était assez difficile de décider comment filmer cette scène, parce qu’il s’agit du point de vue subjectif d’une femme aveugle. Nous avons finalement inversé la lentille de la caméra, fixée sur l’objectif. C’est quelque chose qu’on ne fait jamais, une sorte de manipulation un peu folle. L’idée était de créer une forme d’étrangeté, une perception troublée qui fasse que le spectateur ne se pose pas trop de questions techniques, mais avance simplement avec cette femme. Peu importe, au fond, si ce point de vue est vraiment subjectif, ou si c’est une sensation, ou même une sorte de mémoire de l’espace qu’elle pourrait « voir » de cette manière. On entend sa respiration, on est avec elle. La manière dont c’est filmé permet aussi d’imaginer que ce pourrait être une réminiscence, une mémoire visuelle. Mais en tout cas, c’est un point de vue volontairement étrange.
Pouvez-vous nous parler de votre travail avec le directeur de la photographie Acácio de Almeida qui donne l’impression que cet environnement est hanté ?
Acácio a quelque chose de magnifique : comme il vient de la pellicule, il a un rapport très profond à la lumière. Aujourd’hui, depuis le passage au numérique, les gens ne s’intéressent plus vraiment à la lumière. Or Acácio, lui, travaille exactement comme si nous tournions en pellicule. Nous avons déjà beaucoup collaboré ensemble par le passé et avec lui, il y a toujours une recherche très picturale qui se retrouve dans le choix des objectifs, des textures, de la densité de l’image. Nous avons mis en place sereinement tout ce que nous avions imaginé pendant la préparation. Ce qui comptait, c’était d’entrer immédiatement dans une forme de magie, ou du moins d’une étrangeté faite d’ombres, de couleurs fortes, de noirs profonds. Puis, parfois, d’ouvrir vers des zones moins obscures. Peut-être quelque chose qui rappelle certaines images du cinéma ancien, des années 50, les débuts de la couleur, le Technicolor. Il était crucial d’entrer dans un monde et d’y rester. Et c’est la lumière qui nous permettait de tenir ce fil-là.
Dans votre filmographie attentive aux êtres blessés, que représente Justa pour vous ? S’agit-il d’un geste de deuil collectif, d’un appel à la conscience ?
Après tout ce que j’ai vu, je comprends aujourd’hui que ce film était une nécessité. Et maintenant que je le présente au Portugal, je sens à quel point il résonne : les spectateurs y voient quelque chose dont on doit parler, quelque chose qui exige d’être pensé. Mais pour moi, avant tout, ce film est né d’une urgence intime, née de la rencontre avec ces personnes et de ce qu’elles m’ont confié. C’est un film qui porte une responsabilité immense : envers elles, envers leur histoire, et envers ceux qui la reçoivent.