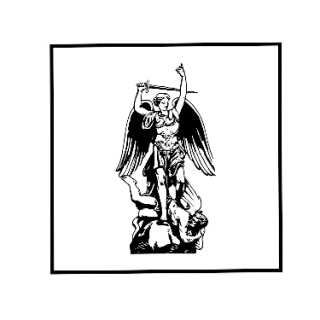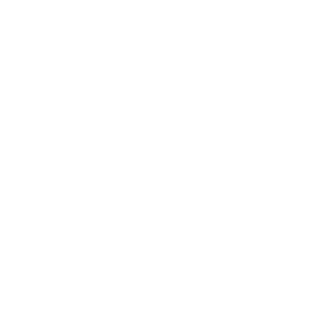Alors qu’elle est enceinte, Kika perd brutalement l’homme qu’elle aime. Complètement fauchée, elle en vient à vendre ses petites culottes, avant de tenter sa chance dans un métier… déconcertant. Investie dans cette activité dont elle ignore à peu près tout, Kika entame sa remontée vers la lumière.
Kika
Fiction / France, Belgique
BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE
Alexe Poukine est une réalisatrice, actrice et scénariste. Après avoir suivi des cours d’art dramatique, elle a étudié l’anthropologie, la réalisation documentaire puis l’écriture scénaristique. Ses documentaires, DORMIR, DORMIR DANS LES PIERRES, SANS FRAPPER et SAUVE QUI PEUT (sortie en salles le 4 juin 2025) ont gagné de nombreux prix dans des festivals prestigieux. En 2020, elle réalise PALMA, dans laquelle elle joue le personnage principal. Ce moyen-métrage a notamment remporté le Grand Prix du festival de Brive et le Prix du jury au festival de Clermont Ferrand. KIKA est son premier long-métrage de fiction.
ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE
Pourquoi ce prénom Kika ? Est-ce une référence au film éponyme de Pedro Almodóvar ?
Pour dire la vérité, je n’ai pas vu ce film … Kika, c’est un prénom que j’adore. Si j’avais eu une seconde fille, j’aurais aimé l’appeler comme ça. Lorsque j’écrivais le film, j’ai eu un fils, alors j’ai appelé mon film-fille Kika. Nous avons cherché pendant longtemps un autre titre. Généralement, tous mes films changent de titre pendant la dernière semaine de montage, pas celui-là.
Vous avez réalisé des documentaires ainsi qu’un moyen métrage de fiction (PALMA). Qu’est-ce qui vous décide à adopter un genre cinématographique ou un autre, même si les deux sont intimement liés dans votre cinéma ?
En effet, mes films jouent souvent avec la frontière entre réalité et fiction. Dans mes documentaires, il y a souvent un dispositif fictionnel qui préexiste ou pas au tournage.
Dans PALMA, il y a une grosse part de « reenactment » : je remets en scène une histoire qui m’est arrivée avec ma fille, en poussant les curseurs de la fiction. J’ai commencé à écrire Kika quand j’étais enceinte de mon second enfant. À l’époque, j’avais très peur que son père meure. J’avais déjà vécu seule avec ma fille et je savais ce que cela implique comme précarité. C’était une façon pour moi d’exorciser cette crainte. Je me suis demandé comment je pourrais m’en sortir financièrement sans arrêter de réaliser des films. Parce que l’idée du travail du sexe m’a traversé l’esprit, j’ai mêlé à cette histoire celle d’un ami qui, comme Kika, est dominateur et assistant social. Il a fait plusieurs burn-out à cause de la pression de son premier métier puis à cause de celle du second. J’ai trouvé passionnant qu’il prenne soin des gens soit en leur faisant mal, soit en leur faisant du bien. Mais dans les deux cas, la demande est tellement énorme, et constamment renouvelée, il y a tellement de personnes qui ont besoin d’être aidées et prises en charge que cela conduit à un épuisement professionnel, et au désespoir de ne pas réussir à soulager toutes celles et ceux qui le demandent. Ce que je trouve passionnant, c’est la façon dont les gens essaient de trouver un chemin, parfois peu banal, pour réduire la souffrance.
Mon histoire fantasmée s’est donc mêlée à celle réelle de mon ami et c’est comme ça qu’est née Kika. C’est un mélange. Par la suite, j’ai fait beaucoup de recherches sur les dominatrices et sur les travailleuses du sexe en général.
J’ai aussi suivi des ateliers de BDSM et j’ai intégré dans le scénario les récits que j’ai glanés au fil de ces expériences.
En quoi a consisté cette recherche documentaire ?
On n’a pas la même conception du travail du sexe en France et en Belgique où il est décriminalisé. Je me suis concentrée sur la Belgique où je vis. J’ai contacté des associations, comme UTSOPI et Espace P et j’ai fait de longs entretiens avec des travailleuses du sexe qui ont des pratiques et des conditions de travail extrêmement différentes. Les dominatrices que j’ai rencontré m’ont souvent dit qu’elles faisaient aussi ce travail par tendresse et par respect pour les hommes. Car pour accepter d’endosser « le rôle du dominant », il faut être très précautionneuse et attentive, et aimer profondément les gens car le métier exige d’aller dans des zones complexes de l’âme humaine.
Un dominateur et une dominatrice ont relu le scénario. Cette dominatrice qui est aussi une performeuse très reconnue a trouvé que je n’étais pas suffisamment précise quant à la psychologie des clients. Grâce à son retour, mon regard sur eux a évolué. Il était important aussi de ne pas réaliser un catalogue de pratiques BDSM sensationnalistes.
Avec Thomas Van Zuylen qui a collaboré à l’écriture du scénario, nous avons choisi de renoncer à plusieurs séquences signifiantes et/ou étonnantes d’un point de vue documentaire, mais qui n’étaient pas suffisamment liées à la trajectoire personnelle de Kika
Le film évite cet effet catalogue dont vous parlez. Vous avez un regard bienveillant envers les clients et vous n’êtes pas dans une logique de gradation vers le sordide, comme c’est souvent le cas dans les films qui s’inscrivent dans le milieu de la prostitution.
En France, où il existe un important courant «abolitionniste», les retours de commission étaient souvent les mêmes : ce n’est pas possible qu’elle devienne travailleuse du sexe. Dans de nombreux films autour de cette question, l’héroïne est déjà travailleuse du sexe. Leur approche est presque essentialiste, comme si on naissait travailleuse du sexe. C’est vraiment la maman ou la putain.
Les gens ont du mal à s’imaginer qu’on puisse être les deux, et qu’on puisse être énormément d’autres choses. Il y a aussi pour moi un aspect moral qui est très problématique dans la façon de représenter les travailleuses du sexe, c’est-à-dire toujours comme des victimes. Cette représentation se calque sur une imagerie du conte pour enfant où la princesse attendrait d’être sauvé par un tiers (masculin bien sûr). Et cette représentation a des effets sur le réel puisqu’elle crée des lois. Les travailleuses du sexe sont souvent présentées comme un contre-exemple. On ne veut pas croire qu’une femme puisse décider de dépasser, voire même d’embrasser le stigmate associé à la prostitution. Ce qui est transgressif, je crois, c’est qu’une femme se fasse payer pour des services sexuels que d’autres choisissent d’offrir gratuitement. Pour Kika, je parle d’une femme qui me ressemble et qui choisit un métier que j’aurais pu faire si j’en avais eu besoin.
De la même façon, par rapport à la représentation des clients, j’avais envie de filmer des hommes qui n’épousent pas les normes de genre masculines hétérosexuelles.
Je voulais montrer des personnes qui font appel à une travailleuse du sexe pour des raisons bien plus complexes qu’un soi-disant désir pulsionnel masculin. Dans cette dynamique de pouvoir, où un partenaire assume un rôle dominant et l’autre un rôle de soumission, Kika joue avec les normes patriarcales. C’est une petite subversion que j’avais envie de voir au cinéma. Dans le paysage global, je trouve que ça fait du bien.
Mais ce qui m’intéresse dans ce film, c’est moins le travail du sexe que la relation à la souffrance et le rapport au rôle : dans quelle fonction on se met et qu’est-ce qui se passe quand on se met dans la position inverse ? Pour moi Kika fait semblant pendant tout un temps puis, elle est finalement rattrapée par le jeu auquel elle joue. C’est une thématique qui traverse tous mes films.
Oui cette question est omniprésente dans votre cinéma, comme celle de la simulation : on se glisse dans la peau d’un autre, on simule une scène, on la répète, la rejoue, on exorcise quelque chose. Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce mouvement cathartique ?
Par rapport à l’interprétation, je ne suis pas certaine de saisir tout à fait ce qui me fascine autant. C’est certainement la raison pour laquelle je continue à faire des films qui tournent autour de ce sujet.
Et par rapport à la réalisation, je crois qu’il s’agit pour moi d’une manière de mettre la vie en boîte, de la rendre regardable. Je pense que je fais du cinéma parce qu’il est beaucoup plus appréhendable que la réalité. J’ai fait un film sur les gens qui meurent dans la rue, un film sur un viol, un film sur l’hôpital public et un film sur une mère célibataire qui pète un plomb. Ce sont des films étrangement assez lumineux, je crois, alors que leurs sujets sont durs.
La structure du film est très étonnante. En trente minutes, il se passe beaucoup de choses, l’exaltation d’une rencontre amoureuse, la mort brutale d’un conjoint. J’ai le sentiment que ça vous permet de placer l’intériorité de votre personnage, sa vie intime, sa personne au centre de tout, avant toute considération sociale pour éviter un schéma de mère courage dont l’humanité serait devancée par ce type de considération.
Oui, c’est pour ça que je voulais commencer par une grande histoire d’amour. Kika est quelqu’un qui prend le risque de partir pour quelqu’un d’autre alors qu’elle n’est pas sûre que ça marche, elle prend le risque de casser un couple qui dure depuis son adolescence. Je voulais que le film commence comme une comédie romantique et que tout d’un coup, on bascule vers quelque chose de plus grave. Le mélange des genres m’intéresse. Souvent dans la vie, on croit qu’on est en train de vivre une comédie romantique, et puis, d’une minute à l’autre, ça se transforme en drame social, et il faut faire avec Je n’aime pas trop les films qui choisissent entre les rires et les larmes. En général, la vie ressemble plutôt à une comédie dramatique ou un drame comique. Je voulais que mon film ressemble à ça. Et je souhaitais en effet que Kika ne soit pas réduite à une identité socio-professionnelle ou à son rôle de mère, ou à l’histoire d’amour qui la percute. Les images de femmes venant de milieux sociaux précaires, qui ne sont que des mères courages … C’est sûrement très bien qu’il en existe mais moi je ne veux pas faire ça.
Est-ce que le fait de ne pas insister sur ces détails-là vous permettait aussi de dire que cette précarité, ou la menace de cette précarité, concerne toutes les femmes ?
Oui c’est sûr. En France, plusieurs études ont montré que de nombreuses familles monoparentales vivaient sous le seuil de pauvreté. Et les mères célibataires en particulier subissent une précarité quasi structurelle. Donc oui, je pense que ça peut arriver à pratiquement toutes les femmes. Kika, ça pourrait être moi. A part que je suis réalisatrice même si ma grande-tante numérologue avait prédit que je serais assistante sociale, ce qui m’angoissait beaucoup pendant mon adolescence ! C’est aussi pour ces raisons que Kika est assistante sociale.
Y a-t-il eu des images de cinéma, des personnages féminins qui ont nourri votre écriture ?
Erin Brockovich. C’est une femme dans la dèche, qui est très consciente de ce qu’elle est et de ce qu’elle représente. J’aime beaucoup aussi Maren Ade. J’ai adoré Toni Erdmann, qui est à la fois drôle et réaliste avec des personnages hauts en couleur. J’adore aussi Andrea Arnold, c’est vraiment mon héroïne. Ses personnages féminins sont toujours magnifiques.
Vous parliez de la tristesse, de la manière dont Kika vit son chagrin avec une certaine distance. Si Kika ne pleure pas, n’est-ce pas parce que justement elle n’a pas les conditions matérielles et financières suffisantes pour faire son deuil, qui apparait alors comme un privilège.
Oui bien sûr, je pense que c’est un luxe de pouvoir faire « un travail de deuil », comme on dit. Si c’est réellement un travail, ça veut dire qu’il faut avoir le temps et la disponibilité de le faire. Pour Kika, c’est vrai qu’il y a des contingences matérielles qui font qu’elle ne peut pas s’arrêter pour réfléchir à elle-même et pour pouvoir pleurer, et en même temps, je crois aussi que c’est comme si elle organisait un nuage de fumée. Il y a un double mouvement. Je pense qu’elle se lance dans une espèce de sur-vie. Elle est constamment en sur-régime.
Ce deuxième métier qu’elle trouve est tellement énorme qu’il requiert toute son énergie et fait barrage à sa tristesse. D’une certaine façon, elle se sert de ce travail pour ne pas être malheureuse. Parce qu’elle a peur de s’écrouler. Pour moi Kika, c’est quelqu’un qui court pour ne pas tomber. C’est aussi tout simplement l’histoire de quelqu’un qui a besoin de pleurer.
À la fin, il y a une scène où tout d’un coup elle s’autorise enfin à pleurer. Mais elle y est presque contrainte.
C’est aussi un film sur la consolation, sur la vulnérabilité.
Tous ces hommes, ces clients qui se mettent entre ses mains… Si elle est du côté de la domina, c’est aussi parce qu’elle ne veut pas être du côté des vulnérables. Elle veut contrôler. Je trouvais ça hyper beau de voir quelqu’un qui comprend petit à petit, et grâce aux autres, que sa force n’est pas dans le camp du pouvoir, mais du côté de la fragilité.
Dans le film, il y a un personnage secondaire qui est une vieille dame aux dons de voyance, sans argent, menacée d’être expulsée de chez elle. C’est une projection de ce que pourrait être Kika ?
Oui c’est comme un repoussoir pour elle. C’est à la fois quelqu’un qu’elle veut aider, et en même temps, quelqu’un qui est un peu ce qu’elle pourrait devenir.
J’imaginais cette femme comme une femme de médecin qui aurait fait comme font beaucoup de femmes médecin : c’est-à-dire qu’elle les assiste, les aide, sans être rémunérées. Et puis un jour le mari part et part avec toute la vie de ces femmes. Il part en les laissant sans moyens, sans reconnaissance. J’imagine que c’est ce qui s’est passé avec cette femme. Le fait qu’elle ait des dons de voyance me permettait d’échapper un peu au naturalisme social. J’avais envie qu’il y ait un peu de magie dans le film. Il y en avait beaucoup au scénario, au tournage.
Le film est parsemé de petits détails qui pourraient paraître banals mais qui ne le sont pas et qui désamorcent des attendus : l’absence de conflit avec l’ex-compagnon ; la complicité avec cette vieille dame dans le café quand Kika rencontre son premier client. On pourrait attendre un conflit de génération, un écart mais c’est tout l’inverse qui se produit.
On n’arrête pas d’apprendre aux scénaristes que le nerf de la guerre c’est le conflit. On a l’impression de vivre dans un monde entouré de gens atroces. Or, en tout cas d’après mon expérience, je trouve que les gens sont quand même globalement merveilleux. C’est peut-être parce que je suis documentariste aussi et que je rencontre beaucoup de gens que je trouve super. Je passe ma vie dans les cafés à écrire, je croise beaucoup de gens très intelligents, surprenants, j’en rencontre tous les jours. Ce sont ces gens-là que j’ai envie de voir au cinéma. Je n’ai pas envie que le cinéma me désespère de l’humanité sous prétexte que ça rende le film plus conflictuel et donc plus attractif. Je trouve ça dégueulasse. J’ai envie de filmer des gens que j’aime.
La question de la violence, de l’oppression dans le film est passionnante puisqu’elle n’est pas tout à fait là où on croit. Dès le premier plan du film, quand Kika rentre dans son bureau elle est alpaguée par un homme qui se montre virulent à son égard. Quand elle perd son conjoint, il y a cette scène d’après enterrement où les gens s’approprient son chagrin et ce plan sur cette étreinte forcée qu’un homme lui donne. Kika a un léger mouvement de recul, de rejet.
Ce n’est pas comme ça que je l’ai vue mais c’est intéressant. Pour moi, la violence du film est au départ une violence institutionnelle, c’est pour ça qu’on commence sur le travail d’assistante sociale. C’est aussi parce que je viens de finir un film sur l’hôpital public et que j’ai l’impression qu’on demande aux gens qui prennent soin, aux soignants et aux travailleurs sociaux, d’être dans la bienveillance alors qu’on ne leur donne jamais les moyens financiers de l’être, d’aider les gens. C’est d’une violence et en général ce sont les femmes qui s’y collent, parce que c’est elles qui sont dans le care. Je pense en effet que c’est le BDSM qui a inventé le consentement : tout est négocié, tout est un contrat. Je trouvais ça hyper beau que contrairement à ce qu’on attend, la violence ne soit pas du côté de son travail du sexe même s’il y a de la brutalité, une forme de violence physique mais pas psychique. Par rapport à l’ami de David qui la prend dans ses bras, en effet il ne lui demande pas son consentement mais ce que je vois dans cette séquence c’est quelqu’un de blindé. C’est un peu le pendant de la séquence avec Racha à la fin, elle pourrait craquer mais elle ne craque pas.
Il y a dans le film une scène très drôle de mansplaining avec une histoire d’invention de pâtes à la tomate…
Ce matin, je montrais dans un festival des séquences coupées du film. Cette séquence de mansplaining dure douze minutes, c’était une impro de génie de Bernard Blancan, elle sera dans les bonus du film. À la fin, il fait une crise d’angoisse parce que Kika et sa fille n’arrêtent pas de bouger les objets, c’est à mourir de rire. Un personnage comme ça on en connaît tous. Ça m’amusait d’avoir des personnages d’hommes un peu à la ramasse.
Dans votre cinéma, les espaces confinés, en huis clos sont les espaces où la parole peut circuler librement. C’est aussi un peu le cas dans KIKA, où vous comparez d’ailleurs une rencontre amoureuse à une séquestration. Pourquoi ce motif ?
Vous avez raison mais je ne l’ai jamais conscientisé.
C’est vrai que dans mes films, il y a toujours une espèce d’ambiguïté. Dans SANS FRAPPER par exemple, je filme des gens qui sont chez eux. L’espace de l’intimité est un espace que l’on pense être safe et en fait la plupart des viols ont lieu à domicile. Pour SAUVE QUI PEUT, c’est l’hôpital, c’est le lieu du care et en même temps c’est la même chose : c’est aussi le lieu d’une violence institutionnelle terrible. Ce qui est sûr c’est que ça m’amusait beaucoup dans cet hôtel de discrétion comme on les appelle, qu’il y ait à la fois des couples adultères et des travailleuses du sexe avec des clients. C’est un lieu où il y a beaucoup de passage.
On a loué un étage mais le lieu était encore en activité, la plupart des sons de baise sont vrais. Ces hôtels sont à côté du parlement européen. Ce sont des endroits de secrets. Je pense qu’il y a des gens qui vivent la meilleure partie de leur vie dans ces endroits fermés et en même temps qui sont des espaces où il y a beaucoup de passage. Ça m’intéressait.
Vous aviez déjà connaissance de ces lieux avant le film ?
Oui, j’en connaissais quatre, cinq. C’est assez dingue quand on commence à s’intéresser au sujet de voir le décalage entre ce que les gens montrent et ce qu’ils font, ce qu’ilscsont. C’est un endroit un peu fascinant.
Comment avez-vous rencontré la comédienne Manon Clavel ? Vous pensiez déjà à elle au moment de l’écriture ?
Pendant très longtemps je me suis demandée si je n’allais pas jouer le rôle. Mon producteur François Pierre Clavel qui est mort pendant le processus du film me poussait aussi pour que je joue dedans. Je pense que le film est un peu une suite de PALMA. Puis Youna de Peretti qui était directrice de casting France dans le film m’a dit : vu le sujet vous ne serez pas de trop à être deux à le porter. J’ai compris qu’elle avait raison. J’ai vu un nombre de comédiennes en France, en Belgique et même au Québec hallucinant. On a cherché pendant presque deux ans. J’ai vu des inconnues, des personnes très connues. Manon Clavel s’appelle Clavel comme mon producteur que j’adorais et qui est mort.
Quand Youna m’a proposé de la voir j’ai eu un petit haut-le-cœur. Je pensais qu’elle était trop jeune pour le rôle, trop belle. Mais quand je l’ai vue c’était une évidence. Elle est rentrée, je savais que c’était elle. Elle est d’une gentillesse incroyable. Je voulais que ce soit quelqu’un de gentil, que je puisse m’identifier à elle. Vu son parcours, son chemin peu orthodoxe, étrange, je me suis dit : les gens vont se désolidariser d’elle. C’est pour ça que c’était important qu’elle soit attachante, qu’elle ait un sens de l’humour proche du mien pour qu’elle comprenne là où je voulais l’emmener, quelqu’un n’ait pas peur de me suivre parce qu’il y avait quand même des séquences compliquées. Elle l’a fait avec une confiance, un professionnalisme et une rigueur impressionnants. Pour moi, elle porte entièrement le film.
Vous parliez du lien entre PALMA et KIKA. Est-ce que l’autre lien entre les films, c’est cette injonction au bonheur qu’on nous vend et qui est incarnée, dans KIKA, par ce moment où elle est dans un appartement Airbnb et qu’elle regarde le frigo de l’appartement avec toutes ces photos d’un bonheur familial épanoui ?
Oui complètement. J’ai l’impression que les gens sont dans un Instagram constant. Entre ce qu’ils sont et leur image, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. L’idée de PALMA était de dire que tout ceci commence très tôt, à la maternelle avec ces carnets qui sont comme des Facebook pour enfants où on doit faire semblant qu’on est merveilleux et que la vie est super à tout moment alors que ce n’est pas vrai. C’est la même chose pour la maternité, on nous vend en permanence la maternité tout bonheur. Pendant des décennies, les mères au cinéma avaient l’air de kiffer en permanence. La maternité c’est super mais c’est aussi très dur. Les mères sont les pires perdantes de l’histoire de cette société. On te fait croire que tu vas pouvoir travailler, être mère et être tellement épanouie. C’est un mensonge total. Personne n’en parle.
Tu le découvres le premier jour de la vie de ton enfant, tu comprends que le patriarcat va te dévorer.
CE QU'EN DIT LA PRESSE
Libération
Le film est passionnant comme piège et libération, Kika se relève en s’écroulant, pour tenir, comme elle fait son deuil, sans s’épancher. La vérité, c’est que si elle fond en larmes, ce ne sera pas sous les coups, mais sous les caresses.
L’Humanité
Accroché à sa formidable actrice Manon Clavel, le premier long métrage de fiction d’Alexe Poukine, en salle ce mercredi 12 novembre, s’avère être une dynamite émotionnelle.
L’Obs
Aucune faute de goût dans cette comédie étranglée où tout, du point de vue solidaire de la réalisatrice et la ténacité féroce de sa mise en scène au jeu combatif de Manon Clavel, enjambe les (nombreux) pièges tendus par son sujet. Et, surtout, zéro jugement moral dans ce bouleversant manifeste féministe.
Première
Et ce récit de cette reconstruction vraiment pas comme les autres s’appuie aussi sur une interprète capable d’épouser ce roller coaster émotionnel sans jamais tomber du manège : Manon Clavel. Sa virtuosité et son naturel entremêlés en font la co- créatrice de ce personnage éminemment complexe et incroyablement attachant.
Positif
Film d’une audace singulière, Kika signe l’entrée en force d’Alexe Poukine dans le long métrage de fiction.
Les Fiches du Cinéma
Une mise en scène saisissante pour montrer une vérité peu mise en valeur au cinéma : une femme, comme un homme, a des pulsions. Celles de Kika déclenchent en elle et en nous des émotions très fortes. Chapeau à l’actrice Manon Clavel qui les porte comme des évidences !
Abus de Ciné
Un drame intimiste formidablement humain, qui vous prend forcément aux tripes et a de fortes chances de vous arracher quelques larmes.