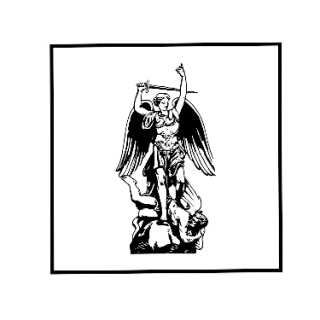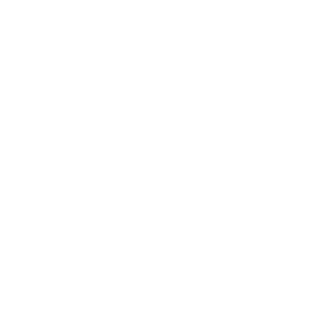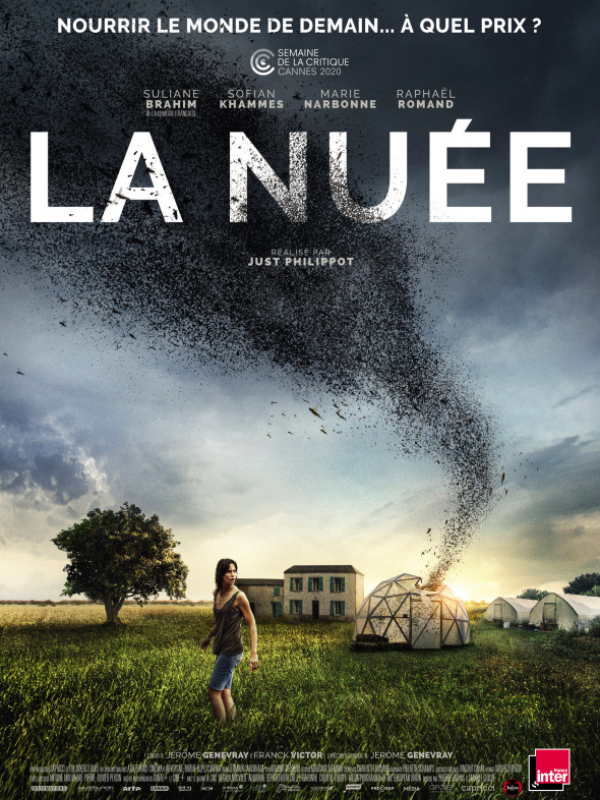Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles…
LA NUÉE
Fiction / France
Jeu 30 : 20h00
Séance spéciale suivie d’un échange avec Carlos Tello. Séance organisée dans le cadre du ciné-club “ Image et Parole”.
L’AUTEUR
Né en 1982 en région parisienne, Just Philippot obtient en 2007 un master en cinéma à la Faculté de Paris VIII. Scénariste et réalisateur, il est l’auteur de quatre courts métrages dont Ses Souffles et Acide, présélectionnés aux César. La Nuée est son premier long métrage.
ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR
Qu’est-ce qui vous a plu dans le scénario de La Nuée ?
Ce qui m’a intéressé dans cette histoire, c’est qu’il s’agissait d’un film d’aujourd’hui, un film qui, à travers sa dimension fantastique, parlait de nous directement, du grand déséquilibre qui affecte le monde et l’agriculture en particulier. Ce déséquilibre est lié essentiellement à une cause : celle de produire pour moins cher. Tout commence lorsque Virginie com – prend qu’il faut donner quelque chose en plus à ses sauterelles. Ce n’est pas des pesticides, ce n’est pas de la nourriture, c’est une part d’elle-même. C’est en s’abandonnant complètement à sa production qu’elle fait exploser son rendement. Dès lors, se met en place un terrible engrenage dont l’issue ne peut être que violente.
Ce sacrifice, pourquoi Virginie n’en a pas conscience ?
Elle n’en a pas conscience parce qu’elle a toutes les bonnes raisons du monde de le faire. Elle a une famille à nourrir, il faut payer l’école, il faut payer le loyer… Elle est seule, elle a envie de réussir. Elle ne se rend pas compte du sacrifice parce qu’elle le fait pour les autres. Et puis, elle a envie de prouver que l’élevage d‘insectes comestibles c’est l’agriculture de demain.
Est-ce qu’il n’y a pas un paradoxe à ce que cet élevage du futur, avec ces sauterelles hyper-protéinées, la conduise aux mêmes résultats que l’agriculture d’hier ?
Je dirais même que c’est le motif du film. Elle est soi-disant pionnière dans une industrialisation qui semble être une agriculture propre parce qu’elle nécessite très peu de ressources et de moyens pour pouvoir subsister. En vérité, on est dans un système qui, lui, n’a pas changé. Le produit étant de bonne qualité, il est trop cher pour être vendu. Il faut donc absolument maîtriser les coûts de production et les prix de vente. C’est cette course vers le petit profit, le profit pas cher, qui fait que cette femme rentre dans un engrenage. Un engrenage auquel elle n’avait jamais pensé parce qu’elle était justement cen – sée raisonner ses actes, ses gestes et son temps de travail.
Le film étant très réaliste de ce point de vue, il est davantage un film d’anticipation qu’un film de science-fiction…
On ne pouvait pas se permettre de faire basculer le réalisme dans un fantastique trop poussé. J’avais envie de garder ces sauterelles mutantes accrochées à quelque chose de plus réel, de plus commun. Me recentrer sur une mécanique de gestes et de travail et éprouver un personnage au cours d’une journée qui n’en finit plus. Le fantastique affleure car le sang de Virginie change le métabolisme des sauterelles, il les dope littéralement. Mais ce fantastique rejoint la réalité car ce sang est en fait une amphétamine, comme on nourrit du poulet en batterie, jusqu’à engendrer très rapidement une série de catastrophes. En fait, c’est une sorte de film catastrophe.
Plus qu’un film fantastique ?
Oui, parce qu’il y a cette femme au centre qui ne cesse de se donner, de se sacrifier le plus normalement du monde. Ça commence comme un thriller agricole, puis une fois la limite franchie, on atteint un point de non-retour et on tombe dans le film catastrophe.
Comment tourne-t-on avec des sauterelles ?
C’est marrant parce que, moi, les sauterelles, ça ne me faisait pas peur. J’ai une aversion, comme à peu près tout le monde, pour les araignées, les serpents… ce type d’insectes ou de reptiles. Ce qui m’a intéressé avec les sauterelles, c’est le motif du nuage, du nombre, plus que celui de l’insecte seul. C’était la forme de ce nuage, de cette nuée, d’une masse indomptable. Elle est devenue un personnage à part entière. On a créé un élevage de sauterelles spécialement pour le film. L’éleveur a acheté mille sauterelles qui ont pondu des œufs, qui sont devenues à leur tour trois ou quatre fois plus nombreuses, ainsi de suite… Une sauterelle adulte ne vit que quelques semaines, il fallait donc avoir un roulement pour tenir la distance, entre celles qui ont pondu et celles qui ont grandi. Pour être précis, pour les connaisseurs, ce ne sont pas des sauterelles mais des criquets migrateurs. C’est un insecte qu’on peut acheter dans les animaleries, à la différence des sauterelles.
C’est un film avec des effets spéciaux très différents : entre les effets de plateau, les effets de maquillage et les effets numériques. C’était un défi pour la mise en scène ?
L’équilibre des effets est parfois compliqué parce qu’ils ne cohabitent pas forcément bien ensemble. Je pense notamment à la scène du réveil de Virginie quand elle s’est blessé le bras et que les sauterelles vont boire son sang. Dans cette scène, on a trois types d’effets qui posent trois questions différentes. D’abord, l’effet de blessure : quel type de plaie et combien de sang ? Ensuite, l’effet des sauterelles qui pose deux questions : combien de sauterelles réelles place-t-on sur son bras ? Combien de sauterelles numériques doit-on ajouter dans la serre ? Ce mélange d’images de nature différente et de défis techniques sur un temps réduit est une équation complexe à résoudre. Autre exemple, la séquence du lac. On avait une simple barque pour composer plusieurs scènes d’action autour d’une nuée de sauterelles virtuelles qui attaquent. Ce type de séquence ne peut pas s’improviser au tour – nage : elle est totalement « mise en scène » (cadre, lumière, fond vert…) dès l’écriture. La finesse du jeu d’acteur devient alors un vrai défi. Mais je dois avouer que Suliane, Sofian et les enfants s’en sont parfaitement sortis.
Les effets sont très réalistes, totalement intégrés à l’histoire…
Le superviseur VFX, Antoine Moulineau, a compris assez vite que je voulais quelque chose de sobre et éviter de faire du spectaculaire pour le spectaculaire. On a donc disséminé les effets tout au long du film, pour que le spectacle de la fin ne soit pas disproportionné par rapport au reste. L’histoire qu’on voulait raconter, c’était avant tout celle d’une famille. Le fantastique ne devait arriver au premier plan qu’en dernier ressort. Je dirais même que nous avons travaillé pour que le fantastique renforce le réalisme du film : quand les sauterelles boivent le sang de Virginie, mordent-elles ? Génèrent-elles de l’eczéma ? La peau est-elle à vif ou brûlée ? Nous avons été soucieux de répondre de manière crédible à ces questions pour ne pas rompre l’aspect « documentaire rural » du film avec sa caméra fluide et rapide, au plus près des personnages.
Pouvez-vous nous parler du choix des comédiens et de la façon dont vous les avez dirigés ?
Pour le rôle principal, celui de Virginie, je voulais quelqu’un d’inattendu, de pas encore trop identifié, pour créer une vraie surprise. Je n’ai rencontré que deux actrices. Le profil de Suliane m’a tout de suite enthousiasmé car son parcours faisait la synthèse entre le grand public (son rôle dans la série TV Zone blanche) et le registre auteur (en tant que pensionnaire de la Comédie-Française). Par ailleurs, Suliane faisait preuve d’un jeu très énergique et physique dont j’avais besoin. En ce qui concerne le rôle de Karim, au départ le personnage s’appelait Paul… Je ne voulais pas tomber dans la figure conventionnelle de l’agriculteur au cinéma. J’avais envie de brouiller les pistes, donc le viticulteur est devenu Karim.
J’ai tout de suite pensé à Sofian car notre collaboration sur Acide avait été excellente. Je discute beaucoup du scénario avec les comédiens avant le tournage. À ce stade, mon job c’est de définir le background psychologique du personnage sur plusieurs années. On discute et l’acteur apporte ses modifications. Ensuite, j’attends d’eux qu’ils prennent la responsabilité entière de leur rôle. Sur le plateau, je suis très précis sur les gestes mais je les laisse libres sur leur jeu. Et j’essaie d’accessoiriser les décors au maximum pour créer un environnement qui fonctionne pour l’acteur. L’élevage d’insectes, ce n’est a priori pas très visuel : les insectes sont placés dans des tiroirs qu’on amène ensuite vers une chambre de stérilisation etc. On a donc dû inventer un décor artificiel pour nourrir l’action et donner à Suliane la possibilité d’ancrer son personnage dans des gestes concrets. C’est de là que viennent les nasses et la salle de ponte. C’était une façon de montrer l’insecte, et de faire en sorte que Suliane manipule des objets spécifiques. Quant aux enfants, je crois que Marie est déjà une actrice complète et expérimentée. Je n’avais pas besoin de la diriger plus que les autres. Raphaël, lui, devait beaucoup jouer avec la peur : je l’ai donc aidé à canaliser ses émotions pour le protéger. Mais lui aussi est devenu assez vite un acteur à part entière.
Dans votre court métrage Acide, c’était déjà une famille aux prises avec un dérèglement climatique. On a l’impression que catastrophe rime forcément avec famille dans vos films.
Mais l’état du monde est dans une impasse… Je souhaitais construire un film autour d’un personnage féminin fort et humain malgré son abnégation et sa folie qui la poussent au sacrifice. Mais, c’est aussi un film sur des enfants qui vont devenir adultes beaucoup plus vite. La Nuée, c’est le passage de l’enfance à l’âge adulte en l’espace d’une histoire, dans un temps trop court. Les parents ont beau essayer de préserver leurs enfants de la catastrophe, de pré – server leur enfance, les enfants d’au – jourd’hui vont devoir être adultes plus vite et trouver des solutions.
Aviez-vous certains films en tête en préparant La Nuée ?
J’étais un peu paumé car c’était comme si j’essayais d’associer Petit paysan avec Alien. La référence la plus directe selon moi est Take Shelter de Jeff Nichols. Ceci étant dit, je trouvais que le traitement du genre dans un monde hyper réaliste fonc – tionnait très bien dans Petit Paysan. Il y a aussi des documentaires que j’aimais beaucoup comme Anaïs s’en va en guerre : une femme coura – geuse de 25 ans qui se lance dans la production d’herbes, de coriandre, de basilic… et on la compare à la haute couture de l’arôme. Elle avait un amour pour son travail phénoménal !
PROPOS RECUEILLIS EN MARS 2020