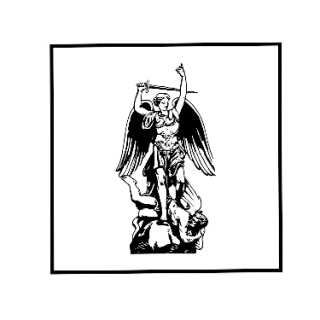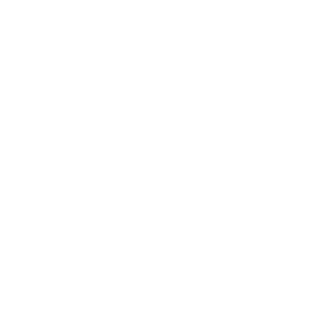Années 1970. Jeanne (Clara Pacini) fugue de son foyer de haute montagne pour rejoindre la ville. Dans le studio où elle s’est réfugiée, la jeune fille tombe sous le charme de Cristina (Marion Cotillard), l’énigmatique star du film La Reine des Neiges, son conte fétiche. Une troublante relation s’installe entre l’actrice et la jeune fille.
LA TOUR DE GLACE
Fiction / France, Allemagne
HORAIRES DU 8 AU 14 OCTOBRE 2025
JEU 9 • SAM 11 • LUN 13 : 12h10
HORAIRES DU 15 AU 21 OCTOBRE 2025
à venir
ENTRETIEN AVEC LUCILE HADZIHALILOVIC À PROPOS DE LA TOUR DE GLACE
Quelle a été la genèse du film et le rapport avec le conte d’Andersen La Reine des Neiges ?
J’ai eu la chance de découvrir Hans Christian Andersen à l’âge de cinq ans, quand ma mère me lisait inlassablement ses contes, dans des versions non expurgées. Ils continuent de me passionner par leur complexité humaine, leur peinture sensible et non moraliste de nos peurs et de nos désirs, tout autant que par l’imaginaire poétique qu’ils déploient.
La Reine des Neiges est l’un de ceux que j’aime particulièrement, mais je ne me suis que très librement inspirée de son thème principal : une jeune fille qui part à la recherche de la personne qu’elle aime, enlevée par la Reine des neiges, et parvient jusque dans son Royaume, le royaume glacé des morts. La Reine des neiges en particulier me fascine : une figure de la perfection et de la connaissance, inaccessible et mystérieuse, attirante et effrayante à la fois. C’est la rencontre de la jeune fille et de cette Reine qui a donné naissance à ce film.
Comment s’est déroulé le travail sur le scénario ?
*Dans un premier temps, j’ai travaillé seule pour trouver la matière qui m’intéressait le plus dans le conte. J’ai choisi d’emblée de le transposer dans la réalité ainsi que de construire une narration linéaire et classique. Mais on n’échappe pas à soi-même, et à un moment donné les lignes narratives et temporelles de La Tour de glace se sont brouillées comme dans un rêve.
Puis, avec le scénariste Geoff Cox, nous avons construit à la fois le parcours émotionnel des personnages et la structure. Nous avons une approche oblique de la narration qui s’appuie peu sur les dialogues. Nous essayons de raconter l’histoire à travers les détails et de transmettre ce que vivent les personnages par les éléments visuels (ambiances lumineuses, couleurs, détails des décors, des accessoires et des costumes) et sonores ainsi qu’avec des correspondances entre ces éléments, un peu comme pour un poème. La productrice Muriel Merlin a lu une première version du scénario et s’est enthousiasmée pour le projet.
C’est votre deuxième film avec Marion Cotillard…
C’est avec une grande joie que j’ai retrouvée Marion, vingt ans après Innocence, pour incarner le double rôle d’une star de cinéma (Cristina) et du personnage de la Reine des neiges.
Marion possède ce côté à la fois moderne et intemporel que je recherche un visage qui a la qualité expressive de ceux des actrices des années 30, époque à laquelle le film dans le film fait référence. Mais un jeu moderne et une énergie comme celles des acteurs des années 70, un cinéma qui – implicitement – irrigue La tour de glace.
Sa très grande cinégénie, sa beauté et sa sophistication ont quelque chose d’hitchcockien et peuvent être absolument fascinantes pour une adolescente.
Nous n’avons pas eu besoin de beaucoup parler ni de répéter, peut-être parce qu’Innocence d’une certaine manière, nous avait liées, et que Marion savait que je souhaitais un jeu tout en retenue. De plus, elle y interprète le même type de personnage : un idéal féminin (le professeur de danse dans Innocence, et maintenant la star de cinéma) mais qui a une blessure secrète. Dans les deux cas, ce personnage se retrouve face à des jeunes filles, reflets de celle qu’elle a pu être, et qui la confrontent à ce qu’elle est devenue. L’ambiguïté de son jeu exprime celle de son personnage. On ne sait jamais si les émotions de Cristina sont sincères ou feintes, ni à quel point elle est ou non « possédée » par la Reine. Marion a su montrer les visages parfois paradoxaux de son personnage : froid, distant et impérieux, mais aussi impulsif et passionné avec un côté très charnel, et enfin fragile et profondément mélancolique. Elle passe de manière subtile et crédible de la séduction à la menace. Et le côté inquiétant qu’elle révèle dans le film est quelque chose que j’avais encore rarement vu chez elle, et qui m’a fait frissonner.
Vous avez évoqué votre premier film, Innocence. Y a-t-il une continuité d’une œuvre à l’autre dans votre filmographie ?
Je constate que, malgré moi, les mêmes motifs et structures narratives reviennent de film en film : la forme du conte ; les processus de maturation d’un(e) jeune protagoniste explorant un monde mystérieux peuplé de figures d’adultes plus ou moins fantasmagoriques ; la figure de mère nocive – que ce soit par son action ou par son absence. Mais aussi l’enfermement, les espaces vides et labyrinthiques. Et en opposition, la nature liée aux personnages féminins avec comme élément principal l’eau sous toutes ses formes : rivière, lac, fontaine, cascade, pluie, neige et glace…Un élément incroyablement cinématographique.
Le film reprend la forme méta-cinématographique que l’on retrouve dans des œuvres importantes telles que 8 1/2 de Fellini, 1963 ou La nuit américaine de Truffaut 1973. Comment le film s’inscrit dans cette tradition, presque un sous-genre ?
Dans le conte d’Andersen, il y a un élément très important : un miroir qui reflète le monde de manière déformée. J’ai pensé que l’équivalent réel de ce miroir pouvait être à la fois l’objectif de la caméra et l’écran de cinéma.
Aussi, dès le départ, j’ai eu le désir d’inclure un film dans le film, l’un étant le double de l’autre, l’un réaliste et l’autre fantastique. Et puis, bien sûr, j’ai voulu que les deux films s’enchâssent comme dans un récit-gigogne, se mélangent. Et cela, d’autant plus que ce film dans le film est vu à travers les yeux de la jeune fille à la manière d’un rêve : son rêve. Cette possibilité m’a paru très inspirante.
Sur un autre plan, le monde poétique du film dans le film a « contaminé » le monde réel, à commencer par le studio de cinéma où se déroule l’histoire et qui devient alors une extension du Royaume. Celui-ci déborde même sur la ville, se cristallisant sur la patinoire, porte d’entrée dans le monde magique.
Enfin, le studio de cinéma me permettait de montrer les images sur l’écran dans la salle de projection dans un effet de dédoublement et de répétition excitants. Car La Tour de Glace n’est pas tant un récit sur la fabrication d’un film que sur la fascination que produisent les images projetées et leur emprise sur les spectateurs.
Le décor des années 70 peut-il être considéré comme une sorte d’autobiographie cachée ? Je pense à la découverte et la fascination d’une adolescente pour le cinéma. Et comment avez-vous abordé la représentation de la figure du réalisateur ?
Cette époque où les images et les informations étaient infiniment plus rares était plus propice à l’innocence de Jeanne ainsi qu’à la séduction mystérieuse et au pouvoir d’une actrice de cinéma. Mais il y a évidemment un aspect autobiographique dans le choix de la protagoniste adolescente du film, et dans le fait de situer l’histoire dans les années 70. Cette décennie est celle de ma propre adolescence comme de ma découverte du cinéma et du début de mon attraction pour celui-ci. S’il y a autoportrait dans le film, c’est donc bien sûr à travers la jeune fille, et non pas avec le personnage du réalisateur, assez passif et en retrait dans le récit.
Puisque d’ailleurs, c’est Jeanne qui, en quelque sorte, rêve le film dans le film et en est l’auteur.
Pour incarner ce réalisateur dont le nom, Dino Dorato, est une allusion à Dario Argento dont les films m’ont tant marquée, même si le type de cinéma féérique qu’il fait renverrait plutôt à un cinéma allemand ou français, j’ai pensé qu’il serait réjouissant d’avoir un véritable cinéaste. J’ai fini par choisir quelqu’un de très différent du personnage. Gaspar Noé s’est amusé à se métamorphoser en un réalisateur comme on en voit dans certains films des années 60/70, mais qui n’est ni lui, ni moi.
Parlons de la réalisation, du style. Quels ont été les principaux choix concernant l’image et le langage cinématographique ? On remarque une attention particulière, presque expressionniste, à l’utilisation de la lumière, des ombres et surtout des reflets lumineux…
Qui dit cinéma dit ombres et lumières. Avec le chef opérateur, Jonathan Ricquebourg, nous avons joué sur les oppositions : la pénombre de la salle de projection et celle des couloirs du studio la nuit face à la lumière du plateau ; la clarté de la montagne diurne et l’obscurité de la montagne nocturne…
Et bien sûr, il y a le « cristal » que Jeanne vole au manteau de la Reine, et ses reflets, comme une métaphore de la lentille de la caméra que traverse la lumière, et avec lequel l’adolescente joue comme une apprentie magicienne. Le cristal qui a le pouvoir de faire voir « le royaume de la Reine dans toute sa splendeur », mais aussi « un millier d’autres Royaumes ». Une métaphore évidente de l’essence du cinéma.
L’expressionnisme allemand était une référence présente dans le travail de préparation. Malgré cela, La Tour de Glace se situe dans un environnement plus réaliste que mes précédents long-métrages, où Jeanne seule convoque le merveilleux. En cela, le film est sans doute plus proche d’un réalisme poétique ou magique. Ici, nous avons utilisé des partis-pris stylistiques similaires à ceux de mes autres films : le plan fixe, l’utilisation d’une focale unique, l’éclairage naturel ou utilisant des éléments présents dans le décor. Seul Dino Dorato a eu « le droit » de déroger à ces règles et il a utilisé des travellings et un objectif anamorphique, comme l’aurait fait un cinéaste des années 70.
Et pour le travail sur la couleur ?
Avec le chef opérateur, la cheffe décoratrice Julia Irribarria et la costumière Laurence Benoit, nous avons travaillé à partir du blanc de la neige, réelle ou factice, et de l’écran de cinéma, couleur qui se retrouve bien sûr dans la robe de la Reine.
En opposition, la palette de couleurs des costumes des figurants de la patinoire, de l’équipe ainsi que le décor du studio – notamment la loge de Cristina aux bruns chauds et mordorés – évoquent les années soixante-dix. Enfin, nous avons attribué une couleur expressive aux personnages principaux : le violet inquiétant pour Cristina, le rouge dramatique pour Jeanne, le jaune rassurant pour Bianca…
L’univers sonore est très riche. Quelle est votre approche particulière du son, de la musique, et des chansons ?
Le son, c’est vraiment l’intériorité des personnages. Mais au lieu de la rendre essentiellement par la musique, Ken Yasumoto, qui est à la fois le monteur son et le mixeur du film, a joué avec les bruitages, les ambiances, les réverbérations et la texture même des sons. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur le silence. En éliminant au maximum tout bruit parasite, nous avons voulu créer une sensation d’étrangeté, de déréalisation, y compris dans les décors réels (la ville, le studio, la montagne) et donner l’impression d’un monde mental. Nous avons recomposé beaucoup de choses en post-production, tout en restant parcimonieux quant aux éléments utilisés. Dès le début de notre travail de montage, la monteuse Nassim Gordji-Tehrani m’a demandé des musiques, et même s’il y en a peu finalement, j’en ai utilisé plus que dans mes précédents films. Tout d’abord pour le thème de Jeanne, un extrait de La Fête des Belles-eaux de Messiaen, morceau à la fois mélancolique et onirique et qui donne, suivant les mots de Messiaen, une impression de « grâce et d’éternité ». En prolongement, et pour rester avec Jeanne durant le générique, nous avons monté un extrait de la symphonie Turangalîla. Ces deux morceaux utilisent les ondes Martenot, cet instrument électronique dont le caractère étrange renvoie aux fantômes et aux rêves. Le thème de la Reine, qui devait faire ressentir la puissance et la menace qu’elle représente, utilise, lui, des cordes évoquant Ligeti ou même Bernard Hermann, mais retravaillé de façon plus moderne par le producteur de musique Lexx.
Nous avons aussi utilisé des morceaux intégrés à l’histoire et qui renvoient à l’époqueoù se situe le film : la chanson Five O’clock d’Aphrodite Child pour la patinoire, ainsi que les musiques de variété italienne et de pop psychédélique entendues à la radio dans le studio. C’est la première fois que j’utilise des chansons connues dans un film. Une chanson, c’est comme une mini-histoire dans l’histoire, même si les paroles ne redoublent pas la narration du film, elles donnent des échos de celle-ci.
Quelle est l’importance et le pouvoir expressif du premier plan – on pense à Dreyer – , par rapport au plan général ?
Dans La Tour de Glace comme dans tous mes autres films, nous avons utilisé un cadrage en Cinémascope qui donne une force expressive aux gros plans comme aux plans larges des paysages. Ici, j’ai eu recours à de nombreux plans rapprochés sur la jeune fille dont le regard est en quelque sorte le fil conducteur. Jeanne regarde et nous la regardons regarder.
Tout au long du film, le regard de la jeune fille, joué par Clara Pacini, nous fait percevoir l’idée même de la mort et cela m’a fait penser aux mots d’un poème de Cesare Pavese :« La mort viendra et elle aura tes yeux ».
Avec le cinéma – et sûrement parce qu’ils sont intrinsèquement liés – la mort est l’autre grand thème de La tour de glace. Dans le conte d’Andersen, l’enfant prisonnier de la Reine doit composer un mot pour se libérer, et ce mot est « Éternité ». L’éternité des images projetées sur l’écran blanc. Ou pour le dire à la manière de Jeanne : « La Reine a son royaume, et il est là pour toujours ».
Et, on l’apprendra au cours du film, une mort hante Jeanne. Sans le savoir, c’est à sa rencontre qu’elle va lorsqu’elle quitte le foyer de son enfance. C’est elle qu’elle convoque et retrouve dans la Reine des neiges qui traverse le film de façon spectrale.
Clara Pacini, qui interprète Jeanne, est élève au conservatoire de théâtre de Paris et n’avait fait qu’un seul court-métrage auparavant. Dès les essais, j’ai été séduite par la subtilité de son jeu et par sa maturité qui l’a certainement aidée à traverser les différents états émotionnels du personnage.
Sa grâce en même temps que sa force et sa détermination, mais aussi sa mélancolie sous-jacente, sont les autres raisons qui m’ont poussées à la choisir pour incarner cette adolescente trouble et complexe : menteuse, voleuse, voyeuse, manipulatrice…
Et en même temps totalement sincère et ingénue. De manière générale, chez les interprètes de mes films, je recherche une intériorité et une neutralité. Une présence plutôt qu’une performance. Cette présence et cette intériorité, Clara les a absolument.
Quelle est la relation qui noue Jeanne à Cristina ? Qu’est-ce qui se joue entre elles ?
Elles sont le reflet l’une de l’autre comme dans un portrait en miroir. Cristina est le possible devenir de Jeanne, et une figure maternelle ; Jeanne, renvoie à la jeune fille vulnérable naïve et passionnée que Cristina a tué en elle. Sous le masque de la Reine qu’elle interprète, Jeanne découvre Cristina, l’actrice, fascinante et ambivalente : tantôt bienveillante vis-à-vis d’elle, tantôt menaçante.
Cristina est quelqu’un de corrompu par le pouvoir et une manipulatrice perverse, mais aussi une femme à l’esprit troublé qui souffre. Elle voit tout de manière déformée, à commencer par elle-même, et l’armure de glace qu’elle s’est construite l’isole des autres. En véritable maîtresse des artifices, Cristina séduit et assujettit Jeanne à ses désirs. Mais, parallèlement, elle-même est sous le charme inconscient de la jeune fille qui, par son audace et son authenticité, et par le regard qu’elle porte sur elle, se révèle unique. Cristina aime se voir dans les yeux de Jeanne qui aime la regarder, et ce jeu de regards les lie l’une à l’autre.
Mais, objet de désir, Jeanne est aussi pour Cristina une menace. Après avoir blessé son orgueil en refusant l’épreuve qu’elle exigeait d’elle, elle réveille ses émotions, faisant fondre son armure et la rendant vulnérable. Et cette vulnérabilité, Cristina ne la supporte pas. Elle veut alors détruire cette jeune fille sincère et innocente qui la déstabilise, elle veut garder le contrôle… Ce sera Jeanne qui finalement l’emportera, au moment où, paradoxalement, elle se révèlera le plus vulnérable.
La jeune fille a en elle des forces de vie ; elle agit et son regard construit des mondes… A la fin du film, libérée de l’emprise de Cristina et de sa culpabilité liée au suicide de sa mère, Jeanne parviendra à une forme de résilience, en retrouvant sa capacité de rêver.
Un autre personnage important de l’histoire est Max, interprété par August Diehl …
August Diehl est un merveilleux acteur, séduisant et inquiétant à la fois, au puissant charisme. Malgré le peu de scènes de son personnage, il a su donner une présence marquante à Max, le trouble chevalier servant de Cristina. Son jeu est à la fois subtil et complexe, et son inventivité comme son engagement sont un rêve de réalisateur !
L’obsession et le sacrifice sont-ils parmi les autres grands thèmes du film ?
Oui, ce sont aussi les thèmes récurrents des contes d’Andersen qui n’en font pas du tout des histoires pour enfants ! Le sacrifice chez lui comme dans ce film est un acte intime qui ne sert pas à sauver le monde ou qui que ce soit, mais à prouver son amour à l’autre. Un acte lié ici à la culpabilité et à la transmission des traumatismes.Quant à l’obsession mutuelle entre Jeanne et Cristina, mais aussi l’obsession pour les images, elles vont de pair avec les thèmes de l’enchantement et de l’emprise que les deux femmes exercent l’une sur l’autre.
Un autre élément important est le paysage. La montagne, écho d’un paysage intérieur.
Le paysage – ici la montagne et son glacier – reflète l’intériorité des personnages à la manière expressionniste ou symboliste : le monde minéral figé, isolé et austère qui entoure Jeanne au début du film ; puis sa version adoucie et sublimée dans le décor peint du plateau de cinéma ; et enfin les sommets mystérieux à la fois réels et artificiels de la fin et liés à Cristina.
Quelles ont été, le cas échéant, les principales influences de ce film ?
En dehors des films de Powell et Pressburger et de l’aspect féerique et plastique de leur travail dans des films comme Le Narcisse Noir, Les Chaussons Rouges ou Les Contes d’Hoffmann, je n’avais pas de références conscientes précises mais je suis si imprégnée de certains films qu’ils peuvent être venus hanter La Tour de Glace : le cinéma italien des années 70, à commencer par les giallos et les films fantastiques pour leurs atmosphères et leur recherche des sensations, leur côté plastique et mystérieux. Mais aussi Hitchcock, Sirk et Fassbinder, chacun à leur façon, pour le mélange de réalisme et d’artificialité, de beauté et de cruauté. Un cinéma de la fascination et de l’obsession… Et enfin, le cinéma japonais classique d’un Mizoguchi, Naruse ou Kinoshita est pour moi extrêmement inspirant dans ses aspects formels (notamment le cadrage ou le montage), ainsi que par sa très grande poésie et sa recherche de l’épure. C’est vers celle-ci que j’aimerais tendre. Je recherche une sorte de minimalisme et travaille par soustraction plutôt que par addition. Un cinéma de la distillation en quelque sorte.
Dans vos œuvres, il y a généralement peu de dialogues. Quel est votre rapport au cinéma muet ?
C’est l’âge d’or du cinéma ! Une époque où le langage des films était proche de celui des rêves.
On retrouve dans votre cinéma certains éléments du Slow Cinéma comme, par exemple, la caméra fixe. Pourriez-vous vous reconnaître dans ce mouvement ?
Je ne sais pas si je fais partie d’un mouvement, mais en effet je trouve souvent plus d’inspiration et d’intensité dans la contemplation que dans la vitesse. Et ce que je cherche, c’est à faire ressentir plutôt qu’à faire comprendre. J’aimerais que mes spectateurs, comme sous hypnose, accompagnent l’expérience physique et émotionnelle des personnages. Plus que raconter une histoire, ce qui m’intéresse, c’est de créer un monde dans lequel le spectateur peut « vivre » le temps du film.
LISTE ARTISTIQUE
Cristina / La Reine Des Neiges Marion Cotillard
Jeanne Clara Pacini
Max August Diehl
Stéphanie Marine Gesbert
Chloé Lilas-Rose Gilberti
Dino, le réalisateur Gaspar Noé
La 1ère assistante Dounia Sichov
Bianca Valentina Vezzoso
Rose Cassandre Louis Urbain
Narratrice Aurélia Petit
LISTE TECHNIQUE
Scénario Geoff Cox et Lucile Hadzihalilovic Avec la collaboration dAlanté Kavaïte
Image Jonathan Ricquebourg
Décor Julia Irribarria
Costume Laurence Benoit
Coiffure Cicci Svahn
Maquillage Vesna Peborde
Prise de son Etienne Haug
Casting Lydie Le Doeuff
Montage Nassim Gordji-Tehrani
Montage son et mixage Ken Yasumoto
Directeur de production Serge Catoire
Directeur de post-production Cédric Ettouati
CE QU'EN DIT LA PRESSE
LE MONDE
La Tour de glace est à l’image du royaume de la Reine, lequel nous est décrit en ces termes (en voix off) dès le premier plan : vaste, immense et scintillant.
20 MINUTES
Lucile Hadzihalilovic signe une relecture envoûtante du conte d’Andersen très éloignée de la version Disney.
CRITIKAT.COM
En revisitant La Reine des neiges, Lucile Hadžihalilović signe une fable sur l’emprise, où les motifs du conte débordent jusqu’à transformer la perception d’une adolescente en un cauchemar glacé.
L’HUMANITÉ
Une vision surréelle et singulière du star-system par la spécialiste de l’étrange Lucile Hadzihalilovic.
LE FIGARO
Marion Cotillard est magnétique et fascinante en Reine des neiges inaccessible.
LES INROCKUPTIBLES
Le film de Lucile Hadžihalilović est très beau. Tout plan semble cadré, composé comme un tableau vivant pour produire une somptueuse image.
MAD MOVIES
L’idée est simple, mais en recourant aux sortilèges conjoints, Lucile Hadzihalilovic voit vraiment les choses. Et par ricochet, elle nous les fait voir aussi !
MARIE CLAIRE
Un édifice d’images glacées aussi malaisantes que fascinantes.
POSITIF
Du monde réel stylisé des années 1970 au royaume de l’illusion, Lucile Hadzihalilovic filme le passage glaçant à l’âge adulte.
PREMIÈRE
Il était presque inévitable que Lucile Hadzihalilovic, cinéaste du mystère de l’enfance, des mondes autarciques, de l’envoûtement et de l’hypnose, finisse par faire son grand film sur le cinéma. Nourrie du souvenir de quelques réalisateurs et films de chevet, elle poursuit, avec le directeur de la photo Jonathan Ricquebourg, un travail sur le scintillement, la lumière kaléidoscopique, les miroirs brisés, qui était déjà au cœur d’Earwig.