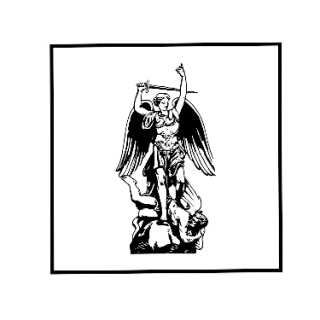Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste depuis dix ans. Poussée par le désir d’écrire à nouveau, elle se résout à quitter la majorité de ses patients. Alors qu’elle manque d’inspiration, une jeune femme la contacte un soir et la supplie de la recevoir. Sibyl finit par accepter. Les révélations de Margot vont peu à peu bouleverser la vie de Sibyl…
SIBYL
Fiction / France
Le 18 décembre à 20h, séance de ciné-club autour de SYBIL de Justine Triet à l’Espace Saint-Michel, en présence de Geneviève Morel, psychanalyste et responsable du ciné-club CINÉ-CRIME aux 3 Luxembourg.
ENTRETIEN AVEC JUSTINE TRIET
Comme LA BATAILLE DE SOLFÉRINO et VICTORIA, SIBYL dresse le portrait d’une jeune femme qui se débat entre sa vie professionnelle et sa vie intime, ses affects et ses angoisses… Vos films seraient-ils à chaque fois des formes d’autoportraits en creux ?
Je m’inspire de certaines choses de mon entourage, d’enquêtes, de films, et sûrement un peu de moi mais honnêtement, je ne suis pas Sibyl. Avec mon coscénariste, Arthur Harari, on a pris du plaisir à partir totalement dans la fiction, à abîmer nos personnages. Au final, j’ai l’impression qu’ils n’ont plus rien à voir avec moi. UNE AUTRE FEMME de Woody Allen m’a hantée dès le début de l’écriture. Etrangement, je n’adore pas ce film, mais son principe narratif me fascine : une femme, cherchant le calme et l’inspiration, se retrouve face à une autre femme qui la plonge dans un vertige abyssal et fait exploser toute sa vie… Ce film a été la référence au départ.
Vous avez fait des recherches sur la psychanalyse ?
Non, j’ai rencontré plusieurs psys auxquelles j’ai demandé si elles avaient vécu une expérience déstabilisante avec un patient. Et l’une d’elles m’a révélé avoir vécu la maladie de son père en même temps que celui de sa patiente. Mais son père est mort plus rapidement que celui de sa patiente. Elle avait dû mettre un terme à l’analyse car elle se sentait violentée par l’autre. Ça a nourri l’écriture de mon film. La série EN ANALYSE (IN TREATMENT) également.
Le film croise plein de thèmes et de motifs : la maternité, la filiation, la création, le couple, l’amour-passion, la crise à mi-chemin de la vie, la gémellité, la reproduction des névroses… Quel serait pour vous son sujet central, dominant ?
C’est comment on traite la question de nos origines. Comment on fait tout pour les oublier, et comment elles réapparaissent brutalement. C’est un film sur l’identité, les racines. D’où je viens, qui je suis, qu’est-ce que j’ai fait, est-ce que je peux me réinventer ? Il y a l’origine de l’enfant de Sibyl, celle du livre, mais aussi celles de Margot, qui semblent la hanter. Il m’importait que Margot soit issue d’un milieu modeste, qu’elle déteste d’où elle vient et essaye de lutter contre. Elle surgit avec un dilemme qui renvoie Sibyl à son passé. D’une certaine manière, c’est Sibyl en miroir inversé. Sibyl aussi a essayé de se construire contre ses origines, sa mère, l’alcool, et c’est par l’écriture qu’elle a voulu fuir ça, se réinventer. Quand elle se remet à écrire en rencontrant Margot, Sibyl ouvre une brèche qui est à la fois un départ dans le délire fictionnel, mais aussi un vertige sur elle-même, son identité. Elle se retrouve en pleine crise.
A propos de choses immorales, Sibyl viole la déontologie en enregistrant sa patiente pour utiliser ses propos dans un futur livre. On voit une cinéaste qui travaille ses acteurs comme une matière. L’acte de créer comporte toujours une nécessaire part de vampirisme, de prédation ?
En partie, oui. Au-delà de la création, dans le film, tout le monde manipule tout le monde. Pour Sibyl, le fait d’écrire l’entraîne à transgresser toutes les règles. Elle sort de la réalité et entre dans la fiction pour vivre des choses. En même temps, c’est de l’ordre du jeu. La création a aussi un aspect ludique où tout est permis. Après, c’est sûr que Sibyl va trop loin, parce qu’elle ne vivait plus rien. Elle est emportée. L’écriture/le livre fait d’elle une machine qui se met en route et qui déraille. Elle vampirise Margot, mais pas seulement : elle vampirise tout ce qu’il y a autour d’elle… elle se vampirise elle-même !
Les séquences de tournage du film dans le film comportent cette part ludique en mélangeant comédie et cruauté.
A ce stade du film, il fallait ce mélange, car c’est vraiment là que ça commence à dérailler. Quand Sibyl va sur l’île, c’est la bascule vers un monde tissé de fantasmes, plus tout à fait réel ni normé : c’est loin, c’est beau, c’est faux. Le tournage c’était parfait pour ça. Il fallait qu’avec cette partie, arrive la comédie, le délire, c’est à dire le mélange de choses qui ne devraient pas se mélanger. Concernant le mélange des tons, j’ai été aidée par Sandra Hüller, qui est la synthèse parfaite de la comédie et du drame. Le mélange qu’elle propose est explosif : elle incarne un personnage qui souffre, mais qui transforme tout en énergie tarée. On ne sait plus si on doit rire ou être angoissé avec elle.
Sur le tournage, Margot dit à un moment que le cinéma est un milieu dingue et qu’elle craint d’y devenir folle. C’est aussi votre angoisse, parfois ?
Le cinéma est une micro-société où la vie s’accélère, s’intensifie, où tout devient exacerbé… Le moindre petit problème devient une tragédie, les rapports hiérarchiques sont violents, et complètement grotesques. C’est un milieu ridicule, comique, mais où on vit des choses très fortes : ça m’amusait de m’en moquer autant que ça servait le récit. Ça appelle presque la satire. THE PLAYER d’Altman a été une référence pour ça aussi. Même dans un film très sérieux comme 15 JOURS AILLEURS de Minnelli, tout ce qui tourne autour du milieu a un côté comique, satirique.
Il y a de la gémellité entre Sibyl et Margot, entre Sibyl et sa sœur, entre Gabriel et la petite fille née de son amour avec Sibyl… Pouvez-vous parler de ce motif de la gémellité qui a traversé tant de films ?
Il y en a aussi entre les personnages de Sibyl et de Mika, entre Gabriel et Igor… Entre Sibyl et Margot, c’est une gémellité en miroir inversé, Sibyl a gardé son enfant alors que Margot voudrait se faire avorter. De son côté, Mika voulait un enfant comme Sibyl, ne l’a pas eu, en a fait le deuil. Ce que j’ai essayé de faire, c’est démultiplier ce motif du double, comme si Sibyl envahissait tous les personnages du film. Même si vers la fin, Margot échappe à ça, on se rend compte qu’elle est peut-être moins fragile que Sibyl. La plus solide n’est pas celle qu’on croyait. Margot s’est épanouie, elle a mûri, elle n’est plus victime, et semble avoir pris plaisir et fierté à inspirer Sibyl.
Dans ce registre des miroirs, la présence des enfants est frappante. Quel rôle jouent-ils dans cette histoire ?
Les enfants sont des personnages très importants, mais comme cachés dans le film. L’enfant en psychanalyse, Daniel, introduit une présence un peu étrange, non nécessaire au récit, mais qui est tout le temps là quand Sibyl se souvient de son amour passé. Daniel est comme un fantôme de l’enfant qu’elle a fait avec Gabriel. Au début, quand Daniel et Sibyl jouent au Monopoly, l’enfant lui dit “vous allez perdre” : c’est une parole annonciatrice de ce qui va se passer. Quand je l’ai écrit, on m’a dit qu’il y avait trop de personnages, que ce n’était pas une série, que Daniel était dispensable. J’ai pensé au contraire que justement, il réverbérerait de l’extérieur quelque chose de l’histoire centrale. Pour moi, c’est un personnage secrètement très important. Pour les filles de Sibyl, elles sont là d’abord de manière contingente, puis peu à peu la figure de Selma se détache, on comprend qu’elle est le nœud secret de la vie de Sibyl. Elle hérite de tout, sans le savoir, elle est à la fois une trace et une prolongation. Il fallait que le film se termine sur elle, qui prend pour la première fois la parole, et qui pour la première fois regarde vraiment sa mère : elle se met à exister. Et ce, précisément au moment où Sibyl prétend que sa vie est une fiction, que les gens autour d’elle sont des personnages. L’enfant vient contredire sa mère, sans même le savoir.
Après une première partie très urbaine (comme l’étaient vos deux premiers films), SIBYL part vers la lumière et l’espace de Stromboli. Pourquoi ce lieu chargé de la cinéphilie et riche en symboles ?
L’histoire de cette île a été transformée par le cinéma. Tourner là-bas était une expérience un peu mystique et au-delà de la référence, le volcan évoque toutes les métaphores émotionnelles, sexuelles. Ce n’est pas du tout une relecture du film mythique de Rossellini, on s’est amusés à filmer une réalisatrice allemande qui fantasme de faire un film d’amour à Stromboli. L’idée était de se servir de ce décor pour faire exploser tout le film. C’était la première fois que je filmais un paysage naturel et j’ai adoré ça ! (Je suis comme Sibyl sur un aspect, je suis plus souvent dans la fiction que dans la réalité, et filmer des éléments comme la mer, le vent, le soleil, était un nouveau défi.) Stromboli amène un tel contraste par rapport aux appartements parisiens que ça semble presque irréel. Sur l’île, Sibyl dit à sa sœur qu’elle a l’impression de ne plus être dans aucune réalité, ce qui est paradoxal parce que c’est là qu’elle agit le plus, c’est là qu’elle est vraiment plongée dans la vie.
C’est un film proliférant de personnages, d’histoires emboîtées les unes dans les autres… Comment débute ce type de complexité ? Vous vous lancez des défis d’écriture avec Arthur Harari ? Ou vous souhaitiez déployer la veine de VICTORIA ?
Victoria était déjà assez complexe en termes d’entremêlement de récits, mais c’était un film très terre-à-terre, alors qu’il y a ici une dimension supplémentaire, plus mentale : on est dans la tête de Sibyl. Mais il ne s’agit pas de défis. On part sur une piste, et pour ce film-là, ça appelait d’emblée une complexité, un enchevêtrement, parce qu’il y a plusieurs niveaux de réalité : le présent, la parole de Margot, le passé de Sibyl, l’écriture du roman. Ça a été compliqué à ordonner, parce que je ne théorise pas beaucoup, j’ai besoin d’une sorte d’accumulation chaotique pour ensuite m’y retrouver, enlever, clarifier. Et ça s’est prolongé au montage, où on a dû de nouveau chercher, casser, tout réordonner… C’est là aussi qu’avec Laurent Sénéchal (le monteur) on décide comment tous ces éléments créent un ton : franche comédie, drame, ou un mélange. J’ai compris qu’il ne fallait pas rechercher systématiquement l’efficacité comique, que ça n’allait pas à ce film. C’est un drame, ou peut-être une « dramédie ». Un film comme TENDRES PASSIONS de James L. Brooks est pour moi un exemple génial, on ne se pose plus la question du genre, il y a trop de mélanges
Comment avez-vous abordé les scènes d’amour, relativement crues ?
C’était une nouveauté pour moi et j’ai essayé de les filmer comme des scènes d’action. Je me suis demandé, est-ce que je regarde ça en ayant peur de baisser la caméra, est-ce que je regarde ça comme une chose mécanique ? On a dirigé ces scènes de façon très précise d’autant que Virginie ne voulait absolument pas improviser. Elle me demandait de lui indiquer exactement ce que je voulais qu’elle fasse, c’était assez comique. Je leur parlais comme s’il s’agissait de faire du vélo, ou de démonter un moteur, c’était concret.
C’est votre deuxième film avec Virginie Efira, elle a passé un cap avec VICTORIA, et on a le sentiment que vous commencez à former un vrai couple de cinéma.
Avec ce film, j’ai eu l’impression de découvrir d’autres visages de Virginie. Elle comprend tout ce que je cherche, ça va vite. La glace était brisée, j’ai osé tout lui demander, et elle m’a fait confiance. Elle s’est totalement abandonnée. Et puis, elle ne se limite pas à la logique première du scénario. Elle est prête à explorer toutes les facettes du personnage, jusque dans ses contradictions. J’ai un plaisir charnel à la filmer, à la modeler comme de la pâte. J’ai envie de l’abîmer, mais dans le bon sens : la voir pleurer, se défigurer, tomber et se relever.
Vous avez choisi Adèle Exarchopoulos par rapport à son travail dans LA VIE D’ADÈLE ?
Pas du tout ! Même si je l’adore dans ce film, je ne pensais pas à elle en écrivant, le rôle était à l’origine pour une fille plus agée. Elle est arrivée plus tard dans le projet, elle a passé un casting et elle a été incroyable. Adèle a une puissance dingue, une grâce que j’ai rarement vue, on la regarde. Ce rôle est difficile car ça pourrait n’être que technique (craquer, pleurer, paniquer, etc.). Elle ne ramène rien à la technique, elle se met littéralement dans l’état qu’exige la scène, et c’est comme ça qu’elle devient le personnage.
Vous avez eu l’idée de prendre Sandra Hüller après avoir vu TONI ERDMANN ?
Oui évidemment ! Mais il se trouve que je l’avais rencontrée il y a 10 ans dans un festival, et elle m’avait tapé dans l’œil alors même que je ne l’avais pas vue jouer. Elle est d’une intelligence rare, et c’est aussi une actrice de théâtre allemande, c’est peu de dire qu’elle travaille beaucoup ! On a l’impression qu’elle peut absolument tout faire, mais c’est incroyablement incarné et original à chaque fois. Elle amène beaucoup de burlesque mais toujours mêlé de gravité. Elle m’impressionne beaucoup.
La fin est très belle, très ambiguë, très ouverte, à la fois heureuse et malheureuse… Quand Sibyl regarde sa fille, on pense dans un autre contexte à la phrase de Truffaut, “te regarder est une joie et une souffrance”. Une joie parce que c’est sa fille, une souffrance parce que ça lui rappelle Gabriel.
Oui c’est ça. La fin du film est impure, on peut y voir une libération ou un apaisement, mais la blessure est toujours là. Sibyl ne montre pas ses larmes à sa fille et on sent que la gamine est un peu perdue, qu’elle se demande non seulement d’où elle vient, mais aussi qui est vraiment sa mère. On ne sait finalement pas qui est cette femme. Dans sa vie, le mensonge est partout. Mais ce n’est pas du mensonge malveillant, c’est un arrangement avec la réalité, c’est du mensonge mêlé à l’amour. Pour que l’amour ne quitte pas sa vie, elle ment.
JUSTINE TRIET, RÉALISATRICE
Justine Triet est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris. Ses premiers films s’interrogent sur la place de l’individu au sein du groupe. SUR PLACE (2007) tourné pendant les manifestations étudiantes, SOLFÉRINO (2008) réalisé lors des élections présidentielles. En 2009, elle réalise DES OMBRES DANS LA MAISON dans un township de Saõ Paulo. VILAINE FILLE, MAUVAIS GARÇON, son premier moyen métrage de fiction, remporte de nombreux prix dans des festivals en France et à l’étranger (Prix EFA du Film Européen à la Berlinale 2012, Grand Prix du Festival Premiers Plans d’Angers, Grand Prix du Festival de Belfort, présélection aux César du court-métrage 2013). Son premier long-métrage LA BATAILLE DE SOLFÉRINO est sélectionné à l’ACID à Cannes en 2013 et nommé aux César 2014 dans la catégorie meilleur premier film. VICTORIA, son deuxième long-métrage, fait l’ouverture de la Semaine de la Critique (Festival de Cannes) en 2016. Emmené par Virginie Efira, le film sera nommé cinq fois aux César, dont Meilleur film et Meilleure actrice.