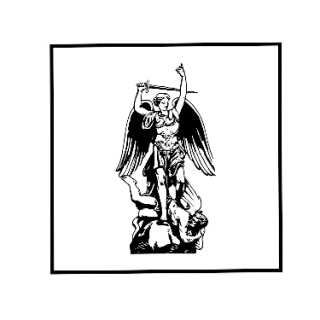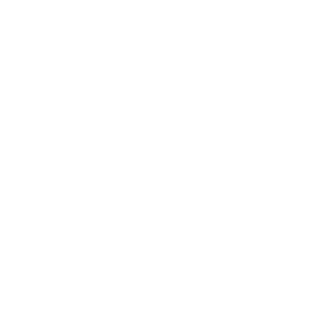Billie, jeune Afro-Américaine introvertie, garçon manqué, un œil en moins, entreprend de braquer une banque pour venir en aide à ses parents dans le besoin. Mais la situation tourne au fiasco, et elle n’a d’autre choix que de prendre en otage Franny, 18 ans, enceinte jusqu’aux dents, un caractère bien trempé et plus rien à perdre. Commence alors pour les deux jeunes femmes que tout oppose une cavale électrique à travers les grands espaces américains… jusqu’à ce que Franny propose à Billie un deal inattendu.
SILVER STAR
Fiction / France, États-Unis
BIOGRAPHIE
Ruben Amar et Lola Bessis se rencontrent en 2010 et écrivent à quatre mains un court-métrage, Checkpoint, tourné un an plus tard à un véritable checkpoint entre Israël et les territoires palestiniens. Primé au festival de Clermont-Ferrand, il poursuit sa route dans plus de 300 festivals internationaux. Forts de ce succès, ils réalisent un long-métrage, Swim Little Fish Swim, dans lequel Lola interprète le rôle principal. Tourné à New-York en marge des circuits traditionnels, il est présenté aux festivals de SXSW et de Rotterdam et suscite un vif engouement lors de sa sortie en salles. En 2017, ils produisent C’est qui cette fille, long-métrage de Nathan Silver dans lequel Lola joue. En 2024, ils réalisent leur deuxième longmétrage, Silver Star, un road-movie porté par deux jeunes héroïnes laissées pour compte de l’Amérique post Trump. Ils travaillent individuellement sur deux nouveaux projets en France et aux États-Unis
ENTRETIEN
En tant que Français, pourquoi aimez-vous tourner aux États-Unis ?
Ruben Amar : Quand j’étais petit, un vidéo club a ouvert en bas de chez moi : c’était une révolution. Je pouvais voir jusqu’à 2 ou 3 films par jour et surtout revoir certaines scènes encore et encore jusqu’au lendemain où il fallait se résoudre à rendre les cassettes… À l’époque il n’y avait quasi exclusivement que des films américains qui étaient édités sur VHS et en particulier du Nouvel Hollywood. C’est ce cinéma qui a forgé mon désir de faire des films, car il était empreint d’une grande liberté, d’un esprit contestataire. C’est donc naturellement que j’ai ancré mes premiers scénarios dans un contexte américain. J’ai tourné deux courts-métrages à New York juste avant de rencontrer Lola.
Lola Bessis : En 2012, Ruben m’a convaincue d’emménager à New York où j’ai étudié le cinéma tout en travaillant sur des films. On venait de terminer un court-métrage, Checkpoint, à la frontière israélo-palestinienne. En arpentant les festivals américains avec ce film, et en fréquentant un petit cinéma indépendant à Brooklyn, on a découvert et côtoyé toute une scène émergente de cinéastes qui nous a beaucoup inspirés car ils s’affranchissaient de toutes les barrières techniques et financières. Faute de guichets et d’aides publiques, ils faisaient leurs films avec très peu de moyens mais une grande liberté. C’est cette énergie contagieuse qui nous a poussés à faire notre premier long, Swim Little Fish Swim, avec le peu de gains générés par notre court-métrage.
Quelle a été la genèse du projet ?
Ruben : Après New York, on a vécu en Australie où Lola avait décroché un rôle dans une grosse série. C’est là qu’on a assisté à la première élection de Trump. Observer à distance la métamorphose de ce pays qui avait été le nôtre, le racisme et l’homophobie exploser, les droits des femmes régresser, les écarts socio-économiques se creuser, cela nous a profondément impactés. On se sentait complètement impuissants.
Lola : Et puis il y a eu le meurtre de George Floyd… C’est alors naturellement qu’on a commencé à écrire cette histoire ancrée dans l’Amérique d’aujourd’hui. Nous ressentions le besoin de faire un film qui fait du bien dans ce contexte politique-là en offrant à nos personnages la possibilité d’envisager un avenir meilleur. Et plus on a avancé dans l’écriture, plus on a souhaité y insuffler de la comédie, dans les dialogues, mais aussi dans les situations en ancrant nos personnages dans une tradition de pieds nickelés à la Judd Apatow. Cette tonalité nous a semblé juste pour traiter de ces sujets avec la distance nécessaire. Le film ressemble à un conte de fée d’une certaine manière…
Que représentent pour vous les personnages de Franny et Billie dans l’Amérique actuelle ?
Lola : Billie et Franny, à travers leur déambulation, nous donnent à voir une Amérique déchirée, loin des grands espaces fantasmés et du rêve américain. Ce sont deux jeunes femmes en apparence opposées mais qui ont en commun d’avoir été abandonnées par le système social, judiciaire, économique. L’une blanche, enceinte, probablement dans l’incapacité légale ou financière d’avorter, et l’autre noire, issue d’une famille de militaires, victime de violences policières et en proie à des questionnements identitaires. Elles vivent toutes les deux dans la précarité et n’ont plus grand-chose à perdre.
Ruben : Billie représente toute la complexité de l’Amérique d’aujourd’hui. Elle est issue d’une famille très patriote, de vétérans qui se sont battus pour défendre leur pays, pays qui a tendance à traiter les Afro-Américains comme des citoyens de seconde zone, avec une justice à deux vitesses. Au passage à l’âge adulte, elle ne s’identifie plus vraiment à ces valeurs, elle réalise à ses dépens ce qu’implique d’être noire aux États-Unis aujourd’hui, et par ailleurs, on s’imagine qu’elle se pose des questions sur sa sexualité, peut être même sur son identité de genre. Quasi mutique, elle ne trouve pas les mots pour exprimer ses sentiments contradictoires. Franny est le côté face de cette Amérique qui se veut exubérante et ultramoderne. Contrairement à Billie, elle ne s’arrête jamais de parler, comme par peur du vide. C’est la confrontation entre ces deux personnages qui nous plait et va raconter quelque chose d’actuel sur cette Amérique déchirée entre conservatisme et quête incessante de progrès.
Le film fait aussi référence à la guerre de Sécession, pourquoi avoir voulu faire dialoguer le passé et le présent ?
Ruben : La société américaine est une société fracturée depuis sa création. Moins d’une centaine d’années après la déclaration de son indépendance, le pays s’est déchiré violemment dans une guerre fratricide avec pour seul point de discorde la question de perpétuer ou non l’esclavage. Et l’héritage de cette guerre fait encore partie de la culture américaine, au point que d’impressionnantes reconstitutions grandeur nature de batailles ont lieu chaque année. Cette fascination des Américains pour leur histoire nous a interpellés et questionnés sur ce qui avait réellement changé en un siècle et demi.
Lola : Les parallèles entre l’ère de Trump et cette époque nous sont alors tristement apparus – une Amérique scindée en deux, le racisme, l’attrait pour la violence et les armes – nous rappelant que le présent est le fruit du passé. Il nous a alors semblé pertinent de plonger Billie dans l’univers très particulier des reconstitutions. Sa rencontre avec Franny, qui elle vit dans le présent pour mieux oublier son passé, incarne ce dialogue en miroir entre passé et présent qui se ressent jusque dans le style visuel du film, les décors, les costumes, l’éclectisme des musiques…
Ruben : On a tourné durant une vraie reconstitution, en mode documentaire. C’était surréel, comme si on voyageait dans le temps. Les voitures sont laissées au parking et il n’y a plus que des campements, l’odeur du bois et des chevaux partout,tout le monde vit vraiment comme en 1860.
Comment avez-vous envisagé la question de la performativité de genre des personnages ?
Lola : On a volontairement écrit le personnage de Billie indépendamment de son genre. C’est d’ailleurs pour ça que le personnage a un prénom mixte, parce qu’on voulait ouvrir le casting à tous. Néanmoins on a toujours souhaité que Billie ait une identité de genre un peu perméable, aux contours flous, parce que ça nous semblait intéressant dans son cheminement personnel qu’elle soit à un moment charnière de questionnement identitaire à tous les niveaux. D’autant plus que son adolescence, moment où l’on se définit le plus, lui a été volée quand elle a été mise en prison.
Ruben : Le fait que le personnage soit finalement interprété par Troy Leigh-Anne Johnson tout en n’ayant pas été écrit spécifiquement pour une femme, je pense que ça contribue à créer un personnage féminin qui n’est pas archétypal. Et cela donne à la relation entre Billie et Franny une portée universelle. Lola : On a d’ailleurs pris la liberté artistique de lui donner comme aïeul Cathay Williams, première femme noire à s’enrôler dans l’armée en se faisant passer pour un homme car les femmes n’étaient pas admises. Comme elle, Billie arbore des codes généralement attribués au genre masculin, tandis que Franny se définit par son ultra-féminité assumée, et ce qu’elle en fait. Son exubérance, sa façon de s’habiller, de se maquiller, lui servent de carapace, de bouclier et lui permettent de se sentir forte. Elle écoute du rap engagé et est beaucoup plus féministe qu’elle n’y parait.
Le choix des actrices qui jouent les rôles de Franny et Billie a-t-il été évident ?
Ruben : Le casting a duré très longtemps. On s’est battus pour résister aux injonctions des financiers, on voulait à tout prix trouver les bons interprètes. Le rôle de Franny a attiré beaucoup de jeunes actrices car il y avait du texte à jouer, un vrai personnage de composition. On a vu quasiment le tout Hollywood entre 18 et 25 ans. On ne voyait que des excellentes actrices mais on ne trouvait pas cette singularité qu’on recherchait pour Franny.
Lola : Nous avons alors reçu une demande de l’agent de Sydney Sweeney qui était tombé sur le scénario mais malheureusement il était difficile de faire converger son emploi du temps avec les dates de tournage donc nous sommes repartis en casting. C’est là que je suis tombée sur l’annonce du casting de la saison 4 de Stranger Things ! J’ai alors googlelisé Grace Van Dien. À première vue, elle semblait un peu sage sur les interviews et en même temps, on sentait un petit truc décalé, un rire mutin, une voix perchée, qu’on avait envie de creuser. Elle nous a envoyé une vidéo de casting et là ça a été assez évident mais la vraie révélation, c’est quand elle a fait les premiers essayages costumes : Grace et Franny n’ont fait plus qu’une.
Ruben : Pour le rôle de Billie, ce fût presque encore plus difficile car elle parle peu et tout se joue dans les expressions, le regard. On recherchait donc un jeu très subtil. Et en même temps, il nous fallait quelqu’un de très charismatique, aux abords assez durs mais avec une vraie sensibilité derrière son armure. Un soir, nous avons reçu une salve d’auditions filmées. Lola a lancé les vidéos et soudain j’ai entendu une voix, une sensibilité, sans même voir son visage. On a échangé un regard : on avait trouvé Billie.
Lola : Nous étions à peine à un mois du tournage ! Nous l’avons rencontrée en visio et avons alors découvert une jeune fille fluette,très féminine,rien à voir avec Billie de prime abord, mais dès qu’elle se mettait à jouer, elle se métamorphosait, c’était impressionnant.
Cadres serrés, caméra portée, travail sur la lumière et le montage : comment avez-vous défini l’identité visuelle du film ?
Lola : On voulait que le film soit visuellement dynamique. Du fait des contraintes budgétaires, on avait très peu de matériel et de temps d’installation, pas de voiture travelling ni aucun dispositif permettant de filmer depuis l’extérieur de la voiture. Donc on a vite fait le deuil des paysages, des grands espaces. On a choisi de faire de la contrainte un parti pris artistique et de l’assumer à fond. On filmait tout en caméra embarquée dans la voiture, à l’épaule, ce qui nous offrait une grande liberté. La caméra est nerveuse, comme les personnages, et évolue au même rythme qu’eux.
Ruben : Lola était enceinte de 7 mois, cachée dans le coffre de la voiture avec son gros ventre, son combo et l’ingé son, pour diriger les comédiennes ! On a principalement tourné en lumière naturelle. Le problème c’est que dans le New Jersey, en hiver, il n’y en avait pas beaucoup ! Mais pour contrebalancer, on a essayé de trouver des décors avec des couleurs fortes, des néons. Ça s’est aussi beaucoup joué dans les costumes et à l’étalonnage. On a souhaité utiliser une large gamme de couleurs, de la saturation, pour refléter la dynamique intérieure des personnages et toute leur palette d’émotions contrastées.
Lola : On a choisi de tourner principalement au téléobjectif, en très gros plans. La caméra est utilisée comme un microscope, pour rester au plus près des personnages. Cela crée un sentiment d’enfermement qui reflète celui de Billie qui a passé de longs mois en prison et de Franny, prisonnière de sa situation, de son corps. Avec le téléobjectif, la caméra est beaucoup plus sensible au moindre mouvement, et en voiture, à l’épaule, ça bougeait beaucoup ! Il y a donc eu des accidents, des plans qui bougent trop, qui sautent presque, mais au montage, comme on avait très peu de prises, on a préféré privilégier la performance, le fond, quitte à ce qu’il y ait des imperfections dans la forme. Mais d’une certaine manière, on trouve que ça fait sens pour le film car cela reflète la trajectoire semée d’embuches, en perpétuel mouvement, de nos deux héroïnes.
On pense à l’univers contemporain de Sean Baker, des Frères Safdie ou d’Andrea Arnold. Est-ce que c’est une comparaison qui vous parle ? Aviez-vous en tête des inspirations et références cinématographiques ou autre pour le film ?
Ruben : Bien sûr ! Ce sont des réalisateurs dont le parcours nous inspire et le fait qu’on nous compare souvent à eux nous flatte. Sean était venu voir notre premier film lors de sa sortie et nous a d’ailleurs conseillés sur Silver Star. Il a commencé comme nous en faisant des petits films autoproduits et a réussi à conserver la même liberté, comme les Safdie d’ailleurs. Ce sont des cinéastes qui se battent pour faire perdurer le cinéma indépendant tout en le rendant accessible au grand public, à une époque où tout est fait pour le faire disparaître. On a adoré Anora et on y a vu des similitudes avec Silver Star, le fait qu’il traite de sujets de société comme la prostitution tout en en faisant une sorte de conte de fées moderne, à la fois drôle et piquant. En France, il y a encore une sorte de snobisme vis à vis de la comédie, du cinéma populaire, alors qu’aux États-Unis il y a plus de ponts, de perméabilité entre les genres.
Lola : Le film a aussi beaucoup été comparé à Thelma et Louise mais, même si c’est un film mythique qui fait partie de notre inconscient collectif, ce n’était pas vraiment une référence. Nous avons surtout été inspirés parles road movies du Nouvel Hollywood et ceux qui ont suivi, avec en tête L’Épouvantail de Jerry Schatzberg, La Balade sauvage de Terrence Malick ou Five Easy Pieces de Bob Rafelson… Et aussi les films de Wim Wenders comme Alice dans les villes et Paris Texas. Buffalo 66 de Vincent Gallo et Macadam Cowboy de John Schlesinger ont été assez fondateurs sur la construction du duo.
Ruben : Et aussi Wanda de Barbara Loden ou Rosetta des Dardenne qui nous ont accompagnés dans la construction du background de Franny. Nous avons aussi effectué un gros travail préparatoire, surtout à partir de reportages photographiques et notamment celui de la photographe Brenda Ann Kenneally, “A Chronicle of Life and Pain in Upstate New York” , dans lequel elle photographie des teen moms – des adolescentes enceintes ou jeunes mères – dans leur environnement. On a aussi été très inspirés par la photographe Mary Ellen Mark qui a centré son travail sur la jeunesse en marge de la société dans les années 80. De son travail a découlé un documentaire incroyable, Streetwise, réalisé par son mari Martin Bell, qui suit des adolescents des rues à Seattle.
ENTRETIEN
CINEMATEASER
Histoire d’une sororité lancée à 100 à l’heure sur la route de la revanche sociale, ce SILVER STAR surprend et prouve, si besoin était, que les petits budgets ne font pas des petits films, mais bien souvent des petits films au grand cœur et à la tête bien pleine.
LE POINT
Film de fuite et de tension, tourné souvent caméra à l’épaule, Silver Star offre aussi de jolis moments burlesques qui rappellent que la vie s’invite parfois dans la panique.
LIBÉRATION
Le «buddy movie» de Ruben Amar et Lola Bessis suit, dans un esprit de sororité réjouissant, la cavale d’une voleuse énuclée et de la punk enceinte qu’elle a prise en otage.
POSITIF
Ce road movie réalisé par deux français a cependant une facture de parfait petit film indépendant américain : scénario malin, décors naturels, caméra portée, interprétation dynamique…
SO FILM
Une ode à la sororité, tendre et improbable.
aVoir-aLire.com
Road movie réjouissant et positif porté par ses deux actrices principales : Grace Van Dien et Troy Leigh-Anne Johnson.
LE MONDE
Les réalisateurs tirent beaucoup d’humour et de charme des personnalités contrastées de leurs deux personnages.
PREMIÈRE
Il y a du Thelma et Louise et du Sweet East de Sean Price Williams dans ce « road buddy movie » où le duo Bessis- Amar parvient à mêler un regard quasi documentaire et ce sens de l’humour malicieux qui dominait Swim Little Swim Fish.