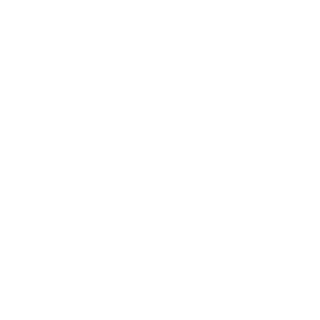Documentaire / France, Suisse
LÀ OÙ DIEU N'EST PAS
Taghi, Homa et Mazyar ont été arrêtés et interrogés par le régime iranien. Tous les trois témoignent avec leurs corps, avec leurs gestes et racontent ce que signifie résister, ce que signifie craquer.
Y a-t-il un espoir que le tortionnaire renoue un jour avec sa conscience ?

ANNÉE
RÉALISATION
SCENARIO
AVEC
FICHE TECHNIQUE
DATE DE SORTIE
2023
Mehran TAMADON
Mehran TAMADON
Taghi RAHMANI, Homa KALHORI, Mazyar EBRAHIMI
1h52 – Couleur – Dolby Digital 5.1
15 mai 2024
BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR
Après des études d’architecture à Paris, Mehran Tamadon décide de se consacrer à la réalisation. Il réalise son premier moyen-métrage documentaire, Behesht Zahra, mères de martyrs en 2004, puis Bassidji en 2010, où il filme ses premières tentatives de dialogue avec les défenseurs du régime iranien. Il poursuit cette démarche avec Iranien (2014), où il convainc des partisans du régime de vivre en cohabitation avec lui. Ses nouveaux films, Mon pire ennemi et Là où Dieu n’est pas, présentés à la Berlinale en 2023, abordent la violence des interrogatoires et des détentions en Iran.
ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR
Vous avez réalisé Là où Dieu n’est pas en parallèle à Mon pire ennemi. Les deux films sont différents tout en entrant en résonance. Aviez-vous dès le début l’idée de réaliser deux films, ou est-ce une décision que vous avez prise en cours de route ?
L’idée de Mon pire ennemi m’a rongé durant sept ans ! Je l’ai écrit de 2015 à 2017, une écriture compliquée à tous points de vue. Mes producteurs ont ensuite déposé le dossier auprès de commissions de financement et nous sommes rapidement parvenus à réunir l’argent pour tourner le film. Mais le dispositif du film était tellement tordu et compliqué qu’il m’a fallu deux ans pour oser le filmer, fin 2020. C’est ensuite le montage qui fut laborieux au point que j’ai dû l’interrompre. C’est durant cette période de latence que j’ai écrit, tourné et monté Là où Dieu n’est pas. Cela m’a alors permis de mieux comprendre ce que je cherchais dans Mon pire ennemi et de terminer son montage. Le tournage de Là où Dieu n’est pas m’a énormément ému, j’étais profondément ébranlé par les récits des personnages que je filmais, par leur humanité, par leur force. Là où Dieu n’est pas est un documentaire relativement classique dans sa forme mais l’expérience du tournage a été nécessaire pour faire mûrir l’ensemble des réflexions que j’avais entamées sept ans plus tôt. Chronologiquement, j’ai d’abord filmé Mon pire ennemi et j’ai terminé en premier Là où Dieu n’est pas. Je considère maintenant que Là où Dieu n’a pas précédé Mon pire ennemi.
Comment avez-vous rencontré les protagonistes de Là où Dieu n’est pas ?
Lorsque je préparais Mon pire ennemi, je voulais faire venir à Paris beaucoup d’Iraniens exilés qui vivent dans les différents pays européens. Mais le COVID a limité mes choix à ceux qui résident en France. Plus tard, pour Là où Dieu n’est pas, le confinement était fini mais j’avais alors déjà procédé au choix de mes protagonistes. Dès le début, j’avais décidé de ne filmer que Taghi Rahmani qui habite à Paris, Homa Kalhori qui vit en Angleterre et Mazyar Ebrahimi qui vit en Allemagne. Ils ont chacun des parcours différents et même s’ils sont tous les trois opposés à la République islamique, ils n’ont pas forcément la même orientation politique. Ils ont par ailleurs subi la prison et la torture à des périodes différentes du régime islamique. Ils ont ensuite réagi différemment à la violence qu’ils ont subie, en développant chacun des stratégies de survie différentes. Leurs récits, leurs manières de réagir face à la caméra, leur façon de s’approprier le dispositif de reconstitution m’a permis de construire la narration du film.
Qu’est-ce qui vous a interpellé dans leurs récits de prison ?
Lors de mes premières discussions avec Mazyar Ebrahimi, il m’a demandé de reconstituer la salle de torture. N’ayant jamais vu une salle de torture, je ne voyais pas comment lui donner moi-même une réalité dans un cadre documentaire. Je lui ai alors proposé de reconstituer une salle de torture, de la fabriquer comme un décor de théâtre pendant que je le filme. Par ailleurs, lorsque je suis allé le rencontrer en Allemagne pour mieux le connaître et lui proposer de participer au film, j’ai tout de suite compris qu’il serait un beau personnage de cinéma. J’ai connu Homa Kalhori grâce à son livre dans lequel elle relate son expérience carcérale au début des années 1980. Elle faisait alors partie du mouvement de gauche «Raheh Kargar» et s’est fait arrêter à la même période que beaucoup de ses camarades. Quelques années plus tard, sous la torture, elle flanche et se repentit. C’est ce changement de bord politique qui m’intéressait initialement dans son histoire. Je cherchais quelqu’un qui puisse m’aider à comprendre comment on pouvait passer d’un bord à l’autre. En construisant la narration du film, d’autres questions sont ensuite apparues. Un film se fabrique aussi autour d’émotions et non uniquement de discours.
Enfin, Taghi Rahmani apporte une vraie énergie au film. Au moment où on est au bout du rouleau avec Homa et Mazyar, il montre avec son corps et ses mots comment il s’efforçait de résister en isolement. Taghi Rahmani, que je ne connaissais pas personnellement avant ce film, est depuis devenu un ami cher. Il prenait mes questions très au sérieux et y répondait avec beaucoup d’ouverture et de bienveillance. Les passages où je le questionne sur la psychologie du bourreau auraient pu l’agacer au point de me répondre avec dédain. Mais cela n’a jamais été le cas. Il a toujours considéré mes questions et apporté des réponses avec humilité, à l’échelle d’un homme qui s’interroge, sans jamais dénigrer celui qui lui fait face.
Comment le dispositif cinématographique particulier que vous avez mis en place a-t-il affecté vos protagonistes ?
Ils ont chacun réagi différemment. Mazyar Ebrahimi avait subi la torture avec les yeux bandés. Il ne voyait donc pas la scène, ce qui est effrayant. En reconstituant le lieu, il avait l’impression de voir enfin ce qui se passait à l’époque. Il me parlait d’une peur qui était en train de le quitter. Pourtant, tôt le matin, lorsque nous sommes arrivés sur le lieu de tournage, il avait très mal à la tête et avait des nausées. C’est au bout de quelques heures, lorsqu’il a fabriqué le lit et qu’il a accroché la chaîne, qu’il a enfin eu l’impression de comprendre ce qui s’était passé à l’époque. La reconstitution l’a calmé.
Tout comme Homa Kalhori. Même si elle avait déjà publié un livre dans lequel elle s’était exposée, en racontant sa honte et pourquoi elle avait flanché, il me semble que le tournage du film a également eu pour elle une dimension cathartique. Car témoigner à haute voix, devant la caméra qui lui faisait très peur, ce n’est pas la même chose que témoigner par écrit, dans un livre. Il me semble même que, pour Homa, le processus du film ne s’est pas arrêté au tournage. Elle assume enfin publiquement, à visage découvert, ce qui s’est passé à l’époque, ce fardeau qu’elle a porté toute sa vie.
Pour Taghi Rahmani, c’était tout autre chose. La question carcérale n’est pas de l’histoire ancienne pour lui. Il est toujours un activiste politique. Il a fait quatorze années de prison. Et il continue d’envisager de repartir en Iran, sachant que s’il rentre, il sera à nouveau incarcéré. Faire les cent pas devant ma caméra et dans une cellule, pour lui, c’est parler de ce qui pourrait lui arriver demain. Sa femme est toujours en Iran, elle y est actuellement incarcérée, comme beaucoup de ses amis. Pour lui, rejouer ces scènes n’a donc pas été thérapeutique. En montrant les gestes, il milite, il dénonce, mais il souffre.
On voit dans le film que Homa Kalhori résiste à l’idée de rejouer certaines scènes, tout comme Mazyar Ebrahimi qui est quelque peu chamboulé en vous voyant allongé sur le lit. Avez-vous hésité à leur demander de rejouer les scènes ?
C’est vrai que je fais une proposition délicate et la question est d’ailleurs soulevée dans le film. Je tente toujours dans mon cinéma de mettre en abîme les questions éthiques que soulève ma démarche. Disons qu’avec Mazyar Ebrahimi, on avançait progressivement. Il y avait souvent des temps de pause durant lesquels il me disait s’il voulait s’arrêter.
LISTE TECHNIQUE
Chef opérateur Patrick Tresch
Ingénieurs du son Térence Meunier, Marc Parazon, Laurent Malan
Montage Mehran Tamadon, Luc Forveille
Montage son Simon Gendrot
Mixage Philippe Grivel
Étalonnage Robin Erard
CE QU'EN PENSE LA PRESSE
CULTUROPOING.COM
Là où Dieu n’est pas forme un diptyque avec Mon pire ennemi (…) Les deux œuvres, nées d’un même geste, abordent le même sujet et reposent sur des choix de mise en scène semblables. Chacune pourtant apporte son propre vertige. Et le choc reste intact. (…) Les images et les questions qui les parcourent hantent longtemps.
LES FICHES DU CINÉMA
Porté par un dispositif sobre et percutant, M. Tamadon donne la parole à trois Iraniens qui furent persécutés par le régime des mollahs. En reconstituant les conditions de leur détention, il livre un travail magistral, au plus près des mécanismes de la tyrannie.
CAHIERS DU CINÉMA
Là où Dieu n’est pas et Mon pire ennemi rompent à plus d’un titre avec Bassidji (2009) et Iranien (2014), où Mehran Tamadon initiait un dialogue avec des miliciens puis des mollahs défenseurs de la République islamique. Devant la caméra, cette fois, plus d’adversaires politiques, mais des Iraniens exilés après avoir subi interrogatoires et tortures dans les geôles du régime.
TÉLÉRAMA
Avec ce second geste glaçant, Tamadon devient l’interrogateur et nous laisse sans voix.
LE MONDE
Remettant sur le métier la question de la simulation, Là où Dieu n’existe pas recourt à un procédé un peu plus classique, en demandant à des ex-victimes de sévices de remettre en scène leur passage par les prisons iraniennes.
LES INROCKUPTIBLES
Dans une forme documentaire plus conventionnelle, Là où Dieu n’est pas poursuit la recherche de Mon pire ennemi. Mehran Tamadon y recueille les témoignages de trois ancien·nes détenu·es politiques, dans une prison reconstituée à l’intérieur d’un entrepôt de la banlieue parisienne. Une nouvelle sobriété, volontairement moins performative, qui s’écrit simplement dans l’écoute attentive des récits.