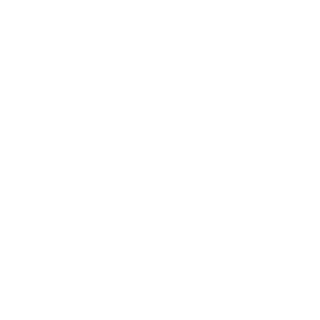L’Australie en 1835. Le neveu du gouverneur, Charles Adare, arrivant d’Angleterre, est convié à dîner chez un ancien forçat enrichi, Sam Flusky, qui est marié à l’une des cousines de Charles, Lady Harrietta. Charles Adare découvre que sa cousine, devenue alcoolique, est terrorisée par sa gouvernante Milly et, tout en s’efforçant de la guérir, il s’éprend d’elle…
LES AMANTS DU CAPRICORNE
Fiction / Royaume-Uni
HORAIRES DU 6 AU 12 AOÛT 2025
JEU 7 : 20h10
UNE RÊVERIE ROMANTIQUE
Entre Rebecca et Vertigo, une de ces rêveries romantiques d’Hitchcock où un portrait féminin fait le fond de l’intrigue. Le scénario avait été choisi par Hitchcock car il plaisait à Ingrid Bergman, une des vedettes hollywoodiennes les plus recherchées de l’époque. Par un emploi systématique et admirablement fluide des plans longs et mouvementés – technique reprise de La Corde, mais avec une autre finalité -, par une lenteur et une solennité voulues du récit, une dramatisation plus discrète que d’habitude, une ellipse quasi totale des scènes d’action, Hitchcock donne à ses personnages et aux relations qui se nouent entre eux une étrange épaisseur romanesque. Ce qui se passe à l’intérieur de leur cœur est la véritable matière du film. Les thèmes hitchcockiens du faux coupable et de l’aveu salvateur ont un rôle tout à fait insolite dans l’économie de l’intrigue puisque le faux coupable l’est ici volontairement et que le contenu de l’aveu repose en réalité sur la révélation d’un sacrifice dont le bénéficiaire ne veut plus être seul à avoir connaissance. Tous les personnages vont à l’extrême de leurs sentiments, qui sont en l’occurence de grands sentiments , et une suite de sacrifices réciproques les enchaîne les uns aux autres plus solidement qu’un complot. Même l’ange noir du film (la gouvernante Milly) agit par un sentiment d’amour profond qui, sans aucunement l’absoudre, la met parfois au niveau des autres personnages. Les Amants du Capricorne est aussi un des plus beaux Technicolor de l’histoire du cinéma. Superbe musique de Richard Addinsell, le compositeur de La belle Espionne de Raoul Walsh (1953). Incompris par le public et la critique (à l’exception des rédacteurs des «Cahiers du Cinéma»), détesté sur le moment par Hitchcock qui vit dans son insuccès un grand motif de honte (ce qui prouve après tout beaucoup d’humilité), ce film où la parole a une extrêmeimportance, notamment en tant qu’exorcisme du passé, est un des joyaux de l’œuvre hitchcockienne.
Jacques Lourcelles – Dictionnaire du Cinéma – Editions Robert Laffont
LA BEAUTÉ MAJESTUEUSE DES AMANTS DU CAPRICORNE SELON CLAUDE CHABROL ET ERIC ROHMER
La réussite commerciale très estimable de La Corde permit à Hitchcock de mettre au point, comme il l’entendait, la production des Amants du Capricorne qu’il tourna en Grande-Bretagne. Son grand rêve se réalisait. Le tournage fut un véritable cauchemar. Ingrid Bergman avait sa pensée ailleurs et les rapports entre le metteur en scène et sa principale interprète en furent quelque peu assombris. Ajoutez un échec commercial retentissant : l’on comprend que ce film, où il mettait tant de lui-même, ait laissé à Hitchcock son plus mauvais souvenir. Poutant, le « chef-d’œuvre inconnu », ainsi que le nomme Jean Domarchi, est à coup sûr le meilleur sujet qu’il ait jamais traité. Entendez : « sur le papier» doté d’un blason littéraire qui fait généralement défaut aux scénarios de ses autres films. Curieusement méprisé par la plupart des critiques qui le taxèrent de mélodrame, alors que l’intrigue, exempte de coups de théâtre et d’invraisemblances, repose sur la seule marche des passions, il fut si brillamment réhabilité par deux articles, l’un de Jacques Rivette, l’autre de Jean Domarchi que nous ne pouvons mieux faire que leur emprunter l’essentiel de leur commentaire : « On aimait Hitchcock pour le mauvais motif, nous dit Domarchi, le suspense… Comment ne pas être déconcerté par un film qui rejoint avec une aisance stupéfiante un leitmotiv fondamental de la littérature universelle ?» Ce leitmotiv, nous le découvrons dans les romans anglais du XIXème siècle, chez Balzac (Honorine, Le Curé de Village) ou chez Goethe (Les Affinités Electives). Le thème commun à toutes ces œuvres, ce n’est pas seulement l’éternel débat entre la liberté et la morale (conclu en général, par un renoncement, au profit de celle-ci), mais l’excès d’un remords, ou l’excès d’un scrupule dont le héros, et, plus souvent encore, l’héroïne ne se libèrent que par l’aveu. « Le sujet secret de ce drame, écrivait Jacques Rivette, est la confession, la délivrance du secret prise dans sa double acceptation : au sens psychanalitique, car elle délivre du souvenir en lui donnant un corps verbal, comme au sens religieux ; et l’aveu des fautes équivaut ici à leur rachat ».(…)
L’Australie en 1835. Charles Adare, neveu du gouverneur, débarquant d’Angleterre, est invité à dîner chez Sam Flusky, marié à l’une de ses cousines. Celle-ci, Lady Harrietta est plongée dans une torpeur due en partie à l’alcool et sciemment entretenue par Milly, la gouvernante. Charles veut guérir Harrietta, la soustraire à cette influence, et, peu à peu, s’éprend d’elle. La jalousie de Sam, fortifiée par les insinuations de Milly, éclate au cours d’un bal public. Scandale. Au retour, Harrietta découvre la vérité à Charles. « C’est elle l’auteur du meurtre dont son mari a endossé la responsabilité, elle a tué son frère qui lui reprochait de se laisser courtiser par un roturier ». Nouvelle dispute entre Sam et Charles au cours de laquelle ce dernier est blessé volontairement. Pour sauver l’ancien forçat du jugement qui le menace, Charles et Harrietta renonceront à leur amour naissant. « Le transfert de la responsabilité du péché scinda jadis le couple, l’un assumant la peine, l’autre la mauvaise conscience ; ce premier sacrifice mal consenti les oblige à s’abandonner à l’ivresse d’autres mutuels sacrifices incessamment renouvelés, et il ne leur sera possible de renoncer au sacrifice, pour accepter le bonheur, sans que le troisième ne doive à son tour assumer ce sacrifice». (J.R.). L’exigence morale des héros est donc extrême. « Hitchcock, constate Domarchi, opte ici, délibérément, et comme toujours, pour le ciel et contre l’enfer ; mais, à la différence de ses autres films, il accorde au ciel une très grande place… Les Amants du Capricorne constitue l’exacte réciproque de ses films «noirs». Le thème fondamental du secret qui lie une conscience à une autre, est le point de départ d’une entreprise, non d’asservissement, mais de libération»
Malgré l’élévation du ton, Hitchcock ne néglige pas les moyens les plus violents d’agir sur nos nerfs. Concession ? Heureuse concession, puisqu’elle nous vaut l’un des gros plans les plus chargés de sens de toute l’histoire du cinéma. Nous sommes au dernier quart d’heure du film. Milly sait que la résistance physique de sa maîtresse est arrivée à sa limite extrême et qu’une émotion brutale suffira à l’achever. Elle dissimule alors sous la couverture du lit une de ces têtes humaines momifiées que confectionnent les indigènes. Harrietta la découvre, pousse un cri étouffé et glisse au pied du lit, à demi inanimée. Milly, croyant qu’elle a perdu connaissance, replace la tête dans son emballage. Un très gros plan nous montre alors Harrietta entrouvrant une paupière lourde, et son visage exprime, en un instant, un tel luxe de sentiments divers (crainte et maîtrise de soi, candeur et calcul, rage et résignation) que la plume la plus concise perdrait plusieurs pages à l’exprimer. En fait, nous ne croyons pas ces quelques secondes moins extraordinaires que ce passage de Dostoïevski où le héros de La Douce, ayant ouvert un œil machinal, tandis que sa femme braquait sur sa tempe un revolver, se demande si celle-ci sait qu’il l’a vue, ou simplement attribue le battement de ses paupières à un geste habituel au dormeur. Ainsi le romancier et le cinéaste ont-ils su, l’un par le commentaire, l’autre par le génie propre à son art, pourvoir de la signification la plus subtile et la plus riche une donnée qui n’est pas moins mélodramatique dans le premier cas que dans le second. Ce n’est pas la première fois que nous pouvons relever une ressemblance entre l’œuvre de Hitchcock et celle de Dostoïevski. La Corde est plus proche, par l’esprit, de Crime et Chatiment, que toutes les adaptations cinématographiques qu’on a pu faire du roman. Ce court passage est plus frappant encore : l’analogie ne réside pas dans la situation seule, mais le traitement, dans un détail dont la beauté ne doit qu’à la mise en scène.
Dans ce film, nous voyons Hitchcock poursuivre l’expérience du plan long. Mais il relâche sensiblement la rigueur de la règle : une seule prise, celle de la confession d’Harrietta, a la durée d’une bobine entière. Ni l’unité de lieu (nous ne sortons guère de la maison de Sam ; mais nous en sortons tout de même), ni celle de temps (la structure est romanesque et non plus dramatique), ne sont respectées. La caméra se meut avec une aisance et une audace extrêmes (au point que le «quatrième côté», escamoté dans La Corde, nous est souvent montré), mais le décor participe beaucoup moins activement à l’action que précédemment. Sans parler, avec Rivette, d’une certaine laideur plastique qui fait ressortir la beauté toute morale de l’œuvre, avouons que ce film d’époque est l’un des plus abstraits de son auteur, et que la couleur, bien que souvent belle, concourt rarement à l’expression. Les objets, eux aussi, voient leur rôle réduit au minimum.
En revanche, la caméra serre de plus en plus près les personnages. Ce film est l’histoire d’un visage, celui d’Ingrid Bergman, comme l’était déjà Les Enchaînés. C’est lui que l’objectif scrute, fouille, tantôt burine, tantôt adoucit. C’est à lui que va l’hommage des plus belles trouvailles : celle entre autres que signale François Truffaut, lorsque Charles tend sa veste derrière une vitre et force Harrietta qui avait supprimé les miroirs par crainte d’y retrouver le reflet de sa déchéance, à contempler sa beauté toujours intacte. Le jeu, plus lyrique, est néanmoins exempt de toute emphase théâtrale. Notre attention se concentre sur les acteurs. Ils ne se livrent pas, pour autant, à quelques brillants exercices dont ils assumeraient à eux seuls la responsabilité. La précision mécanique de la mise en scène n’est tyrannique que pour les interprètes. Mais, libérés des conventions propres au langage cinématographique ordinaire, les gestes des personnages mêmes s’épanouissent en pleine liberté. Laurence Olivier, dans Rebecca, se livrait à un long monologue, préfigurant celui de Bergman : ici la caméra ne cesse d’être braquée sur l’actrice, alors que, là, un travelling descriptif sur le décor introduisait une diversion. Morceau de bravoure, certes, que cette confession : mais ne nous laissons pas éblouir par la seule prouesse technique. Ne voyons pas surtout dans ce long discours un artifice destiné à révéler au spectateur des événements antérieurs au drame. Le monologue ou la confidence, moyens ordinaires du théâtre, sont ici considérés comme une fin, comme une attitude privilégiée, extraordinaire même. Nous n’allons pas du discours au discours, mais du silence au discours, de la réticence à l’aveu. Le fait que l’héroïne parle est non moins important que ce qu’elle nous dit : « La parole fait fonction de «catharsis», elle marque le triomphe de la vérité sur l’apparence». (J.D.)
La beauté majestueuse des Amants du Capricorne annonce celle de La Loi du silence. Ces films sont parents, non seulement par le thème, mais par le rythme, conçus tous deux à la manière d’une marche lente, mais sûre, ponctuée d’arrêts brutaux. Si l’un et l’autre ne dédaignent pas d’agir sur nos nerfs, la sècheresse même de ces effets les épure, les rend plus «fascinants», que proprement terrifiants. Au plus fort de l’émotion qui nous étreint, ils nous laissent jouir du recul nécessaire à la contemplation des grandes œuvres d’art. Il suffit que ce recul soit pris au moins une fois. La profondeur de cette œuvre, plus manifeste, rejaillira, en quelque manière, sur les autres.