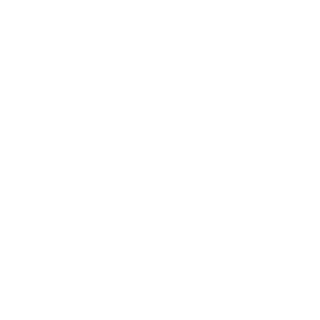Documentaire / France, Belgique
MA VIE EN PAPIER
À Bruxelles, lʼartiste et réalisatrice iranienne Vida Dena rencontre Naseem, père dʼune famille syrienne ayant fui la guerre. Entre les murs de leur logement précaire, elle dialogue avec les deux aînées Hala et Rima par le biais du dessin. Les petits morceaux de papiers colorés sʼaniment alors à lʼécran pour raconter les souvenirs, les rêves et le destin de cette famille en exil.

ANNÉE
RÉALISATION
SCENARIO
AVEC
FICHE TECHNIQUE
DATE DE SORTIE
2022
Vida DENA
Vida DENA
–
1h17- Couleur – Dolby Digital 5.1
31 janvier 2024
ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE PAR RORY O'CONNOR
Vous avez commencé à travailler sur « Ma vie en Papier » après avoir rencontré Naseem, un père qui venait de fuir la guerre en Syrie. Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Je suis également immigrée à Bruxelles. Je faisais partie d’un collectif multiculturel audiovisuel, composé d’immigrés iraniens, italiens, portugais et équatoriens. En 2016, nous avons organisé un atelier de narration pour les primo arrivants. Naseem avait alors 35 ans, était un réfugié syrien et avait récemment fui la guerre avec sa famille. Ayant reçu un soutien financier et gouvernemental, il avait été invité à participer à une série d’ateliers sociaux et culturels, sous couvert de pratiquer la langue et de s’intégrer. C’est là que nous nous sommes rencontrés pour la première fois.
Lors de l’atelier, on a demandé à chaque personne de raconter son histoire. Comme tout le monde n’avait pas encore appris le français à ce moment-là, j’ai décidé que nous devrions plutôt dessiner. Naseem, qui était venu seul, a dessiné des images de la guerre.
La première représentait un char d’assaut, sur lequel il avait dessiné le drapeau de l’Iran, mon pays. Lorsqu’il m’a montré le dessin, j’étais gênée et je me suis excusé. C’était le début de notre amitié. Le lendemain, il m’a invitée chez lui et j’ai rencontré sa famille.
Après avoir été reçue chez lui et rencontré sa famille, comment la relation s’est-elle développée ? Comment cette histoire commune inhabituelle a-t-elle conduit à l’élaboration du film ?
Leur appartement était en très mauvais état. Les murs étaient imprégnés d’humidité et il y avait des problèmes de chauffage. En dépit de cette situation, j’ai ressenti la générosité de leur famille. Cela m’a rappelé ma propre famille en Iran. Je me suis vraiment sentie chez moi. Après avoir rencontré les enfants de Naseem et sa femme, nous avons décidé de faire un film ensemble.
Naseem voulait que ce film soit un message au monde, qu’il montre les conséquences d’une fuite de la guerre et la difficulté de s’intégrer dans un nouveau contexte.
Il m’a fallu un certain temps pour trouver la bonne approche, car il se passait tellement de choses chez eux. Des images de la guerre en Syrie s’immisçaient constamment à travers la télévision. Mais une chose était claire pour nous tous, nous voulions aller au-delà des jugements politiques et découvrir la culture, les traditions et les opinions de chacun. Vous savez, malgré la situation politique, nos cultures ont en fait beaucoup en commun, notamment les habitudes alimentaires. Nous avons donc en quelque sorte surmonté l’ombre désagréable de ces politiques et abattu les frontières. Le film était une façon de montrer cette relation intime et comment elle s’est développée, malgré ce qui nous séparait.
Le film utilise l’art comme un moyen de se souvenir et de résister. Dans quelle mesure votre propre expérience d’artiste y a-t-elle contribué ?
Grandir en Iran n’était pas facile. Je suis devenue une artiste pour pouvoir m’exprimer par le biais de différents médiums. J’utilise l’art comme une arme pour résister, pour exprimer des choses entre les lignes, pour contourner la censure, pour me révolter. Un appareil photo est également une arme dans ma main. Je l’utilise pour montrer ou suggérer ce qui doit être vu, pour parler de ce qui est invisible. Quand j’ai rencontré cette famille, j’ai vu à quel point leur vie était invisible. En Belgique, les politiciens parlent de la pleine intégration dans la société belge comme si cela devait être la priorité immédiate pour les migrants à leur arrivée. Mais ils ont tendance à oublier les traumatismes que ces familles ont subis et subissent encore. La famille de Naseem avait une vie heureuse dans leur pays d’origine. Ils n’ont jamais pensé à partir avant que la guerre n’éclate.
Pour ce film, nous avons utilisé différentes formes. Comme nous ne parlions pas la même langue, l’art nous a permis d’avoir des conversations approfondies, j’ai commencé à animer des ateliers de dessin à l’intérieur de la maison. Toute la famille a apprécié, c’était un moyen pour eux de s’exprimer et je pense que cela avait même une certaine valeur thérapeutique. Nous avons donc partagé des dessins comme moyen d’exprimer nos sentiments et notre passé. Ces dessins étaient si puissants que j’ai décidé de les transformer en animation en stop motion.
Le film raconte donc leur histoire au présent, entre ces quatre murs de Bruxelles, à travers ma caméra, tandis que les dessins nous ramènent en Syrie, dans leur histoire passée.
Nous voyons les filles grandir et leur situation changer. Sur quelle période le tournage s’est-il déroulé ?
J’ai commencé à filmer en 2018 et j’ai continué à le faire jusqu’en 2020. Au cours de ces trois années, les deux filles sont devenues de jeunes adultes. C’est bien sûr une période spéciale pour un enfant, car beaucoup de choses changent au cours de cette période. Dans le même temps, la situation politique a changé. On est passé de l’espoir qu’elles pourraient un jour rentrer chez elles à la nouvelle que leur ville entière avait été détruite. Le tournage a eu lieu dans leur appartement la plupart du temps. Ils sont sortis, pour rendre visite à des proches et aller à l’école, mais la sécurité de l’appartement m’a permis de les filmer de manière très intime. C’était comme si nous étions sur un petit bateau sur lequel nous étions proches les uns des autres, nous tenant par la main et flottant sur un grand océan inconnu.
Le film est remarquablement intime. N’avez-vous jamais eu peur que la caméra soit intrusive ?
En fait, au début, je ne me considérais pas comme une cinéaste, ni comme une réalisatrice désireuse de faire un film sur eux. J’ai découvert leur histoire par amitié, par nostalgie de la chaleur de ma propre culture à Bruxelles. Ils me bombardaient de questions sur la façon de faire certaines choses en Belgique et j’essayais de les aider, que ce soit pour les formalités administratives ou d’autres choses. Ce n’était donc pas seulement ma curiosité pour leur histoire, mais aussi leur curiosité pour ma vie, car j’étais aussi une nouvelle arrivante en Belgique. On pourrait dire que le tournage n’a commencé qu’après que j’ai commencé à me sentir presque « chez moi ». Leur appartement était un espace vraiment minuscule dans lequel beaucoup de choses se passaient en même temps. Les enfants jouaient souvent autour. Parfois, ils jouaient même avec la caméra, me demandant de leur apprendre à l’utiliser.
Parfois, ils jouaient même avec la caméra, me demandant de leur apprendre à l’utiliser. Pendant ce temps, une narration participante se déroulait avec les dessins, à travers lesquels nous interagissions également. Nous découvrions différentes couleurs, parlions de dessin, d’art, de différents moyens d’expression. Nous avions tous le sentiment d’être ensemble, et pas seulement pour faire ce film. L’interaction était plus importante et la caméra n’était qu’une petite partie de cette interaction.
À quel moment avez-vous décidé d’intégrer l’animation de cette manière ?
L’idée de faire de l’animation m’est venue parce que je l’avais déjà fait dans les ateliers à Bruxelles. Avec les participants, nous découpions leurs dessins, les mettions en mouvement et les photographions image par image sur une petite table recouverte d’une simple serviette noire.
C’est ainsi que nous faisions les stop motions, très simplement. Dans le film, les arrêts sur image sont réalisés avec un banc-titre, sur un fond noir texturé. Aucun filtre n’est utilisé et tout est fait à la main. Je pense que plus un support est simple, plus il est honnête. C’est comme l’écriture pour moi, quand les mots sont simples, ils sont plus intimes. Cela ne veut pas dire qu’ils sont moins profonds.
Le langage était limité pour nous car nous étions tous dans un nouveau pays avec une nouvelle langue. Le dessin est devenu un moyen de communiquer et d’aller au-delà du langage. C’est aussi devenu un moyen d’exprimer, de méditer, de faire une sorte d’art-thérapie comme cela avait été le cas pour Naseem dans l’atelier où je l’ai rencontré pour la première fois.
Pensez-vous que le fait de dessiner peut aider les personnes qui travaillent sur ce genre de souvenirs ?
Je pense que d’une certaine manière, ça les a aidés. Parfois, quand on parle de quelque chose
qui nous est arrivé, ou qu’on fait de l’art, c’est comme une thérapie. C’est comme ça pour moi. Je ne pense pas que dessiner ces histoires les ait soulagés, mais le fait de relier leurs souvenirs au papier les a aidés à mieux comprendre leurs propres émotions.
Ce sentiment d’expression et de méditation par le dessin est devenu particulièrement intéressant pour la fille aînée, Rima, qui était introvertie et moins bavarde que sa soeur Hala et les autres. Pour Rima, il n’était pas facile de s’exprimer en français et elle rencontrait aussi plus de difficultés à l’école. Mais l’acte de dessiner nous a rapprochées, il a créé une sorte de confiance entre nous, il a coloré notre relation et donné un sens à nos rencontres.
Une grande partie du film est consacrée aux espoirs des filles pour l’avenir. Qu’aviez-vous entête pendant ces conversations ?
Je m’imaginais quand j’étais plus jeune, quand j’avais beaucoup de rêves. Cela fait partie de ce moment très particulier qu’est l’adolescence. Leurs rêves et leurs espoirs m’intéressaient, surtout lorsque je comparais ceux de Rima à ceux de sa soeur Hala. Pour Hala, le monde semblait être à ses pieds. Cela contrastait avec l’esprit de Rima. Elle était plus déterminée et son avenir semblait brillant, bien que moins intense. Dans ses dessins, les émotions sont très fortes, tout comme les traumatismes du passé, mais aussi les moments familiaux en Syrie avant la guerre, beaux et colorés, des choses qu’elle souhaite ardemment dans son propre avenir.
Ayant quitté l’Iran à un âge relativement jeune, avez-vous eu l’impression de pouvoir vous identifier à eux d’une certaine manière ?
Je suis née pendant la guerre et j’ai vécu dans la situation d’après-guerre à Téhéran, et pourtant mon enfance a été l’un des meilleurs moments de ma vie. Nous n’avions rien et nous avions tout. Pour que la vie soit belle, nous devions nous donner de l’amour, même plus que ce que l’on considérerait comme suffisant. Je pouvais très bien m’identifier à cette situation. Jouer avec ce que l’on avait et s’amuser, rire des problèmes que l’on avait, se moquer de la situation, avoir beaucoup de souhaits et d’espoirs, résister, et finalement devenir révolutionnaire.
Le film quitte rarement leur appartement. Pourquoi avez-vous décidé de raconter l’histoire entre ces quatre murs ?
Lorsque vous échappez à la guerre, vous êtes soudainement projeté dans un nouveau contexte.
Quitter son pays et ses traditions est la dernière chose que l’on souhaiterait, alors il faut un certain temps pour quitter ces quatre murs. Pour eux, en Belgique, tout était nouveau, de la culture à la langue.
La communication était difficile et les changements étaient radicaux. C’est un mélange de perte, de dépression et de traumatisme. Alors rester à l’intérieur avec ses proches, cuisiner sa propre nourriture, regarder ses propres films dans sa propre langue, parler de ses propres problèmes, rendre visite à ses proches, devient un moyen de se sentir chez soi.
J’ai voulu mettre l’accent sur l’amour et la chaleur qui existaient dans cette famille en dépit de leur situation difficile. Pour eux, la vie continue, et ils essaient toujours du mieux qu’ils peuvent d’en profiter et d’offrir un bel avenir à leurs enfants. Comme tout le monde. C’était mon objectif, et j’espère que cela pourra être compris par le public international.
À PROPOS DE LA RÉALISATRICE
Vida Dena (1984, Téhéran) est une artiste iranienne et une réalisatrice indépendante. Elle a obtenu sa licence en architecture à l’université d’art et d’architecture Azad de Téhéran. À l’été 2009, elle est partie en Suède pour poursuivre son master en beaux-arts à l’Académie des beaux-arts d’Umeå. Elle a également obtenu un master en cinéma à la KASK de Gand, en Belgique, en 2015. Actuellement, elle travaille comme artiste à Bruxelles, où elle dessine, peint, donne des ateliers aux enfants, adolescents et nouveaux arrivants, et est commissaire d’expositions et d’événements culturels. Elle fait également partie du collectif audiovisuel appelé Ciclope, ainsi que du collectif « Comment peut-on être persan ? »
LISTE TECHNIQUE
Image : Vida Dena
Son : Vida Dena
Musique : Noma Omran
Montage : Lenka Fillnerova, Frédéric Fichefet, Sophie Vercruysse
Ventes internationales : CAT&Docs
Production : Hanne Phlypo | Clin d’Oeil films
Eugénie Michelle-Villette | Les Films du Bilboquet
Coproduction : Wild Heart Productions, Atelier Graphoui, CBA – Centre de l’audiovisuel à Bruxelles, Shelter Prod
HORAIRES DU 30 JANVIER AU 6 FÉVRIER
Jeudi : 20h30