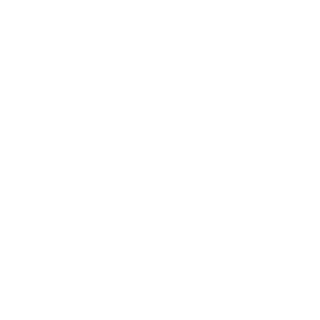À 13 ans, Pierre revient vivre à la ferme de son père après le décès brutal de sa mère. Harcelé à l’école, il se réfugie dans sa passion : le skate. Il rencontre Bertrand, un marginal qui cache un passé d’ancien skateur, et qui le prend sous son aile. Ensemble, ils vont tenter de se reconstruire.
OLLIE
Fiction / France
HORAIRES DU 18 AU 24 JUIN 2025
VEN 20 : 12h00
DIM 22 : 22h05
ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR
Ollie est le premier film de skate français. D’où vous vient cette thématique qui apparaissait déjà dans votre premier court, Le Skate moderne ?
Pour être plus précis, c’est la thématique du skateboard à la campagne qui revient à travers ces deux films. J’ai grandi dans cette culture, j’ai toujours surfé et skaté pendant ma jeunesse. Quand on a déménagé de la côte vers les terres, il n’y avait plus de vagues et plus de skateparks. J’ai alors rencontré une bande de skateurs des champs passionnés : les futurs protagonistes du Skate moderne. Il fallait composer avec les éléments autour de nous, chercher les rares coins bétonnés, les détourner, les améliorer avec des planches de bois, fabriquer nos propres modules. Mon regard sur la campagne a complètement changé, tout devenait un potentiel spot. J’ai très vite acheté une caméra de poing pour filmer nos sessions. De vidéo en vidéo, je suis tombé sur les films de Spike Jonze (ancien skateur) et puis sur Kids de Larry Clarke. Le choc. Le skate allait laisser sa place à une nouvelle passion, le cinéma. À la fin de mes études, j’ai voulu raconter notre histoire que je trouvais originale et atypique. Je voulais montrer comment on avait réussi à se réapproprier cette culture urbaine dans notre environnement rural.
Les territoires sont très peu mis à l’image dans le cinéma français, à part quelques exceptions (les films de Guiraudie, Petit paysan…), ils sont souvent vus à travers un œil très parisien. Ce que j’aime dans le cinéma indépendant américain, c’est que les cinéastes n’hésitent pas à montrer et nous immerger dans différents paysages, modes de vie, communautés des ÉtatsUnis. Je suis fan de ce cinéma-là (Sean Baker, Chloé Zhao…). Ayant grandi dans la campagne française en tant que skateur des champs, je voulais mettre les projecteurs sur cette pratique hors des sentiers classiques. De manière plus large, je voulais parler de la réappropriation des cultures urbaines dans les campagnes isolées. C’est un sujet qui m’intrigue depuis l’enfance, on a grandi avec les influences des villes en étant au milieu des champs.
Et puis, j’ai toujours été attiré par les communautés en marge, notamment celles de la ruralité. C’était pour moi évident de leur rendre hommage à travers mon premier long-métrage.
Votre court-métrage avait pour référence La Vie moderne de Raymond Depardon. Avez Vous des inspirations aussi pour Ollie ?
J’ai grandi dans une famille où l’on regardait des films à la télé, on n’allait pas au cinéma. Quand j’ai commencé la Fac de cinéma, on nous a tout de suite initiés au cinéma d’auteur. Le grand écart était un peu trop radical pour moi à l’époque, là où maintenant j’adore tout type de cinéma, il m’a fallu un temps d’adaptation, comprendre ce nouveau langage. Surtout qu’ayant grandi à la campagne, la plupart des films qu’on nous montrait étaient très bourgeois-parisiens. J’avais du mal à m’identifier. Et puis un jour, on nous a montré des extraits de la trilogie paysanne de Raymond Depardon. J’ai été happé, je suis tombé amoureux de ces longs plans sur la campagne, sur ces paysans, sur ce monde qui me ramenait à mon enfance. La Vie moderne a été pour moi une énorme claque que j’ai voulu revisiter à travers Le Skate moderne.
Pour Ollie, les années ont passé, la bande de jeunes skateurs a vieilli, la plupart ont des familles, un travail, sont rangés et une bonne partie ne skate plus. Pendant le confinement, j’ai appris la mort d’un des skateurs de la bande. Béranger aka Béber, sûrement le meilleur d’entre nous. Une vie d’excès qui l’a emporté. Cette nouvelle glaçante a résonné comme une évidence : il fallait parler de ces jeunes oubliés des campagnes, de l’ennui, de la sensation d’être abandonné qui cristallise la jeunesse des territoires. Je me suis repenché sur les récits initiatiques qui m’ont marqué. J’ai passé du temps à chercher et regarder les films alliant sport, dépassement de soi et addiction. Les films sur les marginaux. J’ai d’abord pensé à Fighter de David O.Russell pour la relation des deux frères face à la dépendance dans l’univers de la boxe. Puis à Billy Elliot de Stephen Daldry, et surtout à Mud de Jeff Nichols. La structure de ce film m’a beaucoup influencé. Cet adolescent paumé, impuissant face à ce couple parental qui se déchire et qui trouve dans le personnage marginal de Matthew McConaughey un grand frère, un père, un phare dans la nuit. Si l’on y regarde de plus près, les fondations d’Ollie sont très proches du film de Nichols. Un hommage est rendu à la fin du film à la figure de « Béber ».
Dans quelle mesure le scénario s’inspire-t-il d’événements et de personnages réels ?
Comme je le disais, Béranger était l’un des meilleurs skateurs de cette bande. Sûrement le plus engagé, téméraire, impressionnant à regarder. Il allait toujours plus haut que les autres, toujours plus vite. Mais c’était aussi le plus torturé, à 16 ans il buvait déjà cinq ou six 8-6 par jour. Ce qui nous paraissait super cool à l’époque est vite devenu glauque dans la vingtaine. C’était le seul noir de la bande, adopté dans sa petite enfance, il était à part. Un jour, il s’est blessé violemment en faisant un saut de marches énorme, son genou l’a lâché pour toujours. Après, ce fut la descente aux enfers. Béranger m’a toujours impressionné, dérouté, ce n’était pas un ami proche mais un « grand » que j’admirais. Le scénario n’est pas un biopic, il s’inspire de lui mais aussi d’autres personnages que j’ai croisés au cours de mon adolescence. L’histoire de Pierre évoque mon arrivée en Dordogne, avec un père difficile. Pierre cherche de nouveaux repères et affronte le harcèlement scolaire, avec comme seule échappatoire, le skate. On peut y trouver plein de liens, plein de connexions mais on ne pourra pas parler « d’histoire vraie », mais plutôt une inspiration libre de tout ça.
Quel(s) étai(en)t votre/vos objectif(s) en réalisant ce film ?
Mon objectif premier était de mettre en lumière ceux qu’on ne voit jamais au cinéma. Ces oubliés, ces laissés-pour compte. Pour ça, je voulais aborder une histoire universelle guidée par l’émotion. J’ai choisi de faire un coming of age avec une mise en scène assez classique pour parler aux gens qui sont montrés à l’écran. Combien de fois j’ai pu entendre ces phrases « cinéma d’intello, cinéma où on comprend rien… », je voulais éviter ça. Je voulais faire un film généreux. Un film qui se situe dans l’entre-deux, avec un côté auteur, pour garder la poésie qui habite mes films et un côté plus populaire, pour s’adresser à tous les spectateurs. Je voulais surtout faire un film d’émotions qui peut toucher tous les âges, ma grand-mère, les potes de mes parents et surtout les plus jeunes qui ne vont plus en salle.
Le protagoniste est un ado doué en skate. Comment avez-vous déniché le jeune acteur (Kristen Billon) qui l’incarne ?
Pour moi c’était très important que le film soit crédible sur l’aspect skate. Le skateboard est une culture à part, avec ses codes, et son authenticité, je voulais la préserver au maximum en la montrant à l’écran. C’est le premier film de skate français, il fallait qu’il soit validé par la communauté. À part pour le rôle de Bertrand (et encore je savais que Théo faisait du skate), je voulais exclusivement travailler avec des skateurs avant d’être des acteurs. Dans ce type de procédé de casting sauvage, il faut sentir le personnage, le charisme potentiel de chacun, quitte à réadapter le script pour l’acteur amateur qui sera choisi.
Florie Carbone a donc casté le rôle de Pierre à travers tous les skate-parks de France, Kristen a été trouvé en Bretagne. Il avait 13 ans à l’époque du film, quand je l’ai vu ça a été le coup de cœur, j’ai tout de suite visualisé Pierre, le personnage que j’avais écrit. Comble de la chance, c’est un excellent skateur (champion de France moins de 16 ans) et il avait déjà eu une expérience de cinéma. J’avoue être tombé sous le charme de son visage androgyne et sa justesse d’interprétation qui m’ont marqué. J’en ai parlé à Théo, on l’a rencontré et le binôme fut une évidence. Son côté introverti, calme et très mature créait un véritable contraste avec le côté plus délirant et hors-sol du personnage de Bertrand.
Et pour Bertrand, quel a été le travail de préparation avec Théo Christine ?
Pour Bertrand, le travail fut très différent. Ce fut un vrai rôle de composition, on a longuement parlé du personnage avec Théo Christine. Dans la vie, nous sommes très proches. On s’est rencontré en surfant il y a quelques années, nous avons fait un premier court-métrage ensemble dans lequel il m’a bluffé. Dès lors, je savais qu’il interpréterait ce rôle. Je lui ai fait passer des essais très tôt pour convaincre la production. Le plus compliqué a été de donner au personnage un côté aérien, touchant, doux, tout en conservant sa part de noirceur. On s’est évidemment inspiré de la vie de Béranger mais sans jamais le copier. Il fallait lui trouver une identité propre, flirtant avec le punk à chien délirant et le personnage mythologique. Théo a passé beaucoup de temps dans les communautés marginales des Soundsystems pour comprendre leur vocabulaire, leur mode de vie. Une fois la date de tournage d’Ollie validée, il s’est donné trois mois pour perdre 15 kilos et devenir Bertrand. Il skatait suffisamment bien pour faire luimême les scènes où il devait rouler mais c’est le seul personnage pour lequel j’ai pris une doublure pour répondre aux exigences de son passé d’ancien professionnel. On a passé ces précieux mois à étudier la démarche, le phrasé, les attitudes, à reprendre chaque réplique afin que tout soit juste et jamais dans l’exagération. Le marronnier de l’ancien junkie/alcoolique peut être fatal pour un acteur comme pour un film.
On se voyait régulièrement, on échangeait autour de films et de livres (Mad Love in New York, Panique à Needle Park…) et puis au cours d’une résidence en Aquitaine, on a fini par trouver Bertrand. Je filmais tout le temps avec mon téléphone, et je me rappelle que d’un coup, je ne voyais plus mon ami mais Bertrand à l’écran. Quand on a rajouté les dreadlocks, les tatouages et le dentier, c’est devenu perturbant. La fiction s’était invitée dans la réalité. Théo était devenu Bertrand, il a poussé le concept jusqu’au bout en vivant comme son personnage du matin au soir.
Y a-t-il des moyens techniques spécifiques ou des astuces pour bien filmer une scène de skate ?
Évidemment qu’il faut un œil expérimenté, pour sentir quel type de figure va être fait, comment bien la suivre, anticiper la replaque… mais la véritable astuce c’est la patience. Un trick peut mettre plusieurs essais à être rentré, ce qui est toujours compliqué sur la fabrication d’un film. Il n’y a pas de règles spécifiques. Enfin si, si l’on veut respecter les codes « classiques », on fait une line avec un grand angle en contre-plongée qui suit le rider. C’est ce qu’on a fait avec les vidéos d’archives pour leur donner l’aspect le plus réaliste possible. Après on a fait ce qu’on sentait le mieux pour la situation, pour l’affrontement de fin entre Joe et Kristen, on a choisi de filmer en longue focale au ras du sol avec Crystel Fournier [la directrice de la photo]. Et j’adore l’effet esthétique que ça donne, on est immergé avec les tricks, plus rien ne compte. Surtout, pour être plus tranquilles, on avait sorti du plan de travail un maximum de séquences de skate et moments intimes de Pierre et Bertrand. Ces sessions/séquences, je les ai tournées en micro-équipe avec les deux comédiens. On était quatre, mon assistant, Théo, Kristen et moi. On filmait les week-ends, et je pense que d’être derrière la caméra en petit comité, ça a énormément aidé les comédiens à me faire entièrement confiance. Enfin, je dois reconnaître avoir eu beaucoup de chance car tous les skateurs du film avaient un excellent niveau, et ils rentraient relativement vite les tricks. Filmer le skate n’a jamais été un réel handicap, je dirais même plus, un véritable plaisir.
Le film s’ouvre et se clôt musicalement avec la Pavane de Fauré, qu’on entendait déjà dans Le Skate moderne. Pourquoi ce morceau ?
La Vie moderne. Quand j’ai vu ce film et que j’ai entendu cette musique, j’ai été pris d’une très grande émotion. Cette musique est magnifique mais alliée aux paysages ruraux, elle a pris une toute autre ampleur à mes yeux. C’était donc pour rendre hommage à ces grands messieurs que sont Raymond Depardon et Gabriel Fauré.
Qu’avez-vous appris de cette expérience de première réalisation d’un long métrage de fiction ?
J’ai appris que le cinéma, c’était un endroit d’expression artistique magnifique. Un autre monde. Par rapport aux commandes sérielles, Ollie, c’est un projet que j’ai porté de l’écriture à la post-production ; l’investissement était total. Quand on fait un film, on passe par tous les états émotionnels, du pire au meilleur ; on doute, on jubile, on angoisse mais on ne lâche pas. Au contraire, l’adversité, la contrainte sont de vrais moteurs de créativité. Je me sentais habité par le film, les personnages vivaient en moi. C’était une sensation folle. J’ai tout donné, je voulais que l’histoire soit transcendée à travers le grand écran. Pour la salle, je me suis rendu compte que la recherche artistique est globale : le son, l’image, la musique, tout est travaillé comme de l’orfèvrerie.
De manière plus générale, cette expérience m’a beaucoup appris sur mon réel désir de cinéma. Elle m’a permis d’approfondir mes envies, mes obsessions, de questionner ce qui m’animait le plus au fond de moi au point de vouloir en faire un film. J’ai beaucoup appris sur la direction d’acteurs, sur l’improvisation, sur la façon de prendre le temps d’écouter les scènes pour mieux les capturer. D’ailleurs, je ne suis pas sûr de repartir sur un tournage « conventionnel » comme celui-ci pour mon prochain long métrage. J’aime les formes hybrides, les petites équipes, quand la fiction flirte avec le documentaire. Je ne pense pas être fait pour les grosses machineries sauf quand s’il s’agit d’une commande. J’ai envie de tester, d’expérimenter le plus possible avec le réel. Mais ce qui est sûr, c’est que ce premier film m’a convaincu que je voulais encore en faire plein d’autres.
BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR
Basé à Paris, Antoine Besse est un réalisateur de 33 ans. Il se fait remarquer en 2014 avec son premier court-métrage : « Le Skate moderne ». À mi-chemin entre fiction et réalité, ce film inspiré par « La Vie moderne » de Raymond Depardon se lit comme un documentaire fantasmé sur la vie des skateurs des champs.
Entre 2014 et 2016, « Le Skate moderne » remporte plus de 14 prix à travers le monde (Saint-Pétersbourg, Grenoble, Hambourg, Lille, São Paulo…) ainsi qu’une trentaine de sélections, dont une aux César 2017. En 2015, Antoine Besse revient avec « Courbes », un long documentaire autour de la surf culture. Il réalise en parallèle plus d’une vingtaine de clips et publicités chez Big Productions. Un an plus tard, il se voit confier la réalisation de la série « Red Creek » pour Canal +, incarnée par Lou De Lâage. La série est sélectionnée aux Globes de Cristal, Série Mania et Colcoa.
En 2019, le réalisateur est de retour avec «404», un court-métrage d’anticipation produit par Dazed. Il sort dans la foulée des clips pour les rappeurs Nekfeu (« Sous les nuages »), Kobo (« Nostalgie ») et Rad Cartier (« Cartier dimension »). En 2021, en plein Covid, il réalise « BTS » (Behind The Scenes), une mini-série expérimentale sur les coulisses d’un shooting caritatif qui part à la dérive portée par Laura Felpin et Alexis Manenti. Il réalise ensuite « Caro Nostra » une série de genre pour France Télévisions. Antoine Besse vient de terminer « Ollie » son premier long-métrage, produit par Rezo Productions, qui sortira en mai 2025 et écrit actuellement « Nightbird », son deuxième long-métrage dans le monde du surf caribéen.
CE QU'EN DIT LA PRESSE
CINEMA TEASER
Revêche, triste, le film sait aussi trouver la compassion et l’espoir dans le marasme sentimental (…).
FRANCEINFO CULTURE
Sans esbroufe, avec des moyens limités mais mis au service d’un récit très bien écrit et réalisé, « Ollie » emporte l’adhésion.
LES FICHES DU CINÉMA
Mêlant ruralité spleeneuse et récit d’apprentissage, « Ollie » intrigue et séduit. Théo Christine y est magistral.
ABUS DE CINÉ
Au final, la composition du film tout en finesse et en sensibilité, touchera le spectateur, qu’il soit fan ou pas de skate. Une agréable surprise côté cinéma français, que l’on retrouve en sélection Cannes Ecrans Junior.
CAHIERS DU CINÉMA
Un soupçon de poésie transparaît toutefois dans les gestes entre Bertrand et Pierre lors de leurs cours, où les mouvements de mains expliquent mieux que les mots comment réussir les figures tentées. Un langage des signes à la douceur bienvenue dans ce vacarme épuisant.
LE MONDE
Empreint d’une certaine noirceur, le film n’édulcore rien de la violence de rapports sociaux dévoyés par les codes de la virilité. A une approche purement spectaculaire, Antoine Besse préfère une forme de classicisme authentique pour creuser les failles de ses personnages confrontés à l’ennui et à la dureté du monde rural.
LE PARISIEN
Malgré quelques maladresses, on se laisse porter par le regard tendre de ce gamin déterminé et toucher par la façon dont les deux personnages se protègent et s’aident à grandir mutuellement. Les scènes de skate de ce film presque entièrement tourné en extérieur apportent du souffle à ce joli premier film.
PREMIÈRE
La timidité de Kristen Billon se heurte alors à la flamboyance du méconnaissable Théo Christine, qui émerveille par la finesse avec laquelle il chancelle entre désinvolture et mélancolie. De la rencontre entre ces deux êtres paumés germe un coming of age nostalgique qui réchauffe autant le cœur qu’il apaise l’esprit.
TÉLÉRAMA
Une fiction en partie autobiographique qui échappe aux clichés.
aVoir-aLire.com
Une émouvante chronique provinciale sur fond de skateboard. Un premier film réussi.