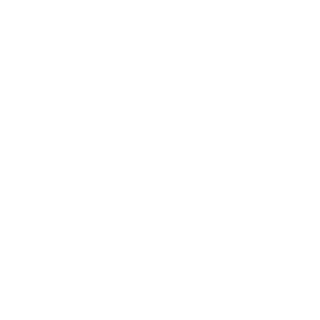Varsovie 1939. Entre deux représentations d’Hamlet, une troupe répète une pièce anti-nazie. Mais la guerre éclate et la Pologne est envahie. Pour aider la résistance à neutraliser un espion, les acteurs se font passer pour la Gestapo. Les vrais nazis entrent alors en scène…
TO BE OR NOT TO BE
Fiction / Etats-Unis
HORAIRES DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2025
SAM 27 : 22h10
HORAIRES DU 1ER AU 7 OCTOBRE 2025
à venir
SUR LE FILM
To Be or Not to Be a étrangement été un chef-d’œuvre dont personne ne voulait avant le tournage et qui fut très mal reçu à sa sortie. Il s’agit sans doute du film le plus connu de son auteur, mais aussi l’un des moins « typiques » parce qu’il sort à la fois des canons de la production hollywoodienne traditionnelle et de ceux de la comédie dite « sophistiquée » – genre accaparé par Lubitsch dès le muet. Il reste dans l’histoire comme l’une des grandes fictions politiques du siècle dernier. C’est aussi tout simplement l’un des films les plus drôles jamais tournés. Tout ce qui vient d’être dit doit être expliqué.
Il était difficile de quitter la Paramount dans les années 1930 et 1940. Preston Sturges en fera l’amère expérience une décennie après Ernst Lubitsch : la liberté artistique et la qualité des collaborateurs créent un « esprit maison » que l’auteur de Les Voyages de Sullivan (Sullivan’s Travels) ne retrouvera jamais après la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle il a réalisé deux films par an pour la firme d’Adolph Zukor.
Le problème était sensiblement différent pour Lubitsch. À son arrivée aux États-Unis en 1922, s’il avait été invité par Famous Players-Lasky (c’est-à-dire l’ancêtre de Paramount), le cinéaste a tout d’abord travaillé pour Mary Pickford et United Artists, puis pour la Warner. Il a ensuite œuvré pour la MGM, Universal et même Paramount dès 1928. Mais c’est avec le parlant et Parade d’amour (The Love Parade) que Lubitsch, alternant opérettes et comédies, a commencé l’identification de sa destinée avec celle du studio Paramount. Fait marquant dans l’histoire de Hollywood, il a été, comme on l’a vu, le seul cinéaste à diriger le plus important des studios en 1935. C’est dire la confiance des responsables à l’égard d’un homme aussi puissant que Cecil B. DeMille et aussi talentueux que Josef von Sternberg, autres étoiles artistiques du plus européen des studios américains. Or, après 1938 et la réalisation de La Huitième Femme de Barbe-Bleue (Bluebeards’s Eight Wife), Lubitsch se sépare de Paramount, devient un freelance de luxe qui pige royalement pour la MGM en réalisant Ninotchka et Rendez-vous (The Shop around the Corner,1940).
Contrairement à ce qui arrivera à Sturges, prisonnier d’une collaboration avec Howard Hugues, Lubitsch ne perd pas au change. Il avait déjà travaillé pour la firme au lion (Le Prince étudiant (The Student Prince), La Veuve joyeuse (The Merry Widow), pouvait à la fois compter sur les stars maison (Greta Garbo dans un cas, James Stewart dans l’autre) et sur ses plus dévoués collaborateurs au scénario (Wilder et Brackett, aidés par Reisch sur Ninotchka, l’ami Raphaelson pour le film « hongrois »).
Dans les deux films apparaît l’acteur allemand Felix Bressart – le futur Greenberg de To Be or Not to Be -, figure de grand comique juif qui exemplifie les préoccupations bien réelles de Lubitsch entre Munich et Pearl Harbor. L’évident et délectable anticommunisme de Ninotchka (plus supportable que celui de La Belle de Moscou (Silk Stockings), remake musical de R. Mamoulian, 1957) ne doit pas faire oublier la référence au nazisme et à la montée des périls. Les spectateurs rient beaucoup à ce monument d’humour à la fois sophistiqué et politique dont on peut se dire qu’il annonce le film antinazi à venir.
Il s’inscrit, certes, dans la série des allusions au contexte européen dont les scénaristes Billy Wilder (surtout lui) et Charles Brackett truffent leurs scénarios de l’époque, qu’ils écrivent pour Lubitsch (outre Ninotchka, voir la référence à la Tchécoslovaquie dans La Huitième Femme de Barbe-Bleue) ou Mitchell Leisen dans Éveille-toi mon amour (Arise, My Love) en 1940 et Par la porte d’or (Hold Back the Dawn) en 1941.
Aiguillonné par la jeune génération, et parce qu’il est aussi l’un des animateurs de l’European Film Fund, institution destinée à aider les exilés du cinéma, Lubitsch est personnellement impliqué dans l’antinazisme hollywoodien.
Il sait pertinemment que, même battu en brèche, l’isolationnisme américain reste la posture idéologique de rigueur. Il a vu Joseph Kennedy, le très compromis père de JFK et « ambassadeur » de Roosevelt à Hollywood, venir sermonner des tycoons tentés – pourtant bien timidement – de donner leur avis sur la situation en Europe. Mais en même temps, tout comme Chaplin dans Le Dictateur (The Great Dictator, 1940) et dans une parfaite continuité avec Ninotchka, Lubitsch tient à persévérer dans son être d’auteur de comédies. Sans le rire, le propos politique devient quasiment sans objet, à la fois vain et vide.
Une logique de la surenchère se laisse deviner dans le projet comme dans le résultat (d’où l’incompréhension initiale des producteurs et des premiers spectateurs) : si le discours doit être entendu, il convient de frapper fort, jusque dans l’invraisemblable – et ce dès le début avec Hitler se promenant dans les rues de Varsovie –, et de se donner les moyens de cette force de frappe en redoublant les effets par une logique carnavalesque. Film des comédiens, To Be or Not to Be insiste sur le cabotinage, c’est-à-dire sur une expressivité redoublée, ridicule et superflue, mais qui devient l’essence de l’art dramatique quand elle est mise en situation.
Semblable, en cela seulement, à la philosophie telle que la conçoit – faussement – Alcibiade dans Le Banquet, le cabotinage passe « par contact » de l’un à l’autre des acteurs. Personne n’est épargné, comme on le verra. Ce dernier rappel est à mettre en relation avec la difficulté à mettre en œuvre un projet jugé outrancier. Les grands studios le refusent, Sam Spiegel, à la manœuvre dès l’origine, est obligé de jeter l’éponge en dépit de son attachement réel au cinéaste et à l’idée même du film. Lubitsch trouve par chance une solution du côté de l’Angleterre : le film sera produit par Alexander Korda et sa firme London Films et distribué par United Artists – juste retour des choses.
Le film peut se monter grâce à Carole Lombard, actrice très impliquée dans l’engagement antinazi, star numéro un de l’époque et qui ne peut deviner qu’il s’agit en l’espèce de son tout dernier rôle – sa disparition dans un accident d’avion pendant la promotion de To Be or Not to Be sera vécue comme une authentique tragédie par le public américain, et contribuera en quelque indirecte façon à la légende noire de la première réception du film. Elle ne sera jamais aussi souveraine que dans ce film où Lubitsch lui rend tous les hommages et parvient à canaliser son énergie.
Elle incarne une très craquante Maria Tura, vedette incontestée du théâtre polonais, femme infidèle dans la grande tradition du vaudeville européen transcendé par Lubitsch, presque aussi cabotine que son mari et poussant le mauvais goût (le « poor taste », dira Joseph Tura) jusqu’à proposer au metteur en scène de la pièce Gestapo de porter une étincelante robe de soirée… pour son arrivée au camp de concentration – Lubitsch aggrave son cas, et cela ne fait que commencer car nous en sommes à la première apparition de Maria Tura.
Son mari Joseph Tura, selon ses propres dires « le grand grand acteur polonais », est interprété par Jack Benny. Né Benjamin Kubelsky, fils d’un Juif polonais de Chicago, Benny n’est pas une vedette de cinéma, c’est une authentique star de la radio (qui triomphera plus tard à la télévision). Parfaitement complémentaire de Carole Lombard à cet égard, il fait bénéficier lui aussi le film de son exceptionnelle popularité. Sa performance de cabot a acquis une valeur de paradigme.
Elle est de part en part au service d’un engagement antinazi dans un film où le mot « juif » n’est jamais prononcé ; il est évoqué par le patronyme de Greenberg (Felix Bressart), apparemment le seul Juif de la troupe, et par une allusion de ce dernier au cabotinage (décidément omniprésent). Le passage est crypté, résolument incompréhensible et intraduisible en version française ou dans les sous-titres de la version originale.
Et même un anglophone doit connaître l’argot théâtral pour savoir que ce que nous appelons un cabot se dit – ne me demandez pas pourquoi – « a ham », c’est-à-dire un jambon. Jugeant désolante l’irruption d’un comédien fat et antipathique, Greenberg lui assène : « Ce que vous êtes, je n’en mangerai pas. » Et pour que les choses soient dites, l’autre lui répond : « How dare you call me a ham ! »
Et ce sera tout pour l’explicite (si l’on peut dire), à l’exception des multiples références au Marchand de Venise et au rôle de Shylock que Greenberg rêve de jouer et qu’il interprétera « dans la vie », avant de disparaître du film, en évoquant l’humanité du Juif devant des nazis le soupçonnant d’un attentat contre Hitler (ultime ruse de la troupe qui va ainsi pouvoir quitter le théâtre et la Pologne).
Lubitsch, le prince de la comédie et l’ancien patron du plus puissant studio, peut aussi compter sur le concours de multiples bonnes volontés pour mener à bien le projet. Quand le comédien déguisé en Hitler sème la stupéfaction à Varsovie, les amateurs reconnaissent plusieurs fidèles (Edward Everett Horton, Frank Morgan, d’autres encore) qui acceptent de jouer les stupéfaits, l’espace d’une seconde. Parfaitement bouclée avec le gag ultime de la jeune admiratrice de Bronski demandant un autographe à l’acteur déguisé en Hitler, la séquence d’ouverture se révèle d’une densité sans pareille : tout est dit en ce qui concerne la situation et les personnages, le ton est donné par le rythme théâtral d’abord implicite puis explicite des échanges.
Vitesse de Lubitsch : la voice over de narration s’étonne de la présence de Hitler à Varsovie en août 1939, et ne manque pas de signaler le caractère hautement improbable de son intérêt pour la boutique de delicatessen tenue par M. Maslowski car « il est végétarien, même s’il n’hésite pas à avaler des pays tout entiers ». Dès l’entame du film, le rire et l’engagement marchent de conserve. La voix du narrateur feint immédiatement de nous conduire au QG de la Gestapo à Berlin (!) afin d’expliquer cette surprenante apparition. Ce que nous voyons dès lors se révèlera être une scène de Gestapo, la pièce que répètent les comédiens polonais dirigés par Dobosch.
Cette scène en fait horrible, où les nazis offrent un tank miniature à un enfant pour mieux amadouer son père aux velléités résistantes, est un moment de drôlerie… irrésistible : Benny/Tura attire déjà l’attention par son rire métallique et forcé, tandis que la blague comparant Hitler à un morceau de fromage fait sa première apparition dans le film. Après une première salve off de « Heil Hitler ! », l’apparition du Führer et l’improvisation de Bronski (« Heil myself ! ») interrompent l’illusion théâtrale par un effet métaleptique très classique : le metteur en scène est furieux du « bon mot ».
Tous les personnages liés à la troupe apparaissent alors en une chorégraphie bien réglée : Maria exhibant sa robe pour le camp de concentration, Greenberg y allant de sa réplique sur le ham… Maria et Joseph s’avèrent d’emblée rivaux en cabotinage, l’infidélité (éventuelle ou récurrente ?) de la dame est évoquée pendant que l’on rappelle que « Hitler n’est qu’un homme avec une petite moustache ». Ce fort avis ressort d’une querelle opposant les autres troupiers au sujet de la qualité de la performance de Bronski (Dobosch ne sent pas « Hitler en lui » ; Syberberg se rappellera la formule) ainsi que de la ressemblance supposée du tableau représentant Hitler dans la pièce avec son modèle ; or le tableau a été peint d’après… Bronski, qui décide donc d’éprouver la qualité de son « incarnation » en se promenant dans les rues de Varsovie.
Quand la séquence se clôt avec la demande d’autographe faite à Bronski, un œil sur le lecteur de disque révèle que tout cela n’aura duré que cinq minutes et quarante-cinq secondes… La boucle est d’autant plus parfaite que, si nous savons désormais que Hitler à Varsovie est un acteur (et la situation une fiction), la rapidité de la mise en scène – élusive en ce qui concerne la réalité du « siège de la Gestapo » – indique que l’on jouera volontiers dans To Be or Not to Be sur tous les passages de frontière entre le théâtre et la réalité.
On y jouera aussi à des « jeux dangereux », pour reprendre l’intelligent mais peu efficace titre français du film, désormais tombé en désuétude. La figure essentielle de ces passages est la répétition. Tout arrive (au moins) deux fois dans To Be or Not to Be : parce qu’il va retrouver Maria dans sa loge, le beau lieutenant Sobinski (Robert Stack) ose quitter la salle de spectacle dès le début de la grande tirade de Hamlet interprétée par un Joseph Tura médusé ; quand l’action se répète, le début de la Seconde Guerre mondiale n’est plus qu’un épiphénomène pour l’acteur vedette du théâtre polonais ; quant à l’ultime répétition (Witz final du film), Sobinski n’y est pour rien…
La répétition prend cependant tout son relief lorsque le jeu est vraiment dangereux, c’est-à-dire quand Tura doit d’abord usurper l’identité du commandant Ehrhardt afin d’abuser le traître Siletsky, puis endosser le costume de ce dernier (envoyé entre-temps ad patres) pour rencontrer le véritable Ehrhardt (Sig Ruman). La répétition affecte aussi les répliques en de véritables rimes de la comédie ; la plus célèbre renvoie aux camps (qui ne sont pas encore « d’extermination ») : apprenant de Siletsky qu’on l’appelle, lui, le chef allemand local, « Concentration Camp Ehrhardt », Tura, à court de texte lors de ce premier tour de force, ne cesse de répéter cet autre « bon mot », le plus souvent sur un mode inutilement interrogatif : « So they really call me Concentration Camp Ehrhardt ? »
Évidemment, devant le véritable Ehrhardt, Tura/Siletsky se fera une joie de lui apprendre comment on l’appelle sous d’autres cieux. L’autre sera ravi et y ira à son tour de son inutile interrogation ; conclusion de Tura : « J’étais sûr que vous réagiriez comme ça ! » Il est évident que cette pré-vision ne renvoie pas uniquement aux personnages de la comédie mais aussi à la tragédie de l’histoire (« Les films avaient été faits, n’est-ce pas ? », dira Jean-Luc Godard).
Mais le retour à To Be or Not to Be, comme l’a montré l’épatant Inglourious Basterds (Q. Tarantino, 2009), rappelle surtout que la répétition du rire est le meilleur remède aux horreurs historiques. On notera à ce propos que, parmi les innombrables admirateurs du film, Alain Resnais lui vouait un véritable culte.