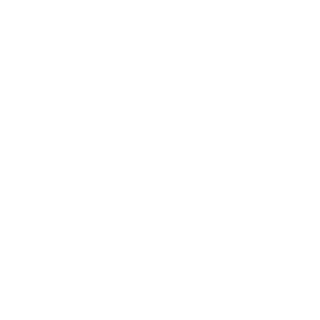La fille du missionnaire Lawrence Byrne, Rebecca, a été déclarée « miraculée » après avoir survécu à un accident d’avion alors qu’elle était enfant, au fin fond de la forêt amazonienne. Des années plus tard, elle est devenue une guérisseuse célèbre dans la région. Bientôt, son père rentre en conflit avec des bûcherons qui envahissent les terres appartenant au peuple indigène qu’il évangélise.
TRANSAMAZONIA
Fiction / France, Allemagne, Suisse, Taiwan, Brésil
HORAIRES DU 20 AU 26 AOÛT 2025
JEU 21 : 12h00
HORAIRES DU 27 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2025
à venir
BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE
Originaire d’Afrique du Sud et de Suède, Pia Marais est scénariste et réalisatrice.
Elle a écrit et dirigé trois longs-métrages de fiction. Son premier film, TROP LIBRE, a remporté le Tigre d’or au Festival du film de Rotterdam en 2007. À L’ÂGE D’ELLEN a été sélectionné à Locarno en 2010 et dans plus de 30 festivals, dont le Festival international du film de Toronto (TIFF). De retour dans son pays natal, Pia Marais a tourné LAYLA en Afrique du Sud. Le film a été projeté en compétition à la Berlinale en 2013, où il a reçu une mention spéciale du jury. En 2018, Pia Marais a signé son premier documentaire, CARI COMPAGNI, pour Arte. TRANSAMAZONIA est son quatrième long métrage de fiction.
NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE
TRANSAMAZONIA est né de ma fascination pour l’histoire vraie d’une jeune fille ayant survécu à un accident d’avion et une chute vertigineuse dans la forêt amazonienne dans les années 1970. Sa chance miraculeuse avait fait d’elle une célébrité du jour au lendemain, provoquant dans le monde entier toutes sortes de spéculations sur la façon dont elle avait réchappé au crash.
Inspirée par l’histoire de cette jeune rescapée et sa notoriété involontaire, j’ai entrepris un voyage de recherche sur la Route Transamazonica au Brésil, pour voir s’il serait possible de tourner un film sur place. J’ai accompagné pour l’occasion un journaliste qui couvrait depuis longtemps un conflit opposant un peuple autochtone et un village d’exploitants forestiers. Nous avons ainsi découvert les « deux côtés du conflit », et certains des événements observés et des individus rencontrés ont servi d’inspiration aux personnages du film et à leur affrontement central.
Ce premier voyage en Amazonie m’a fait très forte impression. Cet univers des confins avait des allures de western contemporain, peuplé de chercheurs de fortune, de peuples autochtones et de prédicateurs. Partout où nous allions, nous avons trouvé des congrégations évangéliques, y compris dans les villages de bûcherons les plus reculés, prêchant la prospérité et baptisant les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J’ai eu la sensation que ces églises accéléraient, en quelque sorte, la destruction de la forêt tropicale environnante.
En m’attelant au scénario, j’ai tenu à entremêler à l’histoire de Rebecca la situation complexe qui régnait sur cette portion de la Route Transamazonica. Au fur et à mesure a émergé la question autour de laquelle le film allait pivoter : comment une survivante d’un événement aussi traumatique peut-elle parvenir à trouver un sens à ce qui lui est arrivé ?
Sans que Rebecca en soit pleinement consciente, son père, Lawrence Byrne, a tiré de l’histoire de sa fille un récit unificateur destiné à faire perdurer sa mission sur place : apporter du réconfort aux malheureux et guérir leurs afflictions. Tels deux oiseaux inséparables, le père et la fille interprètent des chansons d’espoir et forment un étrange tandem : Rebecca dans le rôle de la jeune prodige et Lawrence Byrne dans celui de son manager. Peu à peu, le véritable passé de Rebecca est mis au jour, faisant vaciller la mythologie fondatrice de leur relation père/fille. Mon intention dans TRANSAMAZONIA était d’explorer l’ambiguïté du récit véhiculé par le père. Aux côtés de Rebecca, le spectateur découvre qu’on a induit la jeune fille en erreur et que son identité lui a été dérobée par la personne qu’elle aime le plus au monde.
Par ailleurs, il semblait essentiel d’interroger à une plus grande échelle la perpétuation des schémas qu’on nous impose. Cette question trouve écho dans la mission de Rebecca et son père, qui cherchent à évangéliser un peuple autochtone, leur imposant ce faisant une vision du monde et un système de croyances qui leur sont étrangers. Le film voit s’entrecroiser plusieurs fils narratifs qui se mêlent à celui du personnage principal, Rebecca. La jeune fille est une médiatrice, à la fois sur le plan narratif et structurel. Elle relie les événements entre eux, ses diverses activités facilitant les allers et retours entre les différents niveaux de l’intrigue.
Concernant le personnage de Lawrence Byrne, je l’ai construit à partir des parents qui se projettent à travers leurs enfants, comme si c’était pour eux le seul moyen de donner un sens à leur propre existence. Ces parents imposent inconsciemment à leurs enfants l’idée que l’amour est conditionnel. C’est un aspect fondamental du rapport entre Rebecca et son père. Lawrence Byrne a bâti sa réputation en tirant profit de l’aura miraculeuse de sa fille, comme s’il s’agissait d’un juste retour sur l’amour qu’il lui a donné. Je retrouve la même ambiguïté chez les missionnaires dont l’aide est soumise à condition, bien loin d’une simple expression de l’amour universel de Dieu.
Quant à Rebecca, croit-elle vraiment en son pouvoir de guérison ? Ou n’est-ce pas simplement sa manière d’aider son père à accomplir ce qu’il attend d’elle, se soumettant à sa volonté pour gagner son amour ? Élevée dans la certitude artificielle qu’elle est un catalyseur du pouvoir divin, Rebecca devra descendre du piédestal sur lequel son père l’a placée pour décider ce en quoi elle croit réellement.
J’ai cherché à donner une issue positive à l’histoire. L’ « amour » conditionnel laisse place à un sentiment spontané : Rebecca et Lawrence Byrne choisissent librement de poursuivre leur route ensemble. De ce point de vue, le film ne réfute ni le mysticisme ni la foi, mais cherche à dépeindre un spectre plus large, dans lequel l’amour et la nature trouvent leur place.
TRANSAMAZONIA est mon quatrième long métrage. J’ai intégré à son cadre fiévreux des éléments de suspense et de film de genre par moments, pour créer une atmosphère onirique inquiétante. Dans la lignée d’œuvres comme CARRIE de Brian de Palma ou PAS DE PRINTEMPS POUR MARNIE d’Alfred Hitchcock, on suit la protagoniste qui doit percer le secret de sa propre identité.
Je cultive depuis toujours une fascination pour les personnages de femmes qui doivent réprimer une part d’elles-mêmes pour exister dans le monde. Parfois, elles vont jusqu’à se la cacher à elles-mêmes. Il fallait donc que Rebecca conserve cet abord un peu irréel qui lui sert de façade. Peu à peu, la guérisseuse adolescente, qui n’est que la projection d’une idée, se retrouve aux prises avec les prémisses de l’âge adulte. Elle mène elle-même sa réflexion, renverse les rôles avec douceur et fermeté et s’autorise à devenir quelqu’un d’autre.
Étant donné que les origines de Rebecca ont donné lieu à une « histoire faussée », j’ai songé qu’il serait intéressant d’élever le film sur le plan visuel. De donner à certaines séquences un air plus artificiel, de rendre apparents les effets de manche. Nous avons travaillé cet aspect à travers la couleur, notamment dans les scènes à la mission évangélique, où Rebecca et son père pratiquent des guérisons miraculeuses. L’objectif était de séparer ces scènes de la réalité alentour, pour souligner la nature factice de leur mise en scène. Pour la salle de prédication, nous avons cherché à créer un « effet soucoupe volante », ton sur ton, entre nuances de blanc et couleurs pastel, jurant avec la nature environnante. On comprend ainsi que ce lieu n’appartient pas au même monde.
Pour les extérieurs, en revanche, nous avons cherché des décors naturels faisant écho à mes impressions du premier voyage le long de la Route Transamazonica. Nous avons accordé beaucoup de temps aux repérages, qui ont eu lieu au Brésil et en Guyane française pendant plusieurs mois. Nous avons ratissé des territoires entiers à la recherche d’une large piste bordée d’une forêt dense de chaque côté.
Visuellement, le film est composé de plusieurs couches, car le défi était de trouver des lieux permettant de comprendre que cette forêt constitue une interface entre deux mondes – elle joue ainsi un rôle essentiel dans l’intrigue.
L’atmosphère devait donner une sensation mythique et dramatique. Les scènes de forêt ont été tournées en Guyane française, tout près de la frontière brésilienne, en raison des forêts tropicales primaires qu’abrite la région.
Là-bas, on se sentait loin de tout, dans un endroit préservé. TRANSAMAZONIA résulte en quelque sorte d’une négociation visuelle et narrative entre les idées, les références et les réalités que nous avons découvertes en chemin. Tous ces aspects se sont enchevêtrés pour former un tout. La conception du film a exigé une immersion dans un contexte aux antipodes du mien.
Il a fallu tout un processus pour s’acclimater et comprendre la nature des espaces rencontrés, puis les tisser dans le langage visuel du film. L’intention était de créer une expérience sensorielle qui envelopperait les spectateurs dans le monde encore largement méconnu où se déroule l’action.
Pia Marais
CE QU'EN DIT LA PRESSE
ABUS DE CINÉ
Un double portrait, joliment trouble.
LE PARISIEN
Tourné dans un cadre somptueux et magnifiquement filmé, Transamazonia multiplie à tel point les intrigues – sociales, environnementales, policières, familiales, religieuses… – qu’il finit par déboussoler le spectateur.
PREMIÈRE
La beauté du film réside dans cette façon dont la cinéaste fait du visage de son héroïne dont certains stigmates révèlent une étrangeté (monstruosité ?), le territoire sensible de ce drame qui évoque lointainement L’Apparition de Xavier Giannoli (2018). Fort.
TÉLÉRAMA
Ce portrait ambigu d’une jeune fille aux prises avec l’illusion de sainteté (Helena Zengel, magique) reste avant tout un film d’atmosphère, aussi énigmatique et captivant mais parfois aussi impénétrable que la jungle qu’il magnifie si bien.