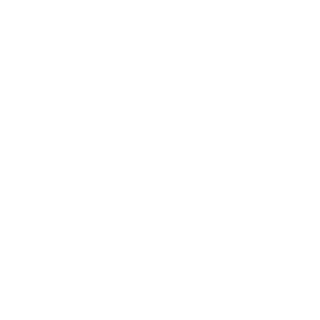Îles de Sao Tomé-et-Principe, 1907. Le docteur Afonso vient refaire sa vie dans une plantation de cacao, où il doit soigner un groupe de serviteurs « infectés » par une maladie connue sous le nom de Banzo. Les décès se succèdent les uns aux autres, sans que personne ne semble pouvoir rien y faire. Par crainte que ce phénomène ne soit contagieux, le groupe est envoyé sur une colline isolée au milieu de la forêt.
BANZO
Fiction / Portugal, France, Pays-Bas
HORAIRES DU 15 AU 21 JANVIER 2025
Mercredi, Lundi : 16h15
ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE
L’esclavage, qui se perpétue après son abolition légale, apparaît dans votre film avec une dimension extrêmement procédurale : une administration des corps et des gestes. Le mal comme institution qui perdure dans le temps sous différentes formes. Ce point de vue donne au film une perspective radicale et dure lorsqu’il s’agit de regarder l’histoire coloniale portugaise, refusant tout fantasme d’exceptionnalité. Pouvez-vous nous parler un peu de cette perspective, dans le contexte du travail que vous avez développé au fil des décennies sur cette histoire coloniale ?
Lorsque j’ai commencé à écrire le film, j’avais déjà passé quelques années à faire des recherches sur les plantations – en l’occurrence celles qui existaient à São Tomé et Príncipe, ancienne colonie portugaise. Ce faisant, j’ai accédé à de nombreuses sources qui avaient été écartées de l’histoire officielle parce qu’elles étaient des récits « sans importance » de la vie quotidienne, de personnes qui n’étaient pas non plus très importantes dans la hiérarchie établie du pouvoir.
Ces documents incluaient les rapports et les journaux des médecins, ainsi que les plaintes déposées par des domestiques à la curatelle ; les notes, parfois pleines de fautes d’orthographe, que les contremaîtres s’écrivaient entre eux. Toutes ces lectures m’ont révélé un monde de violence banalisée où les relations humaines prennent des formes extrêmement complexes.
Ce qui m’intéressait, et que j’ai essayé de recréer dans le film, c’était cette dimension où les systèmes d’exploitation de la terre et des hommes détruisent et piègent clairement, physiquement et moralement, tous ceux qui y participent, volontairement ou involontairement. Cette dimension procédurale fonctionnait et fonctionne encore aujourd’hui, par d’autres moyens, comme un rideau mystérieux qui cache une terrible coulisse d’exploitation et de violence.
Encore aujourd’hui, il est difficile de voir clairement derrière ce rideau… On sait ce qu’il y a là, mais on a peur de le déchirer. Le colonialisme portugais était très habile à créer des rideaux et des motifs floraux, une sorte de pureté naïve et simpliste, pour cacher la terreur du système colonial.
S’il y a quelque chose d’exceptionnel dans le colonialisme portugais, c’est l’idée cristallisée que « nous n’étions pas aussi mauvais que les autres », qui nous hante encore aujourd’hui, nous empêche d’avancer et de reconnaître notre identité.
Quand j’étais enfant, j’ai vécu dans le Mozambique colonial, où les colons étaient non seulement moralement gouvernés par le système colonial portugais, mais n’avaient pas honte de copier fièrement le système d’apartheid des pays voisins, l’Afrique du Sud et la Rhodésie (aujourd’hui le Zimbabwe), car cela leur donnait une apparence plus sophistiquée.
Il y avait aussi une terrible guerre coloniale, une guerre de libération, masquée comme un conflit sans importance.
Cette expérience a été frappante, et je pense que ce film fait partie du long voyage que j’ai entrepris dans plusieurs de mes œuvres, où j’ai tenté de voir au-delà de ce « rideau », en éclairant les nombreuses zones d’ombre qui subsistent dans cette mémoire coloniale. Ce n’est pas une tâche facile, car notre passé est d’une complexité immense, fait d’innombrables couches de vies perdues, de peuples décimés, d’exploitation et d’extractivisme, de questions d’identité, et surtout de violence latente, souvent en ébullition, prête à exploser.
Je m’interroge constamment sur ce qui doit rester dans l’ombre et ce qui doit être mis en lumière. Non pas par désir de dissimuler, mais parce que certaines vérités perdent leur essence et se déforment lorsqu’elles sont exposées à une lumière trop vive. Ces doutes m’accompagnent, et je tente de naviguer dans ce territoire complexe et rocailleux. À cet égard, BANZO a représenté un défi majeur.
Représenter le mal et la violence du point de vue du pouvoir exige une immersion dans l’esprit et la perspective des puissants. J’ai essayé de rester fidèle à toutes les complexités relationnelles, évitant de réduire les personnages à de simples instruments d’une vision manichéenne, polarisée et simpliste. Mon objectif était d’ouvrir un espace de réflexion, où nous, spectateurs, pourrions nous retrouver dans une position inconfortable face à l’impuissance devant le mal.
Le film contient de nombreuses zones grises et laisse des questions sans réponse. Le « rideau » qui dissimule le mal est représenté de manière volontairement inconfortable. Je ne sais pas si je parviendrai à le faire tomber seul, mais avec ce film, j’ai tenté de rapprocher le spectateur au plus près de cette réalité voilée, de le mettre à sa portée. Peut-être que de cette façon, chacun de nous, et collectivement, parviendrons à le faire tomber petit à petit. BANZO suit deux personnages dont la quête consiste à démêler la réalité. D’un côté, Afonso, le médecin, qui cherche une explication et un remède à la dépression mortelle qui afflige les esclaves, tout en découvrant son impuissance face à l’institution brutale de l’esclavage. De l’autre côté, Alphonse, le photographe, qui se dote d’un sentiment d’urgence pour créer un geste tourné vers l’avenir, en produisant des témoignages par la photographie et la mise en scène.
Comment êtes-vous arrivé à ces deux personnages ?
On pourrait dire qu’Afonso est le personnage central. Je n’aime pas parler d’Afonso comme du personnage « principal ». Il fonctionne comme un véhicule, un œil, l’alter ego du spectateur passif et impuissant. On sait peu de choses de lui, et d’un point de vue aristotélicien, c’est N’est pas lui qui se transforme, mais les autres personnages qui gravitent autour de lui, poussés par un mécanisme, par une succession d’événements, à travers lesquels nous sommes « emmenés » par Afonso. Au cours du film, la seule action qu’il entreprend est de suggérer au photographe Alphonse de photographier « ce qui se passe là-bas ». Il se défait du pouvoir d’agir, d’être le révélateur du crime, le révélateur du mal. C’est le photographe Alphonse qui sera chargé de cette tâche de dénonciation, dans la diégèse du film, et dans le temps historique de changement qui s’annonçait au début du XXe siècle.
Pour moi, il était important qu’Afonso et Alphonse ne soient pas de là-bas ou d’ailleurs. Ils semblent tous deux passer par l’île, par le monde et par la vie, comme nous tous. Mais ils sont tous deux conscients de leur impermanence, et cette conscience leur donne un pouvoir de réflexion qui nous rapproche d’eux en tant qu’êtres humains exceptionnels dans cet univers d’étroitesse d’esprit et d’avidité qui nous est présenté. Ils sont nos guides. Nous en savons plus sur Alphonse que sur Afonso. Nous avons une idée de son passé. De mon point de vue, Alphonse est un « agent secret » dans un monde et un système colonial qui lui sont hostiles, mais dans lesquels il évolue avec précaution, essayant de trouver une occasion de le saper depuis cet endroit, si proche et à l’intérieur du système, où il s’est placé. Ce sont des personnages complémentaires. Chacun dans son propre monde, mais dans le même monde. Chacun avec son propre rôle.
Au final, Alphonse repart avec le témoignage photographique « du mal », qu’il a pu recréer à partir de la réalité. L’« agent secret » se rend compte que ce témoignage n’aura d’impact dans le monde occidental que s’il suit les règles qui formatent une compréhension du mal. Bien que discutable, c’est ce qui est nécessaire pour gagner un combat. Afonso, lui, reste dans un temps et un espace suspendus, après le départ des Mozambicains sur un bateau qui ne les mènera nulle part.
Le film a une grande rigueur formelle, et traite les paysages avec beaucoup de précision – nous sommes dans une île équatoriale, et nous avons un sentiment permanent de danger et de hantise, d’une violence sourde que la nature n’exprime jamais pleinement, ou noie en elle-même.
Comment avez-vous travaillé le paysage, le son et l’image ?
La genèse de la plupart de mes travaux vient des paysages. Ce sont eux qui émergent en premier, comme un potentiel narratif. Dans ce cas, il s’agissait des paysages des îles de São Tomé et Príncipe. Non seulement la nature, mais aussi tous les éléments humains et architecturaux. L’île a un climat tropical oppressant, des pluies torrentielles brutales, quelque chose qui rejette et empêche clairement toute activité humaine, comme une voix de l’intérieur de la terre. Cette particularité rend encore plus absurde de penser que des centaines de plantations y ont été créées autrefois, ce qui a entraîné la destruction de pratiquement toute la végétation originelle de l’île. « Roça » signifie couper, défricher la terre, et c’est ce qui a été fait là-bas, dans une entreprise avide qui aurait été impossible si ce n’était au prix de nombreux esclaves.
La mémoire et le traumatisme de ces milliers de personnes qui ont vécu une vie de grande souffrance, sont encore présents aujourd’hui dans tout le monde physique, dans les paysages matériels et immatériels. Non seulement il reste les ruines du modèle des « roças », avec sa « Casa Grande et Sanzala » [« Grande maison et quartier des esclaves »], qui servent aujourd’hui d’abri à de nombreuses personnes, mais toute la mémoire collective est imprégnée d’histoires de violence et de répression.
Dans le film, j’ai essayé de capturer le côté oppressant et étouffant de cette réalité. Une humidité, un manque de lumière qui pénètre dans l’âme de tous les personnages et ne semble pas les lâcher. Un brouillard qui ne leur permet pas de voir clairement la réalité et qui les cache, les faisant disparaître à jamais dans une sorte de grand oubli.
Mon attirance dramaturgique pour les paysages fait qu’il m’est très difficile de reconstruire l’idée de ces paysages dans d’autres lieux, même similaires. Je sais que c’est toujours un effort supplémentaire pour les coûts de production, surtout dans un pays comme le Portugal où les films sont réalisés avec de très petits budgets, mais je pense qu’il est important que dans le processus de tournage, nous soyons tous – équipe, acteurs, figurants – immergés dans ce paysage hostile, aussi proche que possible de ce monde d’odeurs, de sons, d’animaux, de plantes, de rumeurs, d’histoires du passé et du présent. Ce processus devient également très incontrôlable. Les adversités, la puissance de la nature, ont fini par dicter une grande partie de ce qui a été filmé. Ce que j’apprécie. Après tout, le paysage dans son ensemble, les humains, les animaux et la nature en tant que forces inséparables, ont également créé une bonne partie du film.
BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE
Née au Portugal, Margarida passe son enfance au Mozambique, puis revient à Lisbonne, en 1975 pour étudier l’image et la communication audiovisuelle. D’abord assistante réalisatrice, scripte et photographe de plateau, elle réalise en 1996 le court métrage Dois Dragões. S’ensuivront plusieurs documentaires comme Natal 71 et Kuxa Kanema, avant ses premiers longs-métrages Le Rivage des murmures – présenté à Venice Days en 2005 – et Yvone Kane qui fait sa première à Tallin Black Nights. Elle y explore les thèmes coloniaux et postcoloniaux de la mémoire et des sentiments de perte et de culpabilité.