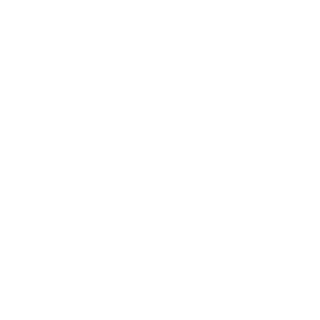Fiction / japon
DÉMÉNAGEMENT
Ren est une jeune fille dont les parents viennent de divorcer. Son père déménage, et elle doit s’adapter à cette nouvelle vie voulue par les adultes. Révoltée contre le monde des grandes personnes qu’elle interroge avec clairvoyance, elle devra apprendre à grandir et à se réconcilier avec eux au cours d’un cheminement qu’il l’amènera aux confins de la réalité.

ANNÉE
RÉALISATION
SCENARIO
AVEC
FICHE TECHNIQUE
DATE DE SORTIE
1993 / Restauration 4K 2023
Shinji SÔMAI
Satoshi OKONOGI, Satoko OKUDERA
Tomoko TABATA, Kiichi NAKAI, Junko SAKURADA
2h04 – Couleur – 1.66 – Dolby Digital 5.1
25 octobre 2023
SHINJI SÔMAI, CAP À L’OUEST » par Mathieu Capel
Tout fout le camp, et il faut faire, vivre autrement. Ailleurs ? Peut-être : c’est ce que nous glisse d’abord le film, alors que le père quitte la maison familiale pour un appartement plus simple. Mais l’on sait bien que ce déménagement, le seul explicitement figuré, n’a rien de central, comme s’il donnait son titre au film par accident ou euphémisme. Non : ici, c’est le monde entier qui déménage, sa surface entière qu’on a tiré sous nos pieds comme un vulgaire tapis. Le monde à l’envers ? Peut-être : là encore, le film nous le souffle d’emblée grâce à Ren, plus adulte que ses parents. Il faudra d’ailleurs qu’elle fasse le poirier pour que le film dévoile enfin son titre.
« Déménagement » est le dixième film de Shinji Sōmai et, pour une fois, c’est lui qui amène le projet à Ijichi Kei, son producteur1. Il aurait retrouvé dans le roman original de Hiko Tanaka les motifs qu’il poursuit depuis le début de sa carrière, à commencer par le personnage de Renko, qui rejoint les nombreux adolescents de sa filmographie, des premiers « The Terrible Couple » et « Sailor Suit and Machine Gun » à « The Friends », en passant par « Typhoon Club » – sans oublier « PP Rider », parent proche et déluré de ce « Déménagement », à ranger sans hésiter parmi les chefs-d’oeuvre les plus fous du cinéma mondial. Autant de films d’apprentissage ou d’initiation dont les personnages, bon gré mal gré, se portent au plus près de cette limite au-delà de laquelle l’enfance ne se vit plus que sur le mode du souvenir.
Bien sûr, cantonner Sōmai à ces initiations adolescentes serait par trop réducteur : aussi parlera-t-on plutôt de personnages qui « traversent la vie en funambules2 », toujours près de tomber (les ados de « The Friends », la jeune héroïne de « Lost Chapter of Snow », la tête proche du bitume), tombant parfois (l’alcoolo du magnifique « Kaza-Hana », le collégien de « Typhoon Club » décidé à montrer aux autres « comment on meurt »). De même, si l’on court si souvent dans « Déménagement » comme dans ses autres films – courses et courses-poursuites, jeu du chat et de la souris – sans doute est-ce parce que le sol n’y est jamais très stable, que les pas n’y sont jamais très assurés, et qu’il faut donc apprendre à se régler sur d’autres vitesses, comme l’annonce la scène, reprise de « PP Rider », où Ren saute dans le camion de déménagement. « Tout fout le camp » : de fait, la formule pourrait s’appliquer à nombre de ses films, sinon à tous.
C’est toutefois par la plus grande inertie que le projet du « Déménagement » commence. Sōmai passe d’abord de longs mois engoncé dans le canapé d’Ijichi. Sans rien dire, il l’écoute réécrire avec les deux scénaristes les trente et quelques versions du script – comme un cinéaste en sommeil attendant que le tournage enfin l’éveille. Peut-être visualise-t-il déjà certaines scènes, en même temps que s’accumule la frustration qui bientôt le poussera à accomplir son « voyage vers l’ouest ». Tout fout le camp : mais c’est lui d’abord qui déménage, à Kyoto, pour voir là-bas si le saké est meilleur.
Mais aller à Kyoto répond d’autres nécessités : cadre du roman, bien sûr, mais aussi, se dit-il, une ville assez conservatrice pour que cette simple histoire de divorce ne tombe pas dans la banalité. Peut-être y voit-il aussi l’occasion de se renouveler, quand les appartements de Tokyo et les neiges de Hokkaido (respectivement départements d’adoption et d’origine) l’ont déporté loin de ses fondamentaux, jusqu’aux fantaisies maniéristes de ses trois derniers films, « Lost Chapter of Snow », « La Femme lumineuse » et « Tokyo Heaven ». Bien sûr, pour l’homme de tournage qu’il est, Kyoto signe aussi la promesse de découvertes qu’aucun scénario ni aucun découpage ne sauraient prévoir.
Dont acte : l’imprévu s’impose de manière discrètement spectaculaire, sous les traits, dans le regard et la voix de la jeune Tomoko Tabata. Sōmai a lancé la carrière de nombreux comédiens amateurs : Masatoshi Nagase et Michiko Kawaii (PP Rider), Yūki Kudō (Typhoon Club), Yūki Saitō (Lost Chapter of Snow), Riho Makise (Tokyo Heaven) et bien sûr Hiroko Yakushimaru (The Terrible Couple, Sailor Suit). Mais il a bien failli ne jamais trouver Tabata. Bredouilles après un long casting (pas moins de 8253 fillettes, nous apprend la brochure officielle), Ijichi et lui désespèrent de trouver celle sans qui le film ne pourra prendre tournure. Las, ne leur reste plus qu’à aller à Osaka puis, sans doute, à retourner à Tokyo pour chercher encore… Soudain Sōmai se souvient d’un visage accroché au hasard dans l’auberge d’un soir – à moins qu’elle lui ait été recommandée par une geisha de ses connaissances. En tout état de cause, Tabata disqualifie sur-le-champ toute concurrente, même si Sōmai passe dès lors ses journées en répétitions et autres tests caméra, moins, dit-il, pour qu’elle s’approprie le rôle que pour trouver lui-même la bonne distance3.
L’errance nocturne de Ren à travers la forêt, jusqu’aux rives du lac Biwa, est l’autre imprévu le plus spectaculaire. Elle ne figure ni dans le scénario, ni dans le roman original – pour Sōmai, le film en tout cas ne saurait se finir sur la séquence du grand hôtel, pas plus que sur l’explication de la jeune fille avec son père. Elle s’impose comme une lubie, filmée au débotté, sans autorisation aucune en dépit des risques, improvisée jusqu’en son dénouement – ce bateau en flammes serait lui-même une trouvaille de dernière minute.
Quelle nécessité justifie cette séquence sans doute extravagante ? La nuit durant, Ren effectue sa mue, renaît ou se réinvente : « Félicitations ! », s’adresserait-elle alors à elle-même. Le cinéma de Sōmai se nourrit d’une forme de littéralité, selon laquelle les bouleversements les plus intimes doivent pouvoir se compter en nombre de pas comme en gestes : sans doute est-ce l’une des fonctions des plans-séquence qu’on attache à son style. (Sur un tout autre niveau, il faut de l’humour et du courage pour débuter cette relation à trois autour d’une table triangulaire). Mais cette littéralité se découvre encore dans la mécanique élémentaire du film. Car cette séquence nocturne et sa cauda onirique permettent surtout de redonner un sens, non pas au plan-séquence, mais à la coupe.
D’un bout à l’autre du film, c’est en effet une certaine capacité de montage que perd puis retrouve Ren. Lorsqu’elle se rend la première fois chez son père, elle rêve d’une armoire magique qui, par la grâce d’un simple cut, lui permette de se téléporter d’un lieu à l’autre. Imagination d’enfance qui est aussi l’un des pouvoirs élémentaires du cinéma. Là réside la cruauté perverse du plan-séquence qui, pour notre plaisir de spectateurs, déroule en majesté des distances toujours plus longues et incompressibles. Aussi lui faut-il apprendre un autre usage de l’espace, moins soucieux des objectifs : d’où le besoin peut-être de cette dérive nocturne. Que trouve-t-elle au bout ? Une nouvelle possibilité de montage, douloureux apanage de l’âge adulte : ou comment la distance devient distance à soi, signe la possibilité de se voir soi-même, spectatrice de ses propres actes, auditrice de ses propres mots.
Mathieu Capel est maître de conférences en cinéma à l’université de Tokyo. Il a récemment dirigé le numéro 59 de la revue Ebisu – études japonaises, « Films en miroir. Quarante ans de cinéma japonais, 1980-2020 ».
DÉMÉNAGEMENT par Hirokazu Kore-eda, cinéaste
J’ai le sentiment que le nom de Shinji Sōmai n’est pas encore connu et reconnu des amateurs et des critiques de cinéma en dehors du Japon. J’ai notamment pu le constater lors de mes passages dans les festivals internationaux où, lorsqu’on me demande quel réalisateur japonais j’apprécie et que je cite son nom, ou bien que je cite Typhoon Club comme étant l’un de mes films japonais préférés, la réaction des spectateurs et des journalistes est sans équivoque.
Pour ma génération, la découverte du nom « Sômai » est d’abord associée à l’image du réalisateur de program pictures (ndlt : films produits en masse et souvent dans une économie restreinte pour remplir les créneaux de double-programmation des salles de cinéma de l’époque) offrant des rôles à toutes nos idoles du moment. À cette période, hormis par une minorité de cinéphiles passionnés, ce nom n’était jamais évoqué, éclipsé par celui des stars en haut de l’affiche. Ce n’est que plus tard que je découvrirai que, pour ces stars, jouer dans les films de Sômai aura été l’occasion d’atteindre une qualité de jeu jamais égalée par la suite.
« Déménagement » est le film qui constitue une transition et un aboutissement dans la filmographie de Sômai. Bien qu’il ait un recours plus modéré aux longs plans-séquence qui sont habituellement sa marque de fabrique, il prouve plus que jamais son talent à tirer le meilleur de ses acteurs en mettant brillamment en scène l’excellent scénario de Satoko Okudera qui suit le voyage intérieur de cette petite fille. Après l’avoir vu, j’ai eu la confirmation que Shinji Sômai était le meilleur cinéaste de sa génération, ce qui le plaçait d’emblée comme étant l’unique réalisateur vivant que j’espérais rattraper.
Si je devais raconter une seule anecdote personnelle, je dirais qu’après le décès prématuré de Sômai, l’un des producteurs de « Déménagement », Masahiro Yasuda, est devenu le producteur de mes tout premiers films.
Et bien qu’il ne s’agisse que d’un lien indirect, j’ai l’impression que par l’intermédiaire de M. Yasuda, Shinji Sômai et moi sommes devenus comme deux demi-frères nés de mères différentes.
Je suis convaincu qu’au même titre que d’autres cinéastes de sa génération comme Edward Yang, Hou Hsiao-hsien ou Takeshi Kitano, le nom de Shinji Sômai mérite aujourd’hui, plus que jamais, d’être redécouvert.
Traduit du japonais par Léa Le Dimna //
« LE MONDE NE CONNAÎT PAS SÔMAI » par Ryusuke Hamaguchi, cinéaste
« Le monde ne connaît pas Sōmai. » Tel était le slogan qui accompagnait l’ouvrage Yomigaeru Sōmai Shinji (Shinji Sōmai Renaissance) paru en 2011, soit dix ans après sa mort (livre auquel j’ai moi-même contribué). Maintenant que dix années supplémentaires ont passé, le monde a-t-il enfin rencontrer Shinji Sōmai ? Oui et non. Bien sûr, plusieurs rétrospectives de ses films ont été organisées dans des festivals, qui lui ont gagné de nouveaux spectateurs. Mais il est encore loin d’avoir obtenu la large reconnaissance qui lui revient. C’est une chose que j’ai précisément ressentie dans de nombreux pays du monde. Le monde ne connaît toujours pas Sōmai.
Depuis ses débuts en 1980, Shinji Sōmai est tenu par les cinéphiles japonais en très haute estime, de même qu’il est, disons-le, impossible pour quiconque fait aujourd’hui du cinéma au Japon de ne pas avoir Sōmai en tête. Bien sûr, on comprend sans mal que, pour qui ne connaît pas le contexte particulier du cinéma japonais des années 1980, ses premiers films contiennent une tonalité qui les rende difficiles à digérer. À cette époque où, avec le démantèlement du système de production des grands studios, beaucoup de films ont été tournés en parasitant d’autres industries (comme la télévision ou la musique), Sômai lança sa filmographie en tournant des « films d’idol », en tablant sur la popularité des adolescentes qui en tenaient les premiers rôles (ce qui ne laisse pas d’évoquer les débuts au même moment de Hou Hsiao-hsien).
On parle souvent de « plan-séquence » ou de « plan long » pour caractériser le style particulier de Sômai pendant de cette période. Mais il n’est pas de plus grande erreur que de vouloir voir là ce qui fait de lui un authentique « auteur ». À comparer le plan long chez Sōmai à ceux des Welles, Tarkovski ou Angelopoulos, il n’en ressort rien de plus que leur rudesse ou leur grossièreté au niveau technique. Ce qui peut encore se comprendre comme la conséquence de productions désargentées, caractéristiques du cinéma japonais des années 1980. Or, il ne s’agit pas de cela. Car ce qu’il recherche avec la plus grande application est avant tout que ce qu’on nommera « l’éclat vital » de ses interprètes. Chez lui, le plan long permet à ces jeunes femmes qu’on voyait comme des « idols » de faire éclater de l’intérieur ce cadre pour mieux s’en échapper. Le plan long n’est que le sous-produit de la profonde confiance qu’il nourrit envers la « force vitale » qui sommeille en chaque corps, soit-il celui de ses comédiens ou de ses techniciens : il n’est pas une technique de mise en scène, mais le reflet de son « attitude envers la vie ».
Projeté dans la section « Un certain regard » du festival de Cannes 1993, Déménagement est, parmi tous les films de Sōmai, celui qui représente l’instant où le « monde » et « Sōmai » sont entrés en contact. Hélas, non seulement ce film est reparti bredouille, mais il n’a pas bénéficié de la même affection des critiques pour Sonatine de Takeshi Kitano, présenté la même année dans la même section. Là encore, le monde et Sômai ont rejoué leur partition de la rencontre manquée. À revoir le film aujourd’hui, difficile de ne pas rester incrédules. Non pas devant cette rencontre manquée (car, loin de se limiter à Sōmai, les cas sont nombreux). Mais devant Tomoko Tabata, qui joue le personnage principal. Sa faculté de mouvement, l’expression de son visage, ses yeux, tout est incroyable ; toutefois, ce qui m’envoûte le plus est sa voix. Cette voix, qui à elle seule parvient à exprimer tout son être, qui se joue des distances et de la durée comme si elle abattait toute frontière, pour toucher, et ébranler les adultes qui lui donnent la réplique, jusqu’aux spectateurs. En tant que cinéaste, qu’un être de la sorte puisse exister dans un film est à peine croyable. Les images en sont comme autant de preuves de son énergie vitale – mais alors, la puissance de vie qui se loge là, sans doute existe-t-elle aussi en nous-mêmes, l’avons-nous seulement employée à sa juste valeur ? Tel est le genre de remises en question auquel nous sommes alors contraints. La vie, ici réinsufflée.
Aujourd’hui, sans doute Déménagement est-il le meilleur point d’entrée pour faire se rencontrer le « monde » et « Sômai ». Pour comprendre ce film, qui correspond dans sa carrière à une période de plus haut raffinement, en plus d’avoir reçu sa vitalité sous les traits de Tomoko Tabata, nul n’est besoin de rien connaître à l’histoire du cinéma japonais. Et si jamais les spectateurs, par la grâce de ce film, en venait à s’intéresser à Shinji Sōmai, je voudrais qu’ils voient ses douze autres films. Parce qu’en chacun d’eux, s’y voient des corps, s’y entendent des voix qui surprennent. Mais soyons surpris, oui. Encore, toujours. Sinon nous n’avons pas encore vraiment rencontré Sōmai. Sinon que nous ne connaissons toujours pas Sômai !
Traduit du japonais par Mathieu Capel
À PROPOS DU RÉALISATEUR
Né à Morioka le 13 janvier 1948. Après des études à l’université Chūō (Tokyo), il intègre la compagnie Nikkatsu en 1972, où il devient assistant-réalisateur. Il quitte la Nikkatsu en 1976 et devient freelance. Assistant-réalisateur auprès de Kazuhiko Hasegawa, Murakami Ryū et Terayama Shūji. Il tourne son premier film, « The Terrible Couple », en 1980. De 1980 à 2000, il tourne 13 longs-métrages et un documentaire, met en scène un opéra, ou réalise plusieurs courts-métrages publicitaires. Il meurt d’un cancer du poumon le 9 septembre 2001.
1980 : The Terrible Couple
1981 : Sailor Suit and Machine Gun
1983 : PP Rider
1983 : The Catch
1985 : Love Hotel
1985 : Typhoon Club
1985 : Lost Chapter of Snow
1987 : La Femme lumineuse
1990 : Tokyo Heaven
1993 : Déménagement
1994 : The Friends
1998 : Wait and See
2000 : Kazahana
2001 : Le Mont Gassan
LISTE TECHNIQUE
avec : Tomoko Tabata, Kiichi Nakai, Junko Sakurada
Réalisation : Shinji Sômai
Scenario : Satoshi Okonogi, Satoko Okudera
Histoire originale : Hiko Tanaka
Production : Yomiuri Telecasting Corporation
Producteurs : Hirohisa Mujuku, Hiroyuki Fujikado
Image : Toyomichi Kurita
Montage : Yoshiyuki Okuhara
Son : Hidetoshi Nonaka
Musique : Shigeaki Saegusa
Direction artistique : Shinegori Shimoishizaka, Hidemitsu Yamazaki
CE QU'EN DIT LA PRESSE
LES FICHES DU CINÉMA
Cette merveille de mise en scène et de sensibilité était passée inaperçue. Gageons qu’aujourd’hui, ce film où chagrin, tendresse et vitalité saisissent à chaque scène ne laissera plus indifférent.
LES INROCKUPTIBLES
Véritable révélation, “Déménagement”, à la fois cruel et mystérieux, s’inscrit, sans forcer, dans la cohorte des grands films d’enfance.
LIBÉRATION
Film de 1993 resté inédit en France, ce récit d’initiation d’une jeune fille sur fond de divorce est la révélation tardive d’un chef-d’œuvre du cinéaste japonais Shinji Somai, disparu en 2001.
CRITIKAT.COM
Au-delà de ses morceaux de bravoure, le film brille surtout par ses incursions documentaires imprévues, dont la beauté renforce paradoxalement le côté rêveur de l’ensemble.
CAHIERS DU CINÉMA
Au lieu de traiter du thème du divorce en dramatisant les étapes successives de la séparation d’un couple face à leur enfant, Sômai en fera une force climatique qui dilate les durées habituelles, étire les perspectives des lieux autour d’eux, inscrit dans chaque mot une sourde résonnance.
CULTUROPING.COM
Par sa beauté triste et la simplicité pourtant virtuose de sa mise en scène, le film de Shinji Somai ressemble aux prémices du meilleur cinéma japonais contemporain. Déménagement peut donc être considéré sans excès comme une œuvre séminale.
LE MONDE
La caméra de Somai elle-même est entraînée, happée, par le mouvement de ses personnages. Sa prédilection va aux longues prises filées, aux plans-séquences scénographiés, où les acteurs peuvent jouer d’une traite, investir tout l’espace déployé par les aventures du cadre.
L’OBS
Impossible d’oublier le visage de la petite Tomoko Tabata, son pep dévastateur et ses larmes discrètes.
PREMIÈRE
Les mouvements de caméra emprisonnent les êtres sans pour autant les bâillonner. Dans la dernière partie, dans une formidable mise en abîme du regard, le film touche carrément au sublime. Il est plus que temps de découvrir Shinji Sômai.
TÉLÉRAMA
Tout en révélant le dysfonctionnement familial, les frustrations de chacun, la place compliquée à trouver pour l’enfant — on comprend pourquoi l’auteur d’Une affaire de famille aime tant Shinji Sômai —, le film reste volubile et vivant malgré la tristesse, étranger à tout pathos.
HORAIRES DU 24 AU 30 JANVIER
Dimanche : 12h35